Fil de lecture : Louis BERTHOLOM, Jean-Pierre BOULIC, Roland HALBERT.
« Avec les orties du temps » par Louis BERTHOLOM.
« Avec les orties du temps/tout s’en vient/tout s’en va ». A la lecture de ces trois vers, on croit entendre la voix de Léo Ferré dans le dernier livre de Louis Bertholom. Constat, en effet, du temps qui passe. Mais c’est, ici, la voix d’un poète breton (soixante ans d’âge) qui s’exprime en regardant – de ci de là – dans le rétroviseur. Pas de nostalgie au rabais, plutôt le regard de quelqu’un qui nous dit (et redit ) tout devoir à ses racines. « Mousterlin/de ma naissance/tes laminaires sont mon ombilic/ma source élastique ».
Ainsi va le poète quimpérois (né natif du pays fouesnantais) dans son « cosmodrome » cornouaillais. Le temps file entre les doigts (sauf au cours de ces insomnies dont il est affecté) mais il garde profondément en lui la saveur et la profondeur des temps révolus. C’est sa vraie planche de salut. Bertholom chante un pays à la fois géographique et mental, « un pays au goût de mûres/de culottes courtes dans les ronciers » (…) « un pays de fontaines vertueuses/discrètes et patientes » (…) « Un pays où se cachent les chapelles/aux vitraux pleins de visages/qui chantent dans le silence/des liturgies paysannes ». Le Xavier Grall de Solo ou Genèse n’est pas loin. Parlant de la Mer blanche près de Mousterlin, Bertholom peut même écrire : « Ici est mon médicament/ma religion, mon cosmos/mon lieu ancestral/avec la parole enfouie de la tourbe».
Le poète se fait aussi, dans ce livre, l’apôtre de la lenteur, du silence, du lâcher prise. « Cueillir le fruit de l’instant », écrit-il, « le savourer jusqu’au trognon » (comme on le ferait de la plus belle des pommes des vergers fouesnantais) et « regarder avec nonchalance s’énerver le monde », « Se rire sans vergogne de la grande bousculade/des cris, des palabres futiles, des compétitions ». Le poète préfère célébrer l’amitié et la fraternité. « Portez l’amour en boutonnière/allongez-vous sur des parterres odorants/respirez les sourires ». Il y a chez lui une forme d’hédonisme tranquille qui n’empêche pas quelques ruades quand il s’agit de défendre cette langue bretonne que « la République une et indivisible/persiste à vouloir enterrer comme jadis/soldats bretons dans la boue de Conlie ».
Mais le verbe, globalement, s’est assagi. Cela se ressent dans son écriture: plus ramassée, plus elliptique, moins tentée par l’emphase ou l’ivresse (comme ce fut le cas, parfois, dans de précédents recueils). Bertholom élague. Il peut ainsi atteindre le noyau dur de sa démarche poétique: dire notre bonheur (et parfois aussi notre malheur) d’être au monde, ici et maintenant. Certes le temps file, mais il y a ce que nous sommes devenus dans ce « pays lyrique/qui se cueille sur les lèvres/des vivants et des morts ». Parole de « vieux » sage.
*
Jean-Pierre BOULIC : « Ce pays comme univers »
Un vrai poète ressasse toujours un peu les mêmes émotions intimes. Et pourtant chacun de ses livres a une tonalité différente du précédent. Un vrai poète se reconnaît aussi – d’emblée - au ton de sa voix, à sa respiration, à sa façon de poser les mots sur la page. Avec Jean-Pierre Boulic, poète breton du Pays d’Iroise, il n’y a pas de surprise. Sa poésie – forte en images et en symboles – s’ancre intensément dans un terroir, un pays, un microclimat émotionnel.
Ce territoire a la dimension d’un univers, nous dit aujourd’hui le poète dans un livret d’une petite vingtaine de poèmes. « Ce pays comme univers/D’un homme passant ». Un pays qui le fait passer, imperceptiblement, de la terre à la mer. Un pays avec sa « gorgée de paysages » et sa « mer insaisissable ». Juin est là avec « la fenaison des couleurs ». Juillet, bientôt, où « respire la nuit légère de l’été ».
Il y a ici, sous la plume de Jean-Pierre Boulic, une vraie ivresse des mots pour dire cette « gloire » qui le ceint de toutes parts. « On va sans bagage/Le cœur nu/Comme l’air égrène/Ses pizicatti ». La nature, sans doute, mais aussi les hommes et les femmes dans leurs plus humbles gestes. « Elle allait glaner/Au temps où l’orge se moissonne/Buvant à la cruche des ouvriers/L’eau de sa soif ». La douleur aussi est là, la souffrance, quand « Sur tes doigts/Passe un vent frisquet/Femme brisée ».
Jean-Pierre Boulic nous parle « d’accueil, d’amour, de bonté ». Il élargit toujours les horizons. Cela ne surprend pas de la part d’un auteur de livres aux titres évocateurs : Cette simple joie, Un petit jardin de ciel, En marchant vers la haute mer (aux éditions La Part Commune)… Le chant bleu de la lumière (Minihi Levenez) et tant d’autres dans la même veine. Si « Bretagne est univers », comme le dit le poète Saint-Pol-Roux, il y a mille façons de le décliner. Jean-Pierre Boulic le fait à sa façon. Vivre en ce pays, c’est ainsi parvenir, un jour, à « Tisser la louange/D’un brin fleuri de gypsophile ».
*
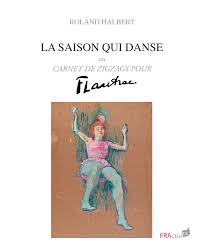
Haïku et peinture : Le Toulouse-Lautrec de Roland Halbert
Quel rapport entre Toulouse-Lautrec (1864-1901) et le haïku japonais ? A priori aucun, car ce que l’on connaît du célèbre peintre se résume le plus souvent à sa taille (1,52 m) et à ses tableaux de danseuses de music-hall ou de scènes dans des lieux de plaisir parisiens. Mais Toulouse-Lautrec, nous rappelle aussi le Larousse, fut un « dessinateur au trait synthétique et fulgurant ». On ne s’étonnera donc pas que le poète et haïkiste nantais Roland Halbert ait porté un intérêt particulier à ce peintre (le haïku n’est-il pas l’art de la fulgurance exprimé en trois vers ?). Intérêt rehaussé – et ce n’est pas la moindre des choses – par les penchants japonisants de Toulouse-Lautrec lui-même.
Pour en parler, Roland Halbert nous propose un livre comme on n’en fait pas, associant à trente-six peintures du maître des notes de lecture et des haïkus (« le fouet verbal du haïku répondant au trait enlevé de Lautrec dans sa capture instantanée », écrit l’auteur). Le tout constitue, ajoute Roland Halbert, « un haïbun critique, consacré aux liens directs ou indirects, aux rapports flagrants ou discrets de Toulouse-Lautrec avec le Japon ».
Car – faut-il le rappeler – une belle partie de l’expression artistique à la jointure du XIXe et du XXe siècle est marquée par le japonisme. Lautrec connaît les estampes ou les encres sur papier réalisées par les grands maîtres du pays du Soleil-Levant. Il s’en inspire même, à l’image de cette encre de Chine au pinceau, datée de 1894, intitulée « Paysage japonais à la manière d’Hokusaï ». Le voici, aussi, peignant sur un éventail une aquarelle dont le papier est à armature de bambou. Le voici encore peignant des crapauds, des hiboux, des chevaux ou des samouraïs comme pouvaient le faire des peintres japonais. Le voici surtout, note Roland Halbert, « comme tout haïkiste, un météo-sensible toujours attentif à la saison, à l’heure, à la minute ». Toulouse-Lautrec « s’arrête tous les trois pas, sort de son filet un petit carnet, comme un haïkiste à l’affût du moindre souffle, du moindre tremblement, du moindre battement d’ailes ». Et quand Lautrec doit, en 1899, partir en cure de désintoxication dans une clinique de Neuilly, Roland Halbert ne manque pas d’évoquer le haïkiste japonais Santôka qui s’était réfugié dans un monastère pour faire son sevrage. Pensant à eux, il peut écrire ce haïku : « Maison de santé / le seul loisir du printemps / écraser les mouches. »
On peut parfois être désorienté par ce livre qui fleurit dans tous les sens au gré des tableaux de Lautrec, mais on s’incline devant la richesse de son contenu. Roland Halbert nous a habitués à des livres un peu hors normes, à l’image de son Parloir aux oiseaux, cinq chantelettres à François d’Assise ou de sa Petite Pentecôte de haïkus. C’est encore le cas ici.
*