Fil de lectures de Carole Carcillo Mesrobian : Autour de Fabrice Murtin, Katia Roessel, Laurent Grison et Julien Delmaire.
Dans la collection « Poètes des cinq continents » un recueil dont le titre, Décantation, décline une présence discrète sur l’espace blanc immaculé de la couverture. L’économie de toute iconographie annonce déjà des dispositifs sémantiques parcimonieux. Le paratexte est donc concis, et la quatrième de couverture qui propose un extrait des lignes du poète ainsi que sa très succincte biographie suit ce qui apparaît déjà comme métaphore de l’écriture de Fabrice Murtin. Et en effet, la cinquantaine de textes proposés s’énumèrent au fil de pages dont le format généreux permet de conserver un espace immaculé qui s’inscrit après le déroulé textuel comme une invitation à entendre le silence riche de sens suscité par les mots de l’auteur. Des titres de chapitres jalonnent le parcours de lecture : « Le Vieux poème », « Décantation », Corps profond », « Le lait de l’océan ». Sobrement disposés en tête des textes ils convoquent un ensemble sémantique pluriel. L’univers urbain côtoie une évocation de la nature qui est l’occasion de laisser transparaître les pensées du poète avec une pudeur qui jamais ne cède à la facilité d’une énonciation lyrique pesante. La rareté du pronom personnel de la première personne du singulier est à ce titre signifiant. Une mise à distance opérée grâce à l’emploi de pronom « tu » est garante de toute effusion personnelle qui masquerait la teneur du propos. Le fil des pensées s’égrène avec discrétion mais elles n’en convient pas moins le lecteur à entrer dans une intimité dont le parcours est dévoilé avec une délicatesse inouïe.
Tu t’avances corps profond, vers l’incomplétude
et la déliquescence. Tu oublieras jusqu’à tes grandes heures,
tes mots deviendront lettres mortes. Nulle grâce suspecte
n’aura flétri les lauriers invisibles de ton dernier souffle.
A chaque marche, ton égale ferveur, à chaque station,
la fêlure de tes silences.
Que restera-t-il de ta vie, de tes heures inaudibles ?
Peut-être la lointaine résonnance de tes dons purs.
Une fois ta parole. Ton immanence.
L’écumoire de minutes avinées par les présences et l’ami.
Sublimes divagations ignorantes des lois, retranchées des lieux
et des gens.
Qu’elles fulgurent depuis l’ivraie.
L’image sacrée du poète n’est ici plus de mise, et va de conserve avec la démarche de l’auteur qui est celle d’ancrer son discours à la modernité poétique. Les deux premiers chapitres, « Le Vieux poème » et « Décantation » placent dés le début du recueil les propos de Fabrice Murtin dans une perspective théorique et historique. Ainsi la clausule de première partie :
Depuis l’instant où les divinités se turent
chaque homme répète leur parole au fil de sa vie
arquant sa voix comme une flèche entre les lignes
du vieux poème
le barattage de l’océan. »
Le poète invite le lecteur à suivre le fil de pensées qui apparentent ses propos à l’énonciation d’un monologue intérieur. Ce cheminement à des considérations tant intimes qu’universelles soutient une réflexion sur la teneur de la parole poétique. Face à la conception classique du poète inspiré des dieux, et aux dictats qui voudraient que la poésie ne soit l’objet que de thématiques élevées, l’auteur revendique la liberté et la démocratisation des paramètres de création. Chacun peut s’emparer des perceptions qui l’assaillent et deviennent la substance d’une écriture dont les paramètres ne se laissent dicter que par des choix intimes. Et le monde appréhendé par chacun de manière unique devient le support de ce dévoilement des perceptions. Fabrice Murtin désacralise donc la posture et la matière poétiques. Et au-delà de cette visée réflexive se dévoilent également le cheminement du poète. De par ses choix sémantico-syntaxiques celui-ci confère au texte une épaisseur multidimensionnelle qui fait de Décantation un recueil grave et riche de sens.
Fabrice Murtin, Décantation, Poètes des cinq continents, L’Harmattan, 57 pages, 2015, 10 euros.
***
Un ouvrage dont la clarté s’énonce dans le choix de la couverture gris clair qui reçoit un appareil paratextuel décliné en rouge, parcimonieux et d’une typographie discrète. Cette impression de retenue est corroborée par l’allure des textes dont les pavés essaiment des paragraphes clairsemés sur des pages dont l’espace immaculé entoure le tout de manière généreuse. Dès avant la lecture voici l’horizon d’attente placé sous le signe d’une parole dont le rythme s’appose doucement sur la page tant est délicate l’avancée des lignes sur le papier. Mais dés les premiers textes le contrepied est pris : une évocation des souffrances engendrées par la violence, puis un énonciateur qui s’immisce au discours et laisse apparaître des bribes de parcours personnel. L’omniprésence de la mort évoquée dès le texte liminaire ponctue les propos, suggérée ou convoquée de manière explicite dans des dispositifs qui confèrent à cette poésie une allure narrative grâce à l’emploi du langage dans sa fonction référentielle. Ainsi l’auteure invite le lecteur à naviguer entre des éléments autobiographiques et des considérations humanistes. Qu’elle soit subie dans l’intimité ou qu’elle saisisse nos semblables périssant dans des holocaustes dont l’indicible cruauté perdure, la mort s’impose comme une thématique qui structure l’ensemble du recueil. L’un des tout premiers textes semble s’imposer comme exégèse à la globalité des propos de Katia Roessel :
Antilope
les yeux bandés, j’ai dû tuer lorsque l’on me chargea de
ce couperet, tout en se moquant de moi, afin de me forcer et
de me berner dans un ornement disgracieux, aux accalmies
duquel l’animal agonisait ; j’observais la femme et l’enfant
jusqu’à ce que je perdisse totalement conscience, leurs
révérences s’arquaient subitement et me rebutaient toute
sorte de compassion.
Dès lors, je m’en sortais, en m’enfuyant dans les replis
d’une chambre optique et sensible dans
Laquelle l’exploit fut flatteur, les fleurs capiteuses,
J’escamotais une gerbe des roses auxquelles je dévouais
Chaque souvenir douloureux.
Je ressentais le transport ébranlant de quelques archanges
Idiots près des corsi pourpres et dorés qui m’agressaient
Avec leurs spots de motos, et cela m’était facile de les
Bloquer
Je préférais la distance d’une solitude essentielle en
Maintenant le regard sur la tombe fraîche. J’y songeais
Follement, dénudant une éternité de délices : un jour je me
Suis mise à caresser les livides crevasses de l’horreur qui
Couvraient furtivement l’étendue du ciel - j’y voyais
Promesses, crépuscules, dans un monde devenu fertile
Jusque dans ses terres sanglantes, et je lui dédiais une
Nouvelle église
Je m’évertuais, traversant les escarpements neigeux d’où l’annoncia-
tion meurtrière, nageai dans des torrents gorgés de pluie, pénétrai les
noires profondeurs
de la mer/de ;
je détruisais toute œuvre de miséricorde en y liant un système
sublime et grandement ouvert, à l’ascension moins religieuse.
Autant je courais
(monsieur ! ) je courais loin
et loin encore ;
je m’escrimais à y accéder-je conjecturais que la solitude était une-
victoire. »
Ce va et vient entre le particulier et le collectif est également l’occasion de mettre en place une sémantique qui entretient une dialectique entre le texte et l’image. Il s’agit là d’une poésie où la réitération de l’évocation des sensations visuelles permet à Katia Roessel de convoquer des éléments référentiels donnés à voir grâce à l’emploi d’un paradigme qui tisse la trame d’une énonciation tout à fait particulière qui est celle d’un regard inscrit dans la temporalité d’un parcours qui prend forme à travers les visions de l’énonciatrice.
« Elles sont couchées dans un lit où on voit leurs
jambes découpées par une couverture de flanelle.
deux poupées sont toujours posées près du grillage
de la fenêtre, et, de façon néfaste peut-être, j’avais
chié un tas pour que le monde en rêve sans doute
pour des dizaines d’années encore. »
Le titre du recueil, « Les Yeux bandés », en faisant référence à la cécité, semble prendre le contre-pied des champs lexicaux du regard et de la perception visuelle qui émaillent l’étendue des textes du recueil. Mais ce fonctionnement antithétique n’est valide que si l’on omet de considérer la richesse et la prégnance d’un monde intérieur qui permet à la poète de façonner la matière du réel et de mener le lecteur face à des visions sensibles et créatrices d’images poétiques qui confèrent aux éléments du réel ainsi perçus une dimension inédite.
Katia Roessel, Les Yeux bandés, Mémoire Vivante, 69 pages, 2010, 16 euros.
***

Georges perec dont le nom suffit à convoquer une bibliographie dense et d’une richesse exceptionnelle, est à l’honneur dans le titre même de ce petit recueil de quinze textes. L’épigraphe d’œuvre le convoque également car une citation tirée de W ou le souvenir d’enfance figure en tête de l’ouvrage :
« Les choses et les lieux n’avaient pas de noms
ou en avaient plusieurs :
les gens n’avaient pas de visage.
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance »
Dans W ou le souvenir d’enfance Georges Perec tente de rendre compte de ce qui ne saurait être énoncé : l’horreur de la seconde guerre mondiale, et de son histoire personnelle fauchée par « l’Histoire avec sa grande hache ». Le visage de sa mère s’éloigne de lui, alors qu’elle lui dit au revoir sur un quai de gare, car afin qu’il échappe à la déportation ses parents le cachent en l’éloignant d’eux. Cela sera la dernière fois qu’il verra le visage de celle qui lui a donné le jour. Puis, ensuite, il lui a fallu survivre et grandir, seul, malgré tout. Et face à l’impossibilité de raconter l’épouvantable, gageure à laquelle se sont heurtés ceux qui ont voulu rendre compte de l’innommable, l’auteur va avoir recours à une mise en œuvre formelle apte à susciter une intense émotion : il alterne les chapitres, l’un relatant son existence et l’autre qui met en scène, à l’occasion d’un récit fictif, des athlètes qui sur une île non identifiable s’entraînent pour décupler leurs performances, et dont les attributs sont en tout points similaires aux canons énoncés par l’idéologie nazie. C’est de cette partie qu’est issue l’exergue citée par Laurent Grison, qui choisit de se placer sur le versant de l’univers fictionnel mais non moins référentiel de cette autobiographie magnifique. Et le lien est réaffirmé dés le premier texte du recueil :
dans la ville mère
l’ancre d’acier
retient l’immeuble
sans trait
ni point
une seule lettre suffit
pour écrire
le destin amer
de ceux
de la rue Vilin
L’œuvre de Georges Perec est d’une épaisseur sémantique et conceptuelle considérable. Et loin de demeurer dans l’évocation de W ou le souvenir d’enfance, Laurent Grison au fil des chapitres de ce petit recueil convoque d’autres aspects de l’œuvre de cet auteur prolixe. Ainsi il fait référence au roman lipogramme La Disparition dans le titre du dernier chapitre, « Ls choss rprndront vi ». Le lecteur y reconnaîtra peut-être également dans l’évocation de l’univers urbain une référence à Espèces d’espaces, et dans « Croiser (classement inverse-13) », second chapitre du livre, à Penser/classer. Bien d’autres thématiques tirées de l’œuvre de cet auteur incommensurable sont également évoquées aux pages du Tombeau de Georges Perec.
Mais faut-il n’y voir qu’un hommage qui énumèrerait quelques unes des multiples facettes de l’œuvre de Perec ? Il semble que l’univers de Laurent Grison n’ait rien cédé à la présence de cet auteur. Il ne s’agit pas d’un effacement mais d’une juxtaposition, d’une conjonction de deux sensibilités. La langue de Laurent Grison offre un emploi tout particulier des paradigmes, servis par une syntaxe dont le protocole quelque peu déstabilisé est créateur de sens. Ainsi évoquer Georges Perec est pour l’auteur l’occasion de donner au langage poétique une dimension toute personnelle. Emouvant et dense, Le Tombeau de Georges Perec propose donc avant tout une rencontre, celle d’un poète qui écrit à celui qui a écrit que la substance de son œuvre est matière vivante.
Laurent Grison, Le tombeau de Georges Perec, La Porte, 26 pages, 2015.
***
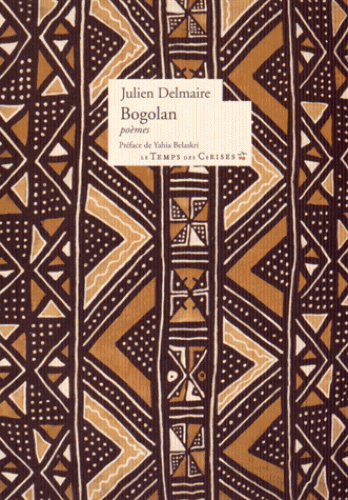
Le petit format d’une couverture ornée de motifs ethniques qui convoquent l’Art africain confère à ce livre une dimension ornementale. Il semble presque que la texture du tissage traditionnel qui forme le tissus dont la trame est reproduite ici ne déborde du cadre pour ouvrir une route palpable au voyage dont la direction est indiquée par le titre : « Bogolan », inscrit discrètement sous le nom de l’auteur, Julien Delmaire. La cohérence sémantique entre les éléments du paratexte qui incluent une courte présentation en quatrième de couverture dessinent donc l’attente d’un dépaysement. Les quarante textes compacts qui s’enchainent au fil de pages dont ils recouvrent le centre ne portent que des numéros. L’allure typographique est celle de la prose. Qu’est-ce à dire ? Deux épigraphes d’œuvre ouvrent la lecture de cet objet livre :
"…sous les tambours crevés
de ce pays crevé au soleil crevé
où tuméfié se lève l’espoir toujours têtu…
Amadou Lamine Sall, Les veines sauvages
Je souffre, comme toi n'est-ce pas? Comme la nuit d'hivernage.
Leopold Sedar Senghor, Les veines sauvages "
Julien Lemaire convoque dés l’avant lecture deux auteurs africains, dont l’un, Léopold Sédar senghor, n’est plus à présenter, car chacun sait qu’il a porté la voix des opprimés, des oubliés, des victimes soumises à une violence inouïe qui perdure encore sur ce continent africain mis à feu et à sang. Ainsi les auspices sous lesquelles sont placés les textes de Bogolan signent le combat pour dénoncer ces atrocités. Les champs lexicaux déployés dans les citations l’énoncent : il s’agit bien d’une parole engagée que le lecteur se prépare à découvrir. Et le texte liminaire ne dément pas cet horizon d’attente :
« Je sépare le silence en branches parallèles. Les morts sont pris dans un cauchemar où surnagent des signes craquelés. Comprendre ce quartier, au-delà des fulgurances de tôles et de pneus, c’est trier l’étoile pubère parmi les détritus. Mon quartier s’écrit en tracés de goudron, comme un poulain retire son harnais, délite sa crinière. Je suis nu sur la corniche, avec l’audace des palefreniers, je rivalise de mystère avec la lune, j’adopte la posture violente du nénuphar, j’accorde mon souffle aux tambours. Bastonnade de feuillages, les flancs du cheval transpirent la tendresse des gargotes. Les âmes sont douces. Le sucre hypnotise les sorciers. On sert encore du café à celui qui s’effondre »
Un énonciateur dés l’abord emmène le lecteur avec lui sur les traces de ce pays, Dakar, dont la topographie exacte est indiquée en quatrième de couverture. Celui-ci relate son périple, son retour là où il a grandi. Grâce à une langue prosaïque dont l’agencement syntaxique trace des images fulgurante, le poète laisse entrevoir la puissance de cette violence subie et destructrice. La juxtaposition inédite d’éléments référentiels servis par un lexique dont l’emploi reste protocolaire permet de confronter les perceptions du locuteur. Grâce à cet enchaînement de bribes juxtaposées et dont le lecteur devine l’agencement existentiel, l’auteur confère à cette prose une dimension éminemment poétique. Il semble alors que julien Lemaire n’ait trouvé une manière puissante et émouvante pour relater l’indicible.
Julien Delmaire, Bogolan, Le Temps des Cerises, 55 pages, 2015, 10 euros.