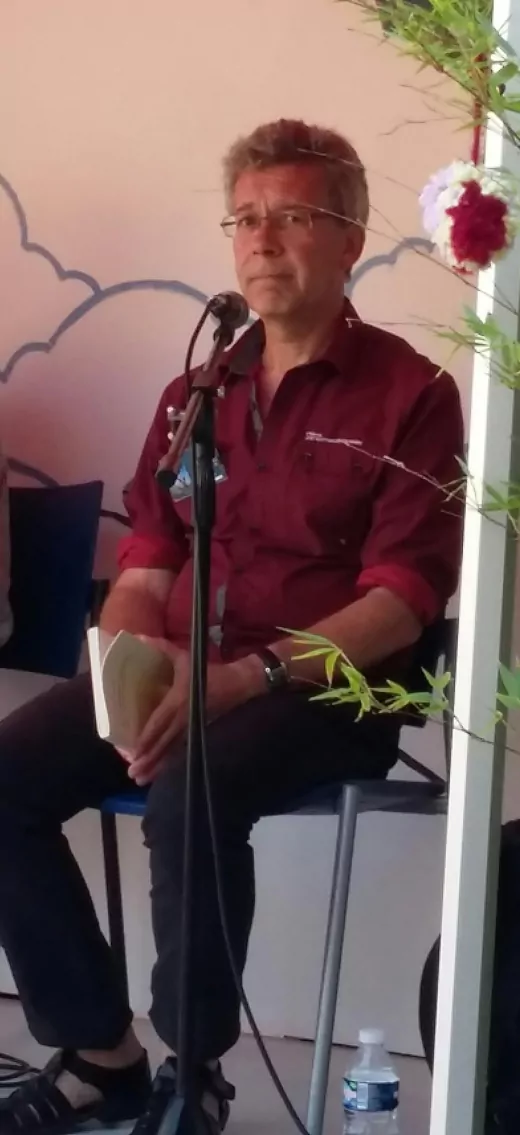I
Gog et Magog
En troupeaux, comme font les ânes sauvages,
vainement allait et revenait en vain
Gog et Magog avec ses noirs charriages ;
et la montagne les voyait dans la plaine
errer, et entendait parmi les tourmentes
les claquements de leurs fouets portés au loin ;
et un braiement parvenait, de ces nations
de Mong, comme une humble rengaine d’hyènes,
à l’infrangible Porte de l’Occident.
II
Car entre deux monts était, grande, de rouge
bronze une porte ; si grande que son ombre
se projetait, vers les heures du couchant,
jusqu’au milieu du val. Le fils d’Ammon-Zeus
la fixa sur ses gonds contre les immondes
peuplades, et les noirs groupes de bisons ;
il la barra serré. Mais resta en haut
des monts : une claire clameur de trompettes
descendait des deux Mamelles d’Aquilon.
III
Là était le Bicornu… Et les derniers
qui avaient entendu, enfants, retomber
la masse sur les clous étaient gris et vieux ;
et Lui ne partait pas… Et leurs fils, géants
aux yeux de flammes, aux langues toutes noires,
ou nains hirsutes aux mobiles oreilles,
étaient morts ; et de chacun d’eux des milliers
étaient nés, nombreux comme les étincelles
d’un tison : mais le Bicorne était là-haut.
IV
Tout en haut, à la garde de l’Erguené-
coun ; et le son au réveil de ses dianes
faisait rouler avalanches et moraines.
Chaque matin le ciel s’emplissait de buses ;
et la Horde, en bas, comme nuées au son
de l’orage, noire se serrait au Khan :
c’étaient des chariots roulant depuis le cône
des montagnes, un soudain barrissement
d’éléphant, une voix comme le tonnerre…
V
Mais moins s’entendait dans le jour ce tumulte
là-haut : dans le jour aussi les gens parqués
rugissaient, s’arrachant le manger, des ongles.
Le cri de là-haut s’effaçait dans l’aboi
de leur faim. C’était, durant le jour, tout pour
le sang, Alan et Aneg, Ageg, Assur,
Thubal, Céphar. Davantage on l’entendait
dans les longues nuits, quand concevaient des fils,
enfants de Mong-wu, leurs femmes sous la yourte.
VI
La lune montait en suivant les bords jaunes
de nuages fuyants ; autour d’une intacte
neige se tenaient des troupes de chevaux :
les têtes rentrées, immobiles restaient
sur ce blanc ; avec de temps à autre un bref
hennissement, un soudain bruit de sabots.
Toute la montagne solitaire encore
mugissait. Et même la lune, craintive,
en l’air se haussait, de nuage en nuage.
VII
Ou resplendissait sur l’infini murmure
pendante. Couronné de lierre et d’acanthe
le Héros, ôtant les torches du banquet,
parcourait en fête la côte éclairée
et là-bas, depuis l’ombre courbe des pins,
la Horde écoutait de longs aériens chants,
entendait de longs gémissements marins
des conques, et, mêlés au son des cithares,
timbales sourdes, cymbales argentines.
VIII
Gog et Magog tremblait ; et ses femmes dirent :
“N’a‑t-il pas de mère, Lui, auprès de qui
il soit doux de retourner, lourd d’ambre et d’or ?
pas d’enfants, de bétail ? pas d’épouses belles
à côté de qui, las de narrer, se couche ?
Peut-être est-il repoussé, d’être bicorne ?
Alors pourquoi ne descend-il pas du mont
pour prendre l’une de nous entre les hordes,
qui soit sa bête, parmi Gog et Magog ?”
IX
Gog et Magog tremblait… Or l’un de ses nains
prudemment alla trouver les géants sots.
“Nous mourons tous, géants, et lui ne meurt pas.
Moi qui meus mes oreilles comme les chiens,
j’ai entendu des choses. Là Zul-Qarnayn
n’est pas toujours. Parfois il était à Rûm.
Il part avec le jour. Il va à la source
d’étoiles liquides, bleue. Avec ses mains
jointes prend la vie. Tous les cent ans un peu.”
X
Mais Lui, un jour (la Montagne paraissait
plus proche, morne, et montrait comme un squelette
ses blancs ossements de pierrailles éparses)
à travers l’ombre, où l’on ne savait quels doigts
soulevaient des lampes errantes d’argent,
par l’ombre il allait à la source de vie.
Plus de sonneries sur les pentes, le vent
soufflait en vain. Et la grande Porte un peu
vibrait, par à‑coups, comme une poussée lente.
XI
Gog et Magog trois jours, veillant, attendit,
trois nuits attendit, et n’entendit, le soir,
que de temps en temps la Porte vibrer, lente.
Il n’était plus au mont !… Et la Horde prit
le chemin des monts. Elle allait, noire Horde,
fourmillant à l’encontre de la tourmente.
À l’aube, lugubre, meugla un bison,
hennit un cheval, la troupe se rompit…
Une sonnerie courait de mont en mont.
XII
Et les femmes dirent : “Oh homme de rien,
Zul-Qarnayn ! Tu es revenu bien vite ! Ou
n’y avait-il pas à la source une fille
seule ? une de tes sœurs qui le seau peut-être
abandonna vide à la source, et courut
hors d’haleine jusque chez ta mère vieille ?
Alors, divin bélier, fais donc résonner
les trompettes ! Au son de cette fanfare
notre homme se réveille, et puis ne dort plus.”
XIII
Et les hommes hululèrent : “Il a bu
en Rûm à la source des étoiles bleue !
Zul-Qarnayn est toujours celui-là qu’il fut.”
Et ils eurent en haine toute autre vie,
et le fruit de tout ventre autre ; et le sang rouge
trait aux bisonnes, aux zébus ils le burent.
Ne résonnait plus au val un beuglement.
Ne sonna plus, Gog et Magog, que le cri
sans fin hurlé de tes infinies tribus.
XIV
Pourtant il partit, Zul-Qarnayn, dans le feu
d’un couchant : sur le mont étaient étendues
les pourpres sombres à franges de crocus.
Dans son char d’or il monta, étincelant,
le Héros ; dans l’ombre il s’éloigna parmi
un joyeux éclat de béryls et turquoise.
Un bref scintillement de pointes d’acier,
un écho d’hymnes qui en tremblant se perd
çà et là… Enfin se tut l’âpre glacier.
XV
Trois ans attendit le Tartare, trois ans
il guetta l’arrivée des mêmes dragons
aux yeux d’or dessus la crête des montagnes
muettes et nues. Le Tartare voyait,
sans plus de crainte, et sentait encore plus
sa faim et sa rage, et d’une main d’ours, là
il cassait des bouleaux, arrachait des aulnes.
Enfin il vit les yeux des mêmes dragons
la troisième fois, et vint à la montagne.
XVI
Au pied des deux Mamelles de l’Aquilon
ils arrivèrent prudents. Et le vieux nain
malin se hissa, pieds et mains, sur les tufs.
Et il vit au sommet un grand pavillon
comme d’une trompe, et s’y glissa muet :
souffles perçut, et vit des yeux de hiboux.
Un nid immonde remplissait tout le creux
de cette trompe. Un grand hibou immobile
s’y tenait, deux touffes dressées, tel un roi.
XVII
Il prit deux plumes, le vieux nain, et se mit
sur un escarpement, agitant les plumes
et appela la Horde, qui attendait :
“À moi, Gog et Magog! à moi Tatars! Ô
gens de Mong, Mosach, Thubal, Aneg, Ageg,
Assur, Pothim, Céphar, Alan, à moi tous !
Il a fui à Rûm, Zul-Qarnayn, ses ferrées
trompettes laissant sur les Mamelles rondes
du Nord, ici. Gog et Magog, tous à moi !”
XVIII
Ô stupides ! Ces trompes n’étaient que terre
concave, par où le vent occidental
tirait, en haletant, des clameurs de guerre.
Ils les brisèrent, méprisants, de la pointe
de leurs coutelas, et des trompes brisées
sortaient des hiboux aux silencieuses ailes.
Ils rirent matois, et vagants par les grottes
burent le sang. Au-dessus d’eux un muet
vol de songes vains, et les cris de la nuit.
XIX
À la grande Porte s’arrêta la foule :
entre le couchant et eux était le bronze.
Gog et Magog le heurta d’un effort seul.
La barre se plia après une longue
torture : la Porte longtemps grinça, dure-
ment, et s’ouvrit dans un clair vacarme d’or.
La Horde approcha du seuil, et vit la plaine,
les cités blanches sur les rives de fleuves,
et blondes moissons, et bœufs au pâturage.
Elle entra, bramant : le monde fut son pain.
(1895 – dans Poemi Conviviali, 1904)
Traduction : J.-Ch. Vegliante)
Présentation de l’auteur
- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020
- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020
- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020
- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019
- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019
- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019
- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019
- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019
- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019
- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018
- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018
- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018
- Amont dévers 8 - 3 juin 2018
- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018
- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017
- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017
- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016
- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014
- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013
- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013
- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012