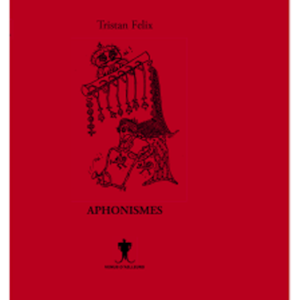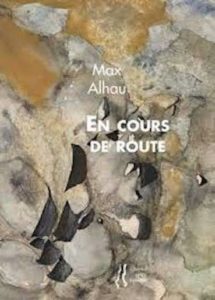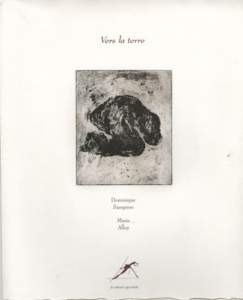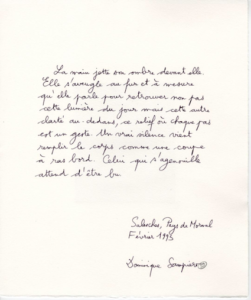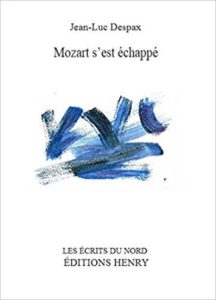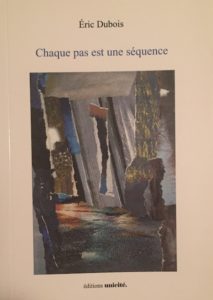Variation poétique, d’après le recueil de Michèle Finck
(Arfuyen, 2017)
chair qui fut royale déchue
depuis l’origine sans retour
le mûrissement de la pourriture
en nous n’est pourtant pas
de notre fait nous qui suivons
las et aveugles ne le répétez
pas à nos oreilles intègres
nous qui suivons l’Indestructible
l’étoile supérieure à toutes
enseigne notre frère pragois
chair peut-être pas pourrie
mais mûre y avez-vous pensé
Michèle Finck amie chère
certainement que oui diable
chair ou corps plus pudique
comme mûri par les éclats pâles
de la lune qui nous garde notre
étoile à nous la destructible
car même la lune est luisante
même elle émet des rayons
qui tiédissent la peau glacée
des cheveux qu’on s’est fait blancs
depuis la prime enfance ô malheur
à la nuque rompue à l’arrachement
du sarment irascible au nerf vif
du dos cave à l’armoire des reins
de la déchirure aux rets des pieds
de bien faibles consolations
mais qui font tout notre bien
notre plus grand bien
ariston anthrôpou khtèma
car ils portent avec eux le sort
humain depuis son émergence
la douleur c’est le savoir absolu
là-bas derrière la fosse orchestrale
les feux roses brûlent impatients
qu’ils sont de révéler l’aube aimée
dans la gloire immature insouciante
vous en souvenez-vous pour ma part
il ne me reste en bouche qu’un crissement
de sable de corne évasée par les averses
si courantes en automne hiver en Alsace
et même alors je me réjouissais de la richesse
des schistes et des micas aux reflets lapis
des feldspaths délicats aux éclats lazuli
leur histoire ancestrale est éblouissante
quelque part oui ça mérite je ne sais ça
mérite considération du moins respect
ce onze octobre deux mille dix-sept
nous nous sommes écrits avons je crois
pensé l’un à l’autre ça se produit entre amis
je vous ai dis que je lisais votre livre je m’excuse
j’ai menti lui me lisait votre livre comment
pouvais-je vous le dire à ce moment c’est lui
qui me lisait oui lu par votre livre qui
ne raconte pas mon histoire il ne raconte
rien que le chemin d’une recherche
une certaine image de votre chemin
et ce soir les voix tapant de l’intérieur
de mon armoire ô siège antique de l’âme
le souffle tapait désirait sortir mais pas
demain non ce soir même alors j’ai
ouvert ses deux battants bouche ouverte
mon souffle a commencé à sortir
et c’était naturel et bien consolant déjà
pour celui qui est aux prises avec le temps
ses rudiments de frustration
et ce texte est né ainsi en écho au vôtre
pousse modeste au pied de votre arbre
poussée grotesque du printemps en plein
automne on se rappellera cette lumière
lu par votre livre j’y opposais au livre
Connaissance par les larmes c’est le
nom de ce livre qui est vôtre devenu mien
par la magie de la lecture de l’amitié
et du sel venu de l’Indestructible et déposé
fardeau de la lune dans le bac d’eau glacée
sur notre langue en gage de survie
l’empathie la sensibilité le cri humain le cri tu
lu par lui donc je lui ai opposé des notes
directement écrites au crayon sur lui
le livre papier pas le livre image ou le Livre
oui borner les vers et les phrases
déjà bornés par les pages les marges
et les syntaxes pesées et déposées
par vous dans ce lieu étroit des feuilles
comme présents lunaires au temple vide
mais c’est ainsi que je suis rentré
en lui que le vôtre est devenu mien
à mon humble mesure de scribe nubile
il est une lumière blême reflet opaque
de l’océan qui jadis fut indigo
jaillie des abysses jusqu’aux maisons
de petits villages méditerranéens
elle les encadre comme des peintures
d’un bras de bronze d’un œil émeraude
fait de leur blancheur lumineuse
un appel alarmant à la déchirure
plus bas bien plus bas sur les récifs
parmi le bouillon tourmenté des algues
le bris terrible des brisants aiguisés
appel doublement alarmant fascinant
il n’intime guère il chante comme sirènes
à l’oreille un chant doux comme le miel
tendre comme une brise apaisée
partition radicale d’une consolation impossible
que peut-on opposer à ce cri
alors que nous sommes nus démunis
et qu’il n’est que l’écho d’un chœur dense épais
comme la rangée des vagues du large
chevauchant jusqu’à nous misérables
que peut-on opposer à l’écho de l’écho à
l’épiphénomène de l’eau à l’épi fait noumène
les maisons blanches sont devenues
par lui seul des chaudrons vif-argent
implacables des agents de la rage animale
la nature s’est faite paysage comme encadrée
dans un bord duplice une toile tendue
les couleurs survivent mal dans le pays
devenu monochrome elles ne sont plus
que les soubresauts les résidus d’un monde
vaporeux lisse comme une soie lisible comme
la lisse lavande des environs de Grignan
où l’air l’eau la pierre se mêlent en même vapeur
dans un tel pays de plomb les beautés
ne sont pas plus rares mais plus brutales
les rouges suintent des angles des pierres
d’aigres verts perlent des chemins poussiéreux
quant aux jaunes ils brûlent les commissures
gouttes acides presque transparentes
du moins c’est l’impression qui nous saisit
lorsque tout s’effondre alors que tout continue
et au même rythme sans nous tout simplement
cette ivresse polyphonique porte
un nom ou deux que je tairai ici
que peut-on opposer à l’effondrement
sinon l’effroi pied tâtonnant courageux
devant le chemin inconnu la piste chaude
le sol tremblant sur la lave du mercure
que peut-on donc y opposer sinon
ce parcours doublement incertain
par son biais comme sa visée
en direction de l’Indestructible
regard dans le lointain l’ouverture
insurrection des algues lacrymales
qui dansent quelque part dans
notre œil aveugle de l’intérieur
œil sans paupière à laquelle
il manque les cils
parcours mystique bien sûr
harassement sur des chemins qui
nous appartenant croit-on
se dérobent sous les pieds les mains
tendues vers les morts qu’on a aimés
les vivants qu’on a perdus désolés
expérience gnostique connaissance
rhénane méditerranéenne universelle
impalpable de la vie par la douleur
je le disais savoir humain absolu
fil d’Ariane tenu envers et contre rien
d’autre que notre soi tout entier contenu
dans ce que j’ai toujours nommé la Source
un grand bassin de larmes accumulées
en soi depuis l’origine larmes contenues
sans issues sans sorties possibles
comment supporter cette double peine
mais l’intuition la confiance seule
est salvatrice elle nous mène alors
avec la main de Béatrice la voix de Virgile
dans la spirale de la révélation consolante
l’or brille quelque part sous le
champ de couleur de Nasser Assar
allons-y voir allons vers l’aube
avec des pattes de mouches insignifiantes
des grilles à peine des filets de paroles sur
votre livre autour de votre bouche d’abord close
j’ai ajouté aux vôtres à vos châteaux mes briques
de sables au milieu de la marée montante
de la mer mariée au chagrin mêlant
sel et larmes que rien n’endigue
là-bas le large dit-on son bruit son silence
l’effroi de ses apnées tropicales
là-bas en coulisses le large investit
la chambre sonore de Neptune
y gronde comme cent mille hommes
ou dix mille tritons venus pour frayer
de là où nous sommes en bout
de course sur la plage de nos heures
comme les enfants réduits à des traits
s’éloignant sur la bande de sable
dans le poème d’Yves intitulé Le nom perdu
ces mélismes inquiètent jusqu’à nos pleurs
qui roulent en nous par chariots entiers
chariots charrient nos chairs filandreuses
sans que l’issue ne soit barrée Michèle
l’issue rêvée aux larmes contenues
dans le bassin éternel de la Source
l’issue le large l’issue le large
se répète-t-on sans fin abandonnant
ainsi l’œuvre du cheminement
le cheminement sur la plage infinie
de Dunkerque des Landes
de Vendée de l’Érèbe
vers l’issue l’issue c’est le chemin le pas
qui accroche la plante des pieds au sable
et la mer alors c’est le miroir
que fabriquait notre père à tous
y baigner notre blessure saignant
dans la Blessure originelle
petit trou au côté du néant
le geste d’y baigner seul fragile blessé
thalassothérapeutique
devient la mer de larmes qui submerge
court-circuit circuit coupé court
canal lacrymal sectionné
par le choc indicible par la
somme impitoyable des chocs
addition des peines coupe la langue
chemin triplement coupé
chemin de la vie des larmes de la poésie
triple peine paix péniblement empêtrée
dans les jalons sans gloire des sanglots
court-circuit demande alors
quel est le plus court chemin
entre deux point entre
nous poussière minuscule et
Dieu point culminant
que dire laissé sans voix
sous le joug du silence sotto voce
les larmes sont faites pour
les chagrins pas les ruines
canal coupé court-
circuité ne put plus
pleurer depuis lors
dit-elle à peine retenue
par les cristaux de sel
en elle par la mer déposée
cri alors retenu en arrière
de la bouche du cœur du bassin
quelle forme de vie demeure
pour l’humain privé de larmes
ou bien
survit-on vraiment à l’excès de chagrin
ou bien
garde-t-on visage certes
on ne meurt de rien dit-on
la grande question sans réponse
l’énigme de la douleur
sans cesse posée par la poésie
la connaissance jamais acquise
toujours recherchée par les larmes
leurs méandres traçant sur nous
la carte le delta de notre humanité
atterrée d’être née
atterré d’être né
atterrés d’être nés
je connais si bien cette joie folle
de ressentir enfin les larmes
reprendre le chemin des joues
confirmer notre humanité
indicible bénédiction des larmes
n’est-ce pas je sais la
joie de la quête mystique
de la connaissance par elles
chœur bouche fermée
le cri est initial pas le silence
né de cet atterrement
faire d’emblée silence
comme si ça n’était pas imposé
se taire pour s’élever
construction verticale du
poème initial
initiumou initium
les maîtres lecteurs du Livre
ne peuvent trancher
verticale au mot unique
un mot par vers
mot-vers vers-mot
pourtant l’Unique pur est dédoublé
car deux fois apparaît Dieu
en troisième place trinitaire
et antépénultième place trinitaire
dans une parfaite symétrie
quinze vers d’un mot-vers
deux fois sept vers-mots
dans chacun Dieu double face
Christ punitif et Christ rédempteur
Dieu tout-puissant et Dieu fait homme
tel le Christ Pantocrator
du couvent Sainte-Catherine
deux fois sept mots autour
de la connaissance autour de
l’arme ultime de l’humanité autour des
larmes
poème Hors
douleur totale
douleur motrice de l’écriture
écriture est poésie
écriture chemin de connaissance
poésie est connaissance
poème est larme
voix est regard
plus de larmes
sont brûlées
plus de larmes
sont gelées
dites-vous
identiquement
à l’époque je n’avais pas
de plus vif désir que celui de pleurer
joie mariale liquéfiée
j’entends de pleurer dehors
plus à l’intérieur de soi
pour accroître inutilement
le volume du bassin des larmes
douleur non coulée non dites
autoraugmenter le volume
et plus le bassin de larmes
poème Soif
vie nue exposée sacer
père mère ami laissés
dans la laisse de mer
échoués ensemble
trop tôt avant le point
de fuite de la plage étirée
singbarer Rest
quel est-il
une variation Lacrimosa
cherchant un chemin
à emprunter
on y progresse les étapes
du calvaire se succèdent
un second chœur bouche fermée
un troisièmeet cetera
à chacun à chaque station
chaque tableau la couleur
et la parole anamorphosées
la vérité qui se resserre
moins lointaine
anonyme et universelle
l’anonyme est universelle
l’énigme demeure mais
la parole lentement se
libère des amarres
analusislançaient les capitaines
dans les ports hellènes
la mer devient praticable
le large regardable
l’œil l’affronte avec l’oreille
la musique fredonne elle
est née du silence elle
ne s’éteindra pas on ne
meurt de rien voyez-vous
isométrie polyphonie
mélomanie symphonie
le poème questionne
encore et toujours
les mêmes énigmes
s’y confond comme on nage
dans la mer sans y avoir pied
le poète questionne
encore et toujours
les mêmes borborygmes
oui c’est ce qui se produit
le chanoine devient chaman
explore les différentes voies
d’accès à la connaissance
nage entre les dimensions
du rêve de la réalité
de la rêvalité ose
le voyage spatio-temporel
à l’extérieur de soi
chef dessaisi de sa baguette
et de son orchestre
oser vraiment la musique
laurier-rose et laurier-rouge
exactement dit construit
o i é o é o i é ou
fêtes les voyelles comme
fit notre jeune père
fêter la consonne
et délivrer la consonance
sans séparer l’eau du sel
poète penseur et panseur
poète alchimiste et animiste
chanter chanter encore
ce droit
à tous les orchestres
musée musique sont le même
disent encore les Anciens
de Vivaldi à Verdi
de Masaccio à Picasso
en veillant toujours
à passer par le silence
une bouche mi-close
avec sa bouteille bue
un jour renait le printemps
de la mort nait la vie
suggère cette fois le bon sens
avec sa bouteille pleine
la bouche en fleur
n’appartenant à personne
redevient nôtre et refleurit
anonyme universelle
nourrie par la terre d’exil
sur notre souche
morte de sécheresse
jusqu’au prochain hiver
qu’on passera lui aussi
sans assez de larmes
qu’importe nous
nous retrouverons au large
portés par l’esquif
de nos frêles musiques