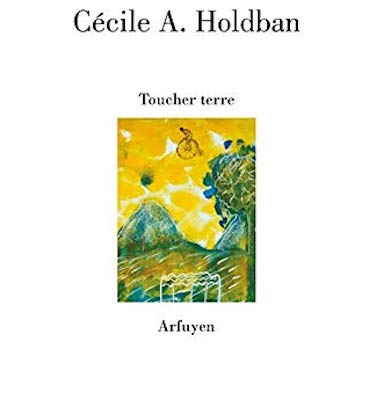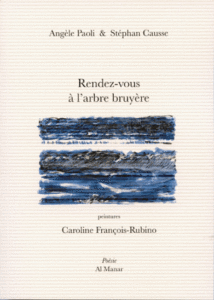1)
Le pays d’ici.
Ici, la nuit est sombre, parfumée et la petite route, parfois inondée de lune pour une balade improvisée – la
maison, posée au bord de la Voie Lactée.
Ici, l’on écoute le silence : bruissement de ce jet d’eau végétal qu’est le tremble, roucoulement des
tourterelles turques, froissement d’ailes dans les feuilles touffues, appel plaintif de la hulotte, friselis des
maïs séchés sous le vent…
Ici, la fenêtre ouvre sur un coteau brodé de vignes hautes et sur le méandre de la départementale, qui s’étire
en pente douce vers le clocher.
Ici, les petits chemins mal goudronnés portent en leur centre une ligne herbue, parfois hachée, parfois ornée
de touffes vertes, et, sur leur côté ensoleillé, un double feston, tout noir : l’ombre des fils du téléphone.
Ici, au détour d’un virage grand ouvert sur l’espace, c’est l’horizon à nu qui soudain vous saisit… et le cœur qui bondit !
Août.
2)
Un grand vent de soleil et de feuilles naissantes promet, entre les frênes, la vie légère !
La lumière danse et éclabousse. La lumière nous invite au bal !
Avril.
3)
Il est midi.
D’un long trait de silence, un oiseau bien peigné s’élance, du toit de tuiles à l’arbre. Seul, bruit le tremble :
son bruit d’eau rafraîchit.
Et l’instant se blottit dans l’abri bleu du ciel comme, dans le corps, la joie.
Juillet.
4)
A contre-ciel, le tremble ne bruit plus – ses feuilles d’or frais sur le pré vert éparpillées.
L’été s’en va contre un ciel bleu rosé. Lentement chutent les feuilles ensoleillées : cérémonie discrète, léger
bruit sec. S’annonce le temps du dépouillement.
Tremble sois-tu – et de bois vert : à toi de bruire en tes feuillets.
Septembre.
5)
(Platanes, ce qui n'est pas dit)
Plus que jamais les feuilles au long des fûts s’élancent - en un élan d’or transparent, de temps secret –
vers la lumière qui les aimante.
Octobre.
6)
Arbres d'hiver, maisons de branches dans les airs, en transparence sur le haut ciel.
A leur pied, un tapis de chaumes, roux à peine au ras du soleil.
Agile, l’enfant-cœur y grimpe et contemple, à califourchon, les drapés d’ors du couchant.
Janvier
7)
Plaqueminier.
Immense dans le soleil, il rutile en plein hiver. Le regarder est un mirage.
Du levant au couchant, à ses branches étagées, il suspend ses fruits cuivrés, inaccessibles - comme au Jardin
des Pommes d’Or.
Et pourtant il en fait don : sa beauté nous est une arme. Au verger d’ici, il est l’Arbre.
Fi du Dragon : le chemin s’offre à notre allant, de terre boueuse et de plein ciel.
Janvier.
8)
En un instant, le large nuage - taffetas gris luminescent à peine ourlé de feu rosé - s’éparpille et s’éteint sur
le bleu du crépuscule : splendeur fugace qui tout efface.
Divisé, il va son chemin. Seule demeure, dessinée au fusain, l’ossature éployée du grand chêne.
Mars
9)
Plissées avec soin, de petites feuilles - satin vert frais, soleil acide - apparaissent sur les arbres qui jaillissent
en bouquets dans la transparence du ciel, tachetée à peine de frondaisons - légères, légères....
Et nous allons sous les platanes - voûtes naissantes de feuilles fraîches - comme sous berceaux de plumetis
L’encre a coulé dans la lumière.
Mars.
10)
Le tremble a retrouvé ses feuilles, vert jade en forme de cœur : à leur attache un collier, dentelé.
(Ce sont de petits grains vert sombre qui s’ébourifferont en pincées de coton, envolées sur le sentier.)
Que tu sois souffle, pluie d’été ou bruissement - tremble, tu appelles le Chant.
Mai.
11)
Immobiles dans l’air tiède, les frênes aux (déjà) feuillages d’été filtrent le chant du coucou –
qui vient effleurer la lumière sur l’herbe du talus.
En la douceur le temps s’abolit.
Mai.
12)
Frêne aux cinq branches - évasées d’un tronc puissant vers les cinq orients en lyre de chaque jour - donne-
moi ton élan.
Août
13)
Non loin des frênes dénudés, le tremble palpite encore.
A chaque souffle ses rares feuilles ébruitent dans le froid soleil un chant ténu.
Dansent les feuilles qui sont d’or, au bleu le plus clair du ciel, le bleu qui tremble en nos corps
- à jamais nus.
Novembre.