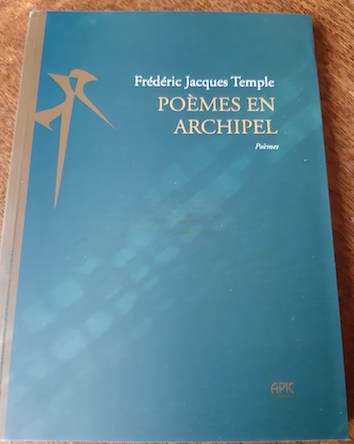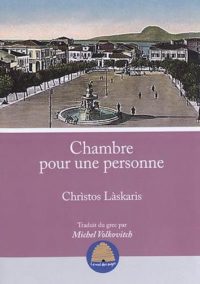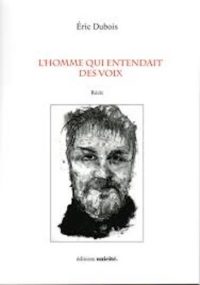Béatrice Machet, Tirage(s) de Tête(s)
Il est des livres qui ont besoin d’être apprivoisés et qu’on laisse volontiers murir dans les chais pour pouvoir, parfois beaucoup plus tard (ou jamais), parler de leur robe, de leur couleur… Le livre de Béatrice Machet, au contraire doit être enfourché avec fougue sur un coup de tête.
La première idée peut être d’aller chercher un sens, au titre pour commencer : tirage, est-ce le fait de tirer pour dégommer comme à la fête foraine, d’allonger, ou celui de déplacer pour déclencher un mécanisme, probablement un peu des deux à moins que ce ne soit carrément autre chose. Chez Béatrice Machet, le poème nous oblige à nous positionner autrement, à accepter le déséquilibre. La multiplication des néologismes nous fait entrer de plain-pied dans un univers singulier.
Si vous avez une idée derrière la tête, mieux vaut la laisser au vestiaire sinon vous serez plumé, et le bec et la tête, alouette… Pour Béatrice, il faut que ça chante et pour ça, y’a du plexus dans l’air. Il faut aussi que ça s’agence, se connecte, même si les liens sont lâches. Elle est là pour retendre. Il faut que ça frictionne, que les mots-silex fassent fuser dans la tête – cette fois, celle du lecteur – des lueurs, des images, sens dessus-dessous.

Béatrice Machet, Tirage(s) de Tête(s), Edition Les Lieux-Dits (les cahiers du Loup bleu) - 2019.
ça pulse aux tempes______tambouriné le
questionnement tout le temps recycléessoré à 1800 tours
minute
Si vous pensez avoir attrapé le fil de la pelote, la vitesse de l’écriture vous fait sortir de vos gonds. Raté ! Béatrice Machet avoue d’ailleurs en fin de recueil que la première partie a été écrite « spontanément ». Il faut suivre… mais chacun peut, à condition de renoncer aux « pourquoi », trouver dans cette construction verbale qui tourne en orbite dans la tête de l’auteure, trouver donc, analogies à sa taille et convergence des consciences. De toute façon, il est clair qu’il n’y a plus de question à la réponse que vous exigez.
Écriture, lecture, dans un vertige communicatif. Tu crois que ce que je crois, c’est ce qu’elle croit… ou voulu dire ? C’est une drôle de géographie qui s’immisce dans le discours et l’humain s’y débat sachant que
contre les vampires insatiables une couronne
un bonnet un chapeau une capuche : C’est top
frivolité le couvre-chef
mais ne dit-on pas que la
dignité se mesure au port de tête…
À tue---- comme
martel dans l’air sous mon crâne sa chambre
d’échos sent le brûlé par de quoi s’étonner
L’histoire qui n’en est pas une dit peut-être aussi ce qui se passe dans la tête de l’auteure mais est-ce bien elle
cette linotte bien faite qui veut du vide
n’a pu fermer la tête de la nuit
Cette première partie intitulée « Entre » : 16 petits objets scriptés autour du mot-prétexte « tête », à décrypter, ou pas, sans attendre. Le temps est court.
***
Béatrice Machet nous dit ensuite que la deuxième partie du recueil a été écrite après la visite dans l’atelier de la sculptrice Dominique Assoignon-Coenen. « Headquake » (formé d’après le mot earthquake qui veut dire tremblement de terre en anglais), tout en conservant le prétexte de tête, intègre l’impact de cette rencontre.
Qui connaît Béatrice Machet, pourrait presque dire que ça commence comme un autoportrait, puis rapidement des images s’imposent et introduisent le travail de la sculptrice :
Au rabot à la lime
raclement d’ombres concentrées avant
d’exploser au cœur de la nuit dans la tête les
ombres qui ont des mains jusqu’au sang et
des poignets à échanger
Qui connaît l’œuvre de cette artiste, peut comprendre que sa très grande humanité ne pouvait qu’entrer en résonnance étroite avec celle de Béatrice.
***
Mais attardons nous pour finir sur la phrase d’Herman Melville qui se trouve en exergue et que nous avons passée un peu vite pour nous jeter dans les poèmes. N’éclaire-t-elle pas la direction « universelle » de cette course ? Les questions « raisonnables » ne s’arrêtent-elles pas au seuil, à l’inconnu de la mort ? La conscience se débat en essayant, et c’est tout le propos du livre, de poser, avec philosophie ou ironie, les bonnes questions sur la vie.
À lire, sans prise de tête.