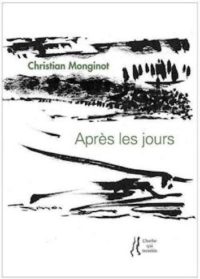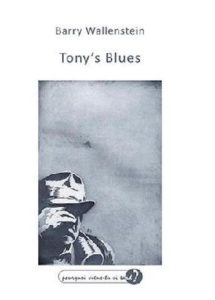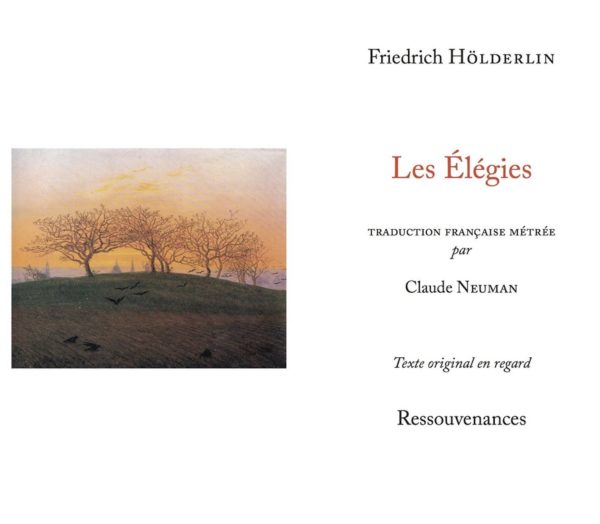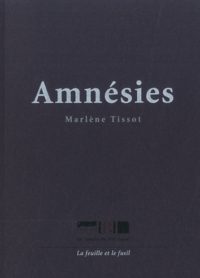Jean-Luc Maxence, Tout est dit ?
Pour défier le temps et les rides
Et les hirondelles fatiguées de aissance
Pour défier le suicide de nos gosses
Et les trahisons des faux-frères de l'ombre sans logement
Pour défoncer les yeux des salauds au fur et à mesure
Et saluer le soleil de l'amitié et la panne de l'horloge
(…)
Marions-nous cet été
Marions-nous jusqu'à la mort !
Viendrait un âge, pour les poètes comme pour toute personne publique, de délivrer des sentences présumées sages. Conclure, avec l'ambition d'entrer dans une anthologie des derniers mots célèbres. Un conseil : refermez le recueil et revenez longuement sur le point d'interrogation du titre. Tout est dit ? Prononcez-le comme il sied, en dressant votre voix vers les aigus. Posez-la, cette question, aux oreilles délicates qui préfèrent l'atone, posez-la aux villes chatoyantes, posez-la au ciel ! Tout est dit ? Vraiment ?
Le livre commence par une « interdiction de mourir ». En grandes capitales, comme une grande peine qui fanfaronne en disant « même pas mal ». Manière d'exprimer le mélange inextricable de vieillesse, de fragilité et d'ardeur : Ô ma douce toute violente devant le Feu… Jean-Luc Maxence récalcitre, tonitrue :

Jean-Luc Maxence, Tout est dit ?
Le nouvel Athanor, 2020, 64 pages, 15€.
Paris pue le carton-pâte
L'espoir et poitrinaire…
Mais sans jouer pour autant le vieillard ronchon, car il souhaite une vraie jeunesse aux suivants, une belle jeunesse :
Alexis
N'écoute personne
Ne crois pas
N'écoute que le vent
Ne cherche qu'en toi-même
La route ascendante
À ceux qui rêvent de nous endormir à coup de sédation et de fins de vie apaisées, le poète oppose le pas-sage, une étroite porte où la colère se frotte au désir et au sentiment du temps. Où le rire lui aussi joue des coudes parmi les peurs et les emportements :
C'est peut-être Madame la mort qui fait une carte bleue (…)
Je ne sais plus rien du bon Dieu et de son fiston
Foin des envolées juvéniles, loin des nostalgies débiles : retour au tragique ! La révolte de l'homme contre sa condition d'homme qui est la condition-même de son humanité. Écoutez cette nique au destin :
Nous n'avions peur de rien
Ni du soleil ni du diable
Ni d'être trois à nous aimer
D'ailleurs, ces mots de « soleil », de « diable », d'« aimer », j'ai l'impression de les relire, rafraîchis, sourdant du grand affadissement de la langue qui avait fini par me gagner !
L'eau n'est plus au rendez-vous des baptêmes
Pour sauver le monde et mon amour
Le paradigme inédit du petit matin
Fait chanter la source des Chevaliers du Soleil.
C'est un des derniers poèmes. Son titre : De quelle source parle-t-on ?