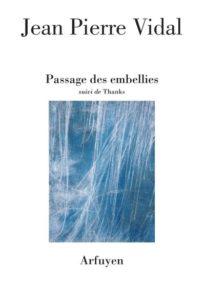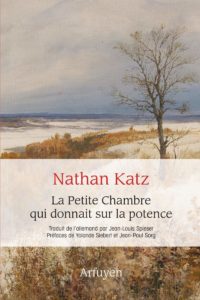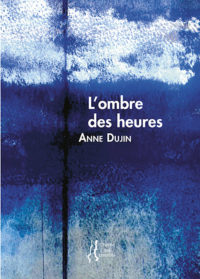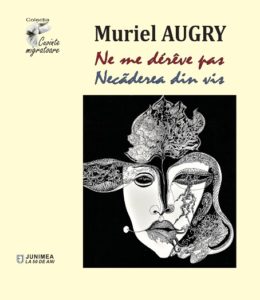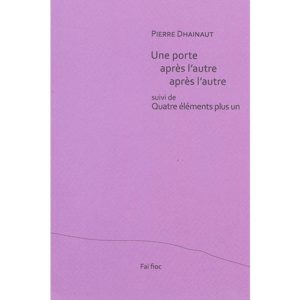"Terminer ce recueil", qui ne se finit pas, parce que l'appel à la réunion est ce qui ouvre, à la fin des poèmes, après les quelques pages rouges dans lesquelles Sabine Venaruzzo exhorte au rassemblement :
Poétons ensemble
Ecrivons le poème universel qui rassemble nos parts
d'humanité
Naissantes et naïves, éclatées sous les bombes, rassemblées
dans la rue, calibrées espace vital, aimantes et sauvages,
arrêtées dans des camps, couchées réverbère, irradiées cellulaires.
...
Et maintenant. Avec toi. Notre attente contre toute atteinte est
en mouvement.
Ces pages rouges qui précèdent l'invitation à venir participer à l'élaboration d'une fraternité poétique entrent dans le regard, épousent la chair, empruntent la matière de nos âmes. Une couleur qui ponctue les pages du recueil, où quelques photos de la poète habillée et masquée de rouge, gants de boxe compris, prend des poses différentes, puis où le gant de boxe seul apparaît. Rouge, symbole de danger, et de combativité. Un combat qui est celui que Sabine Venaruzzo mène pour la paix.
Dans la première partie du recueil, les poèmes disent ce qui sépare, évoquent la violence qui règne sur cette planète, signe d’un échec patent de nos sociétés à élaborer un quotidien porteur d'épanouissement. Tant d’aberrations, tant de haine, tant de schémas cousus de peurs et de désagrégation, de violence et de geôles, sont énoncés. Comme on visite un édifice en péril la poète ouvre des portes qui dévoilent les espaces de tous ces échecs de l’humanité.
J'ai le cœur Bagdad
A Aya Mansour
Texte paru dans l'anthologie Rouges
aux éditions de l'Aigrette
Sur le chemin rouge des frères abattus
Des corps renaissent dans une herbe folle
Des silhouettes s'enlacent
Et s'entassent
Et s'aiment
Dans l'infinie racine du temps
Puis les pages rouges, présentes déjà dans les aplats de couleur qui ponctuent les photos. Il faut agir. Nous sommes invités à participer, à rejoindre nos frères humains. Là impossible de refermer le recueil, comme à chaque fois, comme cette sempiternelle cérémonie, fermer le livre, le poser, ému ou pas, ou de moins en moins, et reprendre le flux de la vie, inepte à force de pertes inouïes de toutes ces valeurs perdues dont la plus époustouflante est la fraternité, l’universalité de ce que peut et doit être l’humain.
Et enfin ce "lieu dans le livre" que sont les quelques page qui ferment Et maintenant j'attends. "Terminer ce recueil en vous faisant découvrir d'autres passages aux actes poétiques", pour fermer l'ouverture, ou ouvrir la fermeture sur un horizon qui appelle un avenir commun édifié à partir de ceci, une communauté humaine enfin fraternelle. Des codes QR invitent à écouter les poèmes dits par l'artiste, et l'adresse de son site internet est là pour recueillir des propositions, des textes, des mots, des présences, des énergies prêtes à participer à l'élaboration de la suite, poétique, donc inscrite dans le quotidien, l'engagement, le désir de vivre autrement. Ce qu'est la poésie, en somme, et l'essence même de sa raison d'être.
Sabine Venaruzzo montre le seuil d’une possible unité entre les mots et le silence d’un imaginaire, celui de l’auteur lorsqu’il écrit pour cet indéfini lecteur, celui du lecteur lorsqu’il suit le poète et espère partager le souffle dans les mots. Elle attend, maintenant, parce qu'elle le sait, c'est l’heure d’aller plus loin que pleurer ou s’indigner dans son coin, maintenant est le moment de la réunion de ceux qui son prêts à avancer vers demain. Ceci n’est pas un livre, c’est une porte, de même que "Ceci n'est pas une préface", très beau texte écrit par Marc Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre qui ouvre le recueil, . "Pas une préface, mais une missive, ouverte" comme l'est ce recueil, jamais terminé, parce qu'il est ce seuil d'un territoire humain nouveau, il est le signe du début de ce voyage vers notre unique pays qu'est la Terre.
"Poétons ensemble
Nous sommes tous faits de la même roche, de la même terre,
de mêmes cellules, de sang rouge.
Nous sommes tous inexorablement liés et reliés.
Ainsi sommes-nous.
Ainsi suis-je.
Ainsi es-tu.
Ainsi soit-il.
Amen.
Rouge est le visage masqué mais dessous est celui de la poésie, qui reprend contact avec ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une porte ouverte vers la réunion des humains, vers la communion et le partage. Ce visage, nous sommes invités à le dessiner dans ce recueil, dont il faut saluer l'immense qualité, et pour lequel il faut remercier les éditions l'Aigrette, éditeur engagé qui continue malgré cette terrible période à porter la Poésie, et à rêver qu'elle sera le chant de la victoire d'une Babel écroulée.