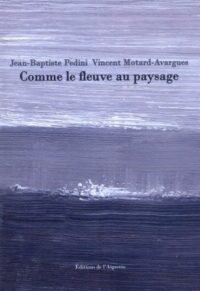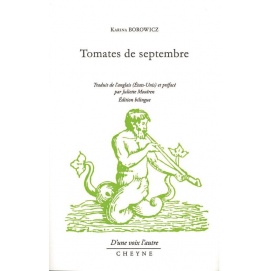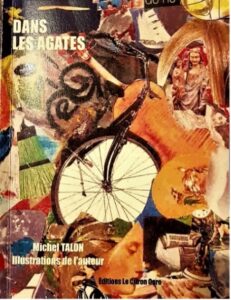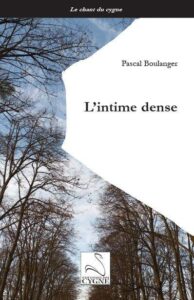La gazette de Lurs n°46
Avec un édito qui vaut la peine que l'on s'y attarde, La poésie sauvera-t-elle le monde et un hommage à Jean-Pierre Simeon La Poésie sauvera le monde, La gazette des Lurs de François Richaudeau, avec pour rédacteur en chef Jean-Marie Kroczek est une publication à saluer.
Avec une ligne éditoriale absolument superbe, cette revue met à l'honneur des voix contemporaines portées par des typographies originales qui s'étalent sur de larges aplats de couleurs saturées. bravo, on a envie de regarder, de feuilleter donc de lire, comme pour plonger dans cette univers qui existe là dès avant de prendre connaissance des articles.
La maquette de ce numéro a été confiée à Maxime Plantey, jeune graphiste "tout juste diplômé et en recherche d’emploi", nous apprend le message qui accompagne l'envoi de la revue. Et bien bravo à lui, c'est un très beau numéro !
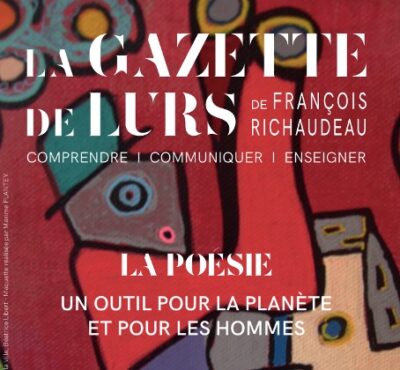
La Gazette des Lurs n°46, mars 2021.

Béatrice Libert signe qui clôt le numéro offre une sorte de conclusion à ce feuillet épais dans un article qui titre La poésie sauvera l'homme. Comme une réponse à la question liminaire, la plume de la poétesse assertivee et vive cite Salah Stétié : "Le rêve est "le seul pain indispensable de tous les hommes, partout"".
Cette revue n'hésite pas à évoquer des problématiques actuelles, et à placer le débat sur fond des confinements et des empêchements dont la culture et de facto la poésie ont subit le poids écrasant. Brigitte Maillard, Michel Capmal, Yvanne Chennouf, signent des articles pour le moins intéressants. Cette dernière dans "Une langue à soi depuis la langue commune" nous parle de ses projets de lecture et d'écriture avec des enfants.
Un autre court article nous propose de (re)découvrir un poète disparu, "Paul Arene. Poète provençal. Pratiquement inconnu" .
A ces paysages contemporains s'ajoutent des propos qui considèrent la poésie dans son historicité. Le mouvement post Dadaiste est évoqué par Alain Le Métayer, non sans originalité dans "Des expériences limites : la poésie post dadaïste". Il conclut ce tour d'horizon en citant Robert Filiou : "La poésie est ce qui rend la vie plus intéressante que la poésie".
Bravo donc, pour cette revue qui est belle, disons-le, et qui change des publications habituelles par sa tonalité. Moins conventionnelle, moins protocolaire, elle n'en offre pas moins un contenu éditorial de très bonne tenue !