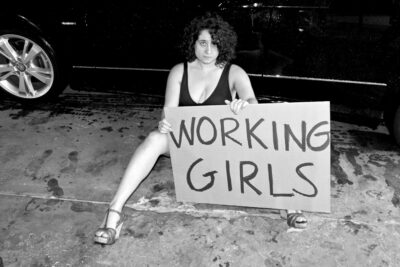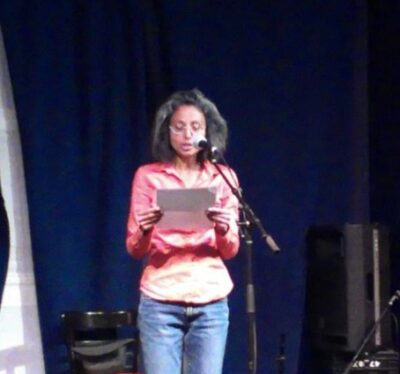Cathy Jurado, Hourvari, extraits, Forêt je suis venue
J’ai d’abord visité un ventre nocturne
(il ne m’en souvient pas)
avant que de venir parmi les neiges
chasser
si maladroite
avant que de changer tous les plans renverser tous les vases de cristal et crever tous les pavillons
des oreilles délicates
si gauche, cherchant Reina depuis toujours,
j’ai tous les gestes de l’éléphant et tous les cœurs de porcelaine
j’ai sans doute hérité la maladresse et la peur
et peut-être aussi
(de frères et de sœurs oubliés autrefois dans la nuit)
les nidations de papier
au milieu des déserts blancs
qui sait
Sur les cartes numériques des landes et des zones
je suis le point qui se déplace seul et anarchique
tournant dans le sens contraire
des impasses périphériques
et je regarde toujours les femmes en contreplongée
comme un chat dans la foule des villes
une enfant perdue dans la topographie
du grand peuple adulte des espèces
Je me tais jusqu’à m’en faire les lèvres bleues
Je surveille tous mes pièges à loup
Je piste le poème boréal
guettant le gargantexte
je cherche à débusquer Reina
mon enfance est toujours en embuscade
et les forêts d’orage qui tournent-voltent
défont les nids les tissus les paperolles
les paraboles
Mais il y a toujours un petit cheval fou tissé de désir
bouche cousue quelque part dans l’obscur
(là où naissent les lettres d’amour et les forêts d’images et les neiges nouvelles
parmi le souvenir de grands périls)
J’ai cherché aussi dans les villes, parmi leurs réseaux de lumière et de pluie, dans les faisceaux croisés des hauteurs et des rues — abscisses et ordonnées de nuit sonores où l’on croit parfois comprendre quelque chose du monde.
Reina fuyait toujours en avant dans le hasard des huttes humbles, aux abords des chantiers ou des périphériques, dans l’herbe interstitielle traversée parfois d’un frôlement plus proche comme une onde de fourrure.
J’ai cherché longtemps, dans les villes, ce qui aurait pu être aussi ma nature et mon monde. Je n’ai trouvé que la moelle de ma liberté. Le désir est ailleurs ; Reina fuit en avant, dans la nuit de toutes les cités.
Dans les flaques d’eau au pied des cheminées d’usine
flotte Reina comme un grand corps de nuage
sa peau épaisse de baleine bleue ciel
à présent rose vapeur
et la voilà
sa chair immense vaisseau inerte
ventre contre ciel
émergée à peine
sombrant au rythme des jets de sang
chaloupant sur la houle du soir
requins voraces en embuscade
veilleurs de nuit
Reina a fui.
Amarres d’automne
J’ai cru capturer Reina
dans le baiser d’un roi de chair
Inscrivez cela :
Seul, on n’habite que ses limbes
la neige n’est jamais que la neige
le silence une peur
et les corbeaux de novembre un présage de nuit
Il fallait que tu sois là
corps hanté par l’amour
il faut que tu sois là
avec tout ton poème
pour que l’automne devienne une nappe d’oiseaux mobiles
pour que la solitude soit un festin
et la douleur une racine solide
Ecoutez donc cela :
je dirai à nouveau son nom sans le dire
à chaque morsure de ma langue
car c’est te prononcer
toi,
Reina,
averse et sable et pollen
et poussière
Dispersez cette parole encore
sur les routes stellaires :
il est amour le souffleur de vertige
il est la veilleuse sur la table
l'astre portuaire
la voûte de l’été
Annoncez cela :
Nous avons choisi un village et un pont
Comme escorte et caravane.
Nous chassons ensemble à présent
Relevons nos pièges à l’orée des nuits
Nouons nos mains sous la tente d’affût.
A travers les éclipses de la rivière
J’ai longé le chemin des troupeaux
Jusqu’à une forêt aux arches solides.
Tout au bout
Sous les lampion des terrasses
Le soir était un verre de liqueur
Dans la fraîcheur de sa main d’homme
Il regardait venir la nuit
Attendant que je dépose mon manteau.
Reina nous observait toujours depuis la rive.
A paraître en 2021.
2. Forêt
foule dans le dos
On entre ainsi en moi :
houle dans les mots.
Un franchissement du temps
une lisière spatiale.
On progresse
et pourtant on entre toujours par effraction.
Franche frontière lente acclimatation
on
off
comme un commutateur.
On est devant moi
et soudain on est dedans
soudain on est moi.
On me cherche
ou s’attend à moi parfois
mais on ne décide pas de l’instant de mon dévoilement
on reçoit ma nudité
comme un chant sauvage lancé soudain dans le silence
comme un chuchotement de chamane invisible
comme une flèche sans archer
dans les ramifications du désir et de la présence.
Le sentier qui mène à mon corps est fait pour les truffes et les groins
c’est un chemin fraisier qui va des herbes aux futaies
qui part des grandes graminées gracieuses graineuses
— froufrou papillonnant d’un air palpable, danse floutée —
jusqu’aux vertes ombelles
pour mener ensuite aux hampes
aux fleurs en artichauts
aux feuilles basses et rampantes mêlées à des écharpes de feuillages laineux agrippant les souches
puis aux écorces et aux colonnes ligneuses vertébrales déployées tournoyeuses dans le vertige des têtes renversées.
Et à présent le sursaut de la fraîcheur :
les premiers troncs
guerriers
tartares bruns
de grands bans d’insectes et de rayons
tendant leurs tentacules traversés de minuscules poussières de mousses et
de feuilles séchées flottant dans tous les interstices solaires
comme un plancton pulsatile.
Ici l’on sait :
je suis issue des multitudes symphoniques
on me reconnaît brusquement
à l’immobilité vivante de mon corps tout autour des corps
à l’humidité de mon épiderme
transpirant à l’intérieur des papilles des peaux animales qui me traversent
à l’inextricable enchevêtrement des êtres qui composent mon être
à la forme colossale d’un silence tissé vrombissant comme celui des orages
à la surprise de l’ombre architecturale
soudain rassemblée en nuée connectée et courbée voûtée sur les têtes.
Plusieurs mètres au dessus des fermentations court le frisson de la houle chlorophyllienne
— qui ramifie à l’infini et formule ma peau
tandis qu’on marche parmi les rampants et les rhizomiques
les tapis de spores et les résurgences
les courses immobiles de bulbes et de larves à l’odeur décomposée
d’ici on entend le grand ressac dedans la canopée
qui palpite plus bas dans tous mes organes
avec le parfum de chanterelle
— rien ne se limite ou ne s’arrête
tout se relie en moi et se rebranche se reboute
le dehors est dedans
les parfums animaux se compénètrent
mon sol qui brume et bruine et vibre d’insectes
est un ciel inverse
— tandis que les voix limpides des hauteurs se posent sur les souffles en pluies de partitions.
Plus loin les clairières :
dans le cirque baigné de lumière où gisent au sol
les miroirs de centaines de bouches rougies
sous le couvert des hêtres
quelques fantômes minéraux
silencieux
semblent laisser parfois dans ce tapis froissé une empreinte frémissante
une essence
un parfum
un souffle furtif
— à la nuit tombée
ils rappellent que je suis
une liane-tribu.
Je suis venue, extraits
Je suis venue, il y a longtemps.
Je suis née dans les secousses d’un grand chaos
dans les hauts le coeur d’un siècle mortel pour le monde
qui a vu pourrir le coeur battant des océans et des forêts.
Je suis née mourante, seule.
J’ai trouvé la mort au dedans et le chaos dehors
ou l’inverse, je ne me souviens plus.
J’ai trouvé le silence
quand tout un peuple de langues criait à l’intérieur
j'ai trouvé que je ne venais pas avec la même langue
que tous les autres
que j’étais une Babel à moi seule
mais que j'avais peut-être des frères
quelque part.
J’ai trouvé que j’avais une chair
que ma chair demandait à être caressée
à vibrer sous l’amour
quand les autres avaient des gestes en lames de rasoir
et m’absentaient dans leur discours.
J’ai trouvé que le Monde est une boule de cauchemar
roulée par un rêveur que nous imaginons heureux
que le Monde est le crime angoissé d’un dément en cavale
j’ai trouvé
que le Monde est une Méduse aux charmes venimeux
j‘ai trouvé qu’on se salit à regarder le Monde dans les yeux
quand on est nu
et puis
j’ai regardé le Monde
et les serpents dressés
j’ai regardé la Méduse dans les yeux,
je suis restée nue,
à m’inscrire dans les marges du regard sidérant
à écrire hors champ
hors zone
hors d’atteinte
dans les zones interlopes
- écriture frauduleuse
langue clandestine
langue assassine
hors Temps -
j’ai trouvé cela,
cela seul :
écrire, c’est du Temps mort.
c’est tuer le Temps.
et il le faut, parce qu’il nous tue.
dent pour dent.
Je ne veux pas que le temps guérisse
qu’il mette du miel sur les douleurs
et l’eau du Léthé sur les peurs
qu’il fasse oublier ceux qui me quittent
ceux qui rongent le monde de leur avidité
ceux qui répandent la destruction dans l’air et sur les eaux
et le sabre qui me ronge le coeur
je veux travailler désormais à rendre le monde comestible.
me pencher, telle une lavandière, sur l'ouvrage du présent,
faisant jouer les chairs tout contre les forces du monde,
paume à plat sur la hanche, doigts bleuis de savon.
Et puis rentrer au soir, pâle et alanguie,
cheminant par les voies où bêtes et hommes
s'enroulent en un long ruban odorant;
regagner la tanière et la chaude présence,
la soupe et le vin
le fumoir et la couche.
Je veux sentir la lame
parce que c’est vivre
vivre nu
et il le faut
alors tu vois
j’ai trouvé
œil pour œil
la grande croisade contre la mort qui croît et fleurit en moi,
c’est écrire