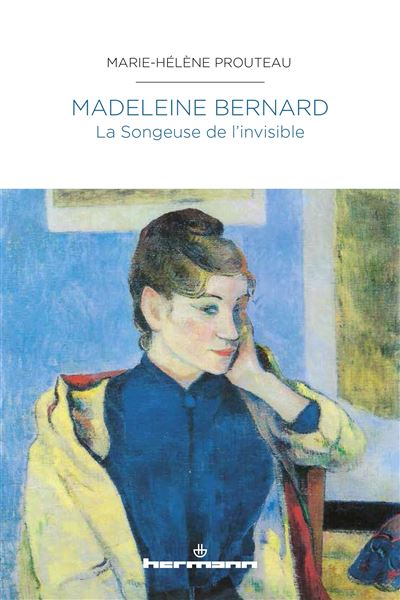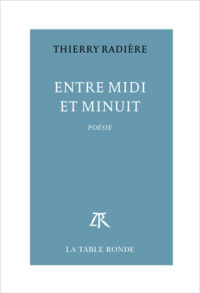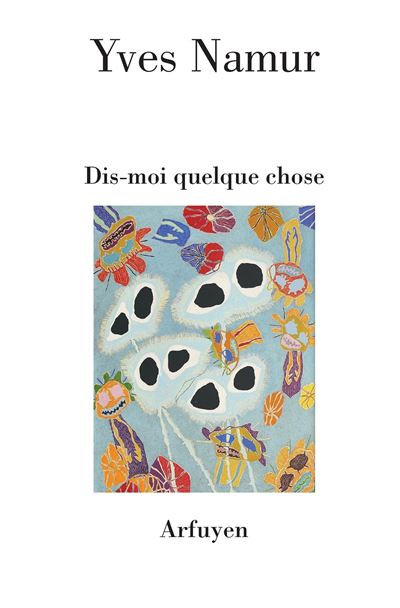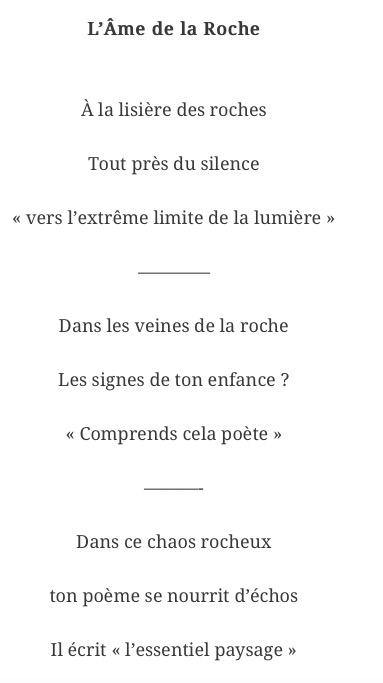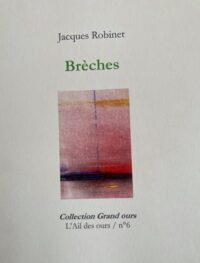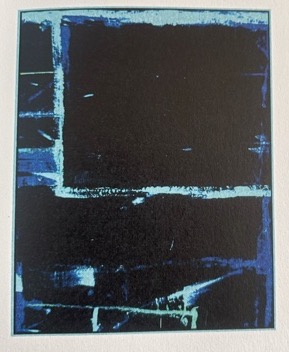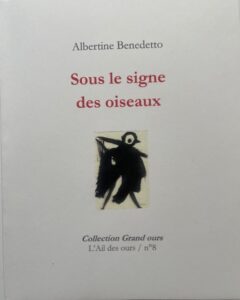Margutte, non rivista di poesia on line
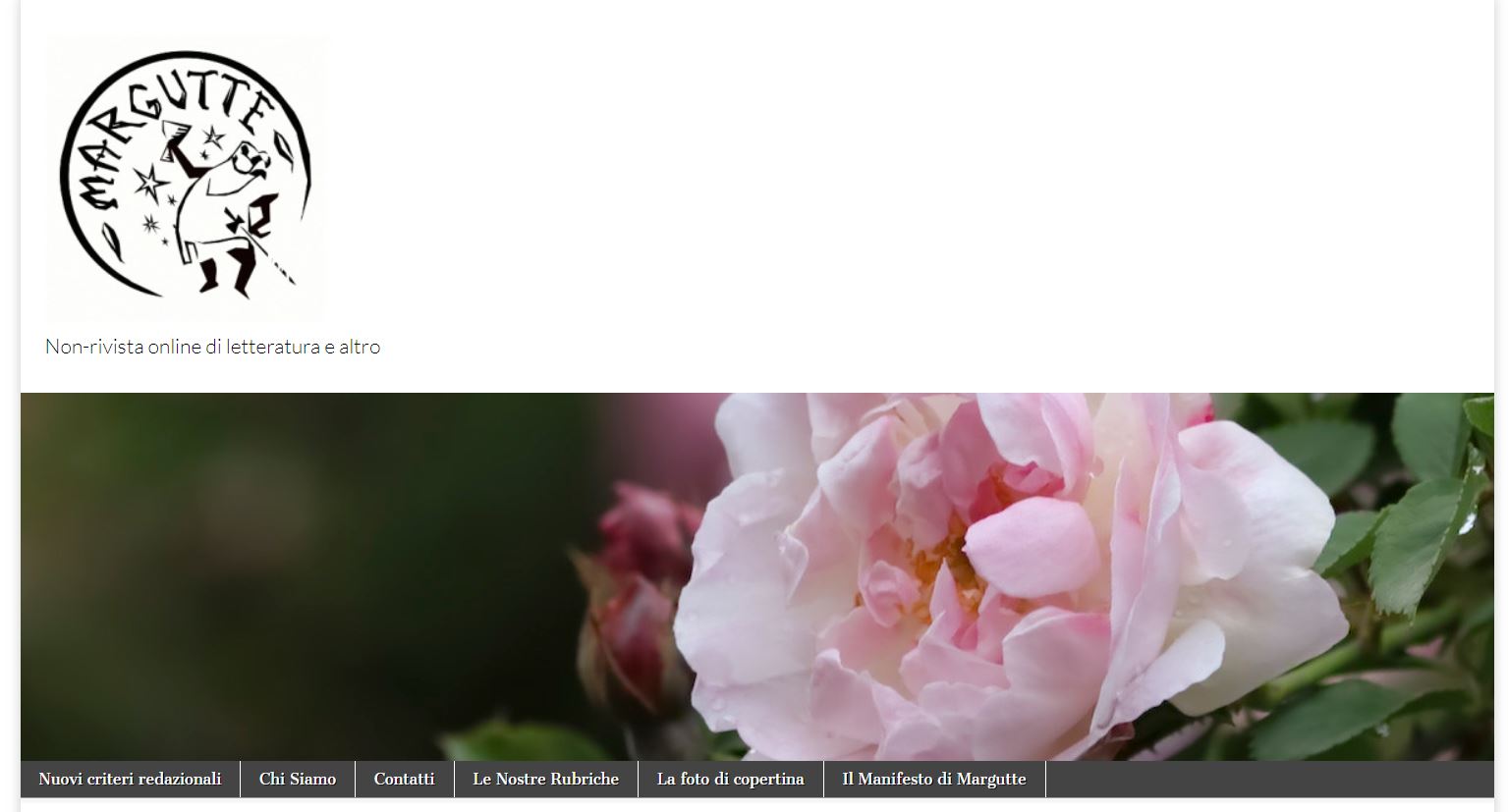
photo : Rinuccia Marabotto
Malgré le titre, le nom des Rédacteurs, Gabriella Mongardi, Silvia Pio, et la ville d'origine (Mondovi), la revue "Margutte" accueille des textes en français, anglais, espagnol, et allemand. Elle est née comme un site ouvert à toutes les formes d'expression artistique, aussi bien les plus classiques comme la littérature, la musique, le théâtre et les arts visuels, que les arts plus modernes comme le cinéma, la bande dessinée et les jeux vidéo. Elle s'ouvre au plus haut point aux contenus d'autres zones géographiques, avec l'ambition de devenir un moyen, à sa petite manière, d'élargir au maximum les horizons.
Le site peut prévoir, à la fois la présentation d'œuvres originales et d'articles de critique et d'analyse des différentes formes d'art elles-mêmes, avec une attention particulière portée aux formes artistiques-littéraires expérimentales privilégiées par l'outil numérique. La revue annonce également que dans la mesure du possible, les meilleurs contenus de Margutte seront transposés sous forme papier dans une publication à caractère épisodique.
Pourquoi "Margutte" comme titre d'une revue en ligne?
Margutte est un géant nain, écuyer de la "Morgante" de Luigi Pulci, un écrivain du cercle des Médicis, qui a composé l'œuvre en 1478 et a commencé avec elle la tradition de la Renaissance italienne du poème héroïque-comique. Margutte est au service du paladin par excellence, Orlando – notre Roland. Les deux recueils où il apparaît, imprimés à l'époque aussi indépendamment, probablement sous forme de feuilles volantes, prennent le nom de "Marguttino".
La référence à la figure de "Margutte" se veut une référence aux valeurs de la Renaissance telles que la centralité de l'homme et l'aspiration à l'utopie sous ses diverses formes hautes et basses, entre la Nouvelle Atlantide et la terre de Cuccagna, d'Erewhon à la contre-culture sous ses diverses formes. "Margutte" est née à Mondovì; un centre apparemment mineur, mais qui avait une noble tradition dans l'art de l'imprimerie à la Renaissance, à l'origine de l'une des premières (sinon la première) traditions du livre illustré typographique. L'un des pôles de cette « autre » Renaissance à valoriser et à redécouvrir, enquêtant sur une tradition de contre-culture. Et en s'ouvrant largement aux contenus d'autres zones géographiques, pour devenir un moyen, à sa petite manière, d'élargir au maximum les horizons.

Logo conçu par Damiano Gentili
Le site est divisé en rubriques :
La valise d'Hermès, sous l'égide de ce dieu, est une partie consacrée aux essais et à la critique littéraire soulignant inspection approfondie d'un texte, sans parler de l'importance de l'hermétisme dans la littérature italienne.
La voix de Calliopée présente la poésie, le règne de Clio les récits, le pentagramme d'Orphée est dédié à la musique, et les chambres de Chronos à l'histoire et l'utopie.En particulier, Margutte veut s'intéresser au domaine de l'utopie, de son épanouissement de la Renaissance au débat contemporain. En cela, Cronos évoque aussi les "Royaumes de Saturne", son pendant latin, que les Romains voulaient être le maître d'un âge d'or dont ils attendaient avec impatience le retour.
On trouve l'art, le théâtre, le cinéma ; la BD, les jeux vidéos... dans l'ambroisie de Dyonisos, les textes expérimentaux et les récits de voyage dans Les distractions platoniciennes , titre paradoxal dont la rédaction explique le choix :
« pourquoi « platonicien » ? En partie, avec un peu d'ironie, c'est vrai pour « utopique », … l'utopie est une caractéristique importante de Margutte. Mais, bien sûr, la référence à Platon est une référence que nous avons voulu inclure comme référence au Monde des Idées, cet espace virtuel hyperuranien que, d'une certaine manière, le web est en train de réaliser.
Enfin, La vitrine de Margutte , née en 2018, la rubrique accueille chaque mois un article sélectionné par la rédaction parmi ceux déjà publiés, pour lui redonner de la visibilité, « non concorso », inaugurée en 2020, rassemble les différentes éditions annuelles du "Non-concours" et « progetto Alberro » est l'espace destiné à accueillir tous les articles de l'"Arbre à Projets" publiés à partir de 2017.
Vivante, variée, ouverte et accueillante , Recours au poème ne peut qu'inciter ses lecteurs à visiter les pages de cette revue, et d'y participer !