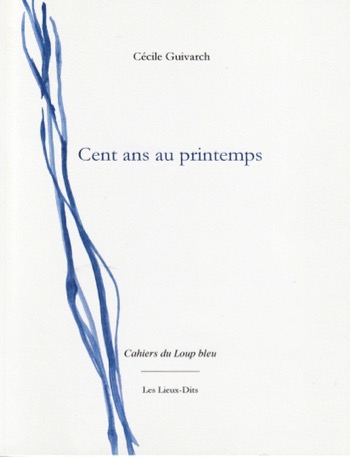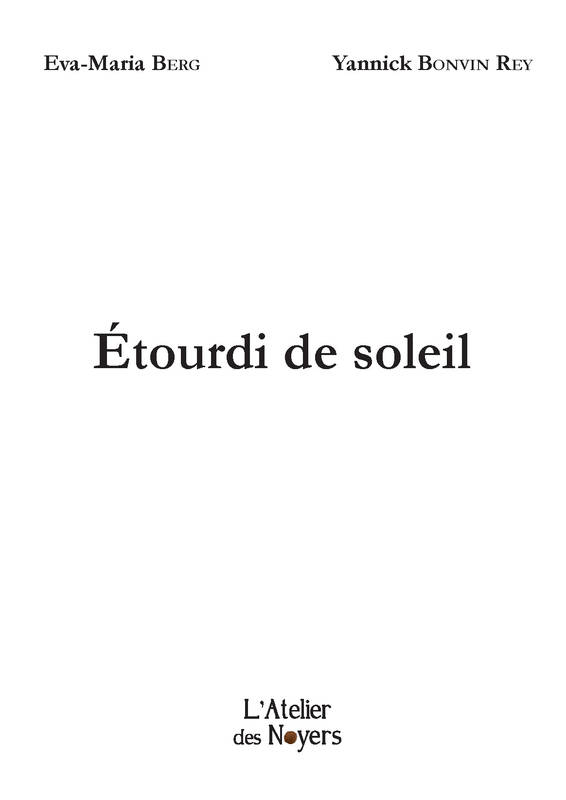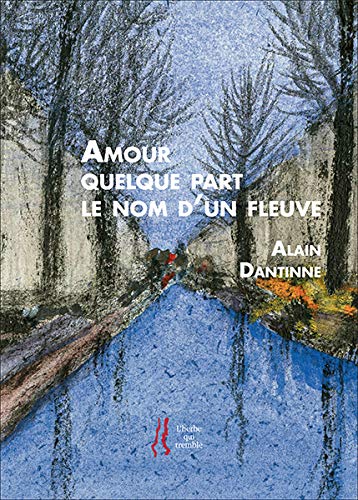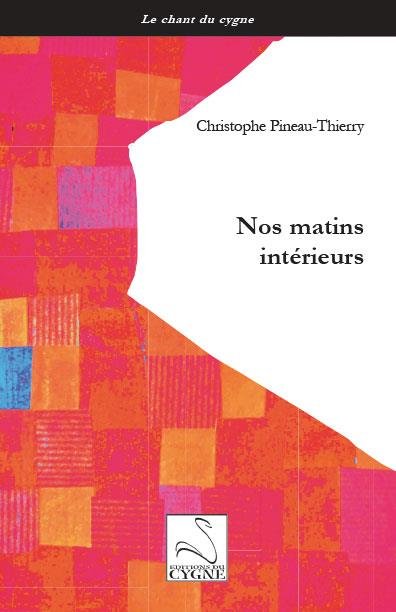Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien
Comme un temps du langage, celui du poème fouillé par les mots, tout dans Je souffle, et rien essore le silence et laisse non pas la sécheresse du néant mais le prodige du rien, qui retrouve son acception ancienne : il y a quelque chose, là, dans la respiration d’Isabelle Lévesque propulsée sur la page, qui n’est autre que la poésie.
Comme un temps de la vie irréductiblement révolu, où les ombres encore vivaces de ceux qui sont passés dans nos cœurs existent encore, thématique dont se sont emparés tant de poètes… Mais il ne s’agit pas ici de regretter, pas de se lamenter, pas d’un chapelet de souvenirs convoqués pour faire poésie. Ces instances se confondent dans le paysage mnésique avec les passages du moi, feuilleté au gré du devenir où s’amenuise l’existence, et reconnues dans une solitude florale, rare, et assumée, où l’acceptation n’est pas résignation mais sagesse, tout entière soufflée dans les mots sur la page, dans la respiration qui s’envole et devient ce « rien » qui est la globalité du monde.
L’hypothèse noire grandit.
Avril ouvre son ciel aux arbres,
j’entreprends pour écrire
de nouer deux branches fines.Pas de feuille, encore aucun fruit rompu.
La promesse fleurit, le cerisier domine le blanc,
il éloigne le ciel monochrome
de la trajectoire subie (l’oubli).Que reste-t-il, maintenant
que mon ombre a grandi ?Midi cherche minuit. Tu avances,
toi l’invisible, substance pâle du bleu qui s’efface.
Les consonnes trébuchent sur ma langue muette (j’ai tenté)
soumise au cercle de ta tenue reculée.

Isabelle Lévesque, Je souffle, et rien, peintures de Fabrice rebeyrolle, postface de Jean-Marc Sourdillon, L'herbe qui tremble, 2022, 142 pages, 18 €.
Dans la nature, cet espace où le transitoire à force de recommencement rejoint l’éternité, se trouve la conscience, l’avènement d’une page blanche où ce rythme circulaire inscrit la transcendance. Compter, comme ces chiffres qui jalonnent le recueil, ouvrir lea sonorité des mots, et attendre comme on guette un mantra dans la langue enfin agencée pour se taire, l’instant où tout cesse et où tout devient enfin ce rien béant de l’accomplissement. Compter sans dénombrer, pour intégrer le mystère au monde.
Penchée vers la falaise
je suis prise dans l’étau de craie.
ne te retourne pas sur ce fossile à venir.
Je tombe. M’attends-tu ?Ma vision : le squelette pur du disparu se courbe,
sa main.
Tu élèves ma disparition au rang du ciel.
Une étoile ou mille. Celle du 9 non répertoriée.Combien de chiffres alignés (compte rond) ?
Je suis les silhouettes aimées une à une
elles me hissent – ici avoue l’oubli du nombre.
Le jeu avec les pronoms ne permet plus une appréhension distincte des personnes et brouille les références possibles à l'instance de la poète. "Je" est "tu", enfant du rêve clos et des souvenirs, silhouette qui exige parfois encore d’être nommée mais aussitôt effacée par l'évocation d’altérités croisées, vivantes ou côtoyées encore à travers leur disparition. Ces souvenirs s'inscrivent alors dans le temps du poème, là où le langage mis en bascule dans la vitesse du trait d’Isabelle Lévesque est mis en demeure d'énoncer cette mouvance perçue dans le prisme d'un kaléidoscope de figures oniriques ou de chair qui s'interpénètrent dans le « je » et le « tu » que dessinent ces croisements d’instances floutées par la trame du poème, et que l'on perçoit magistralement dans les peintures de Fabrice rebeyrolle qui accompagnent les poèmes, où la couleur devient matière, figure, temps et éternité.
L’enfant court, tu trébuches.
La force reste dans ta voix
que je n’entends pas.Ton ombre m’amenuise
encore.
Comme une langue devenue lourde et qu’il faut secouer pour qu’elle s’allège, qu’enfin elle devienne possible, et témoin de ce regard sur soi que l’on voit être, et qui se détache peu à peu de sa chair, hors des pronoms personnels, le poème fabrique ce « je » évidé de l’essence du moi, et trace le territoire de l’impossible ré-union à cet autre qui dans l’altérité est désiré mais perdu d’avance, et à ces autres aussi venus accompagner un instant de la vie et disparus.
Tu murmures (dans ma tête Tu)
le poème resté dans ce nuage
qui n’existe pas. Je tends ton nom
au jour, je plie mes doigts : ils ne se
lèveront pas.Ton nom informulé
dissipe le malentendu du passé
(tu n’es plus)Tu es seul, je vis perdue :
verbe muet (les noms alignés sont en terre).
Dédicaces et épigraphes esquissent un univers référentiel qui opère paradoxalement en renforçant ce brouillage, parce qu’ici tout se mêle, tout apparaît et tout s’échappe, comme vivre. Restituer ceci n’est pas parler, pas énoncer, mais se saisir. Et ça arrive avant les mots. S’emparer de ceci c’est écrire. C’est le poème d’Isabelle Lévesque.
Il y des fleurs rêvées (que j’abandonne) je regarde
la pluie c’est toiEric Sautou
Et toujours le poème énonce sa propre trace, dit qu’il essaie d’interroger le souvenir comme un lieu impossible, et de capturer dans la langue ce devenir qui n’est autre que ce rien qui peu à peu empreinte l’existence.
Dire ceci, la cécité et la puissance de l’abandon à se savoir aveugle, est le poème, qui prend naissance et épaisseur dans le souffle d'Isabelle Lévesque. Dedans tout arrive, c’est là que rien devient rempli d’un espace interminable et itératif, qui est aussi dans la couleur des fleurs, le silence des arbres, et, ici, la poésie.
Alors fière je lève ce verre vide :
le coquelicot joindra sa parure au vent.