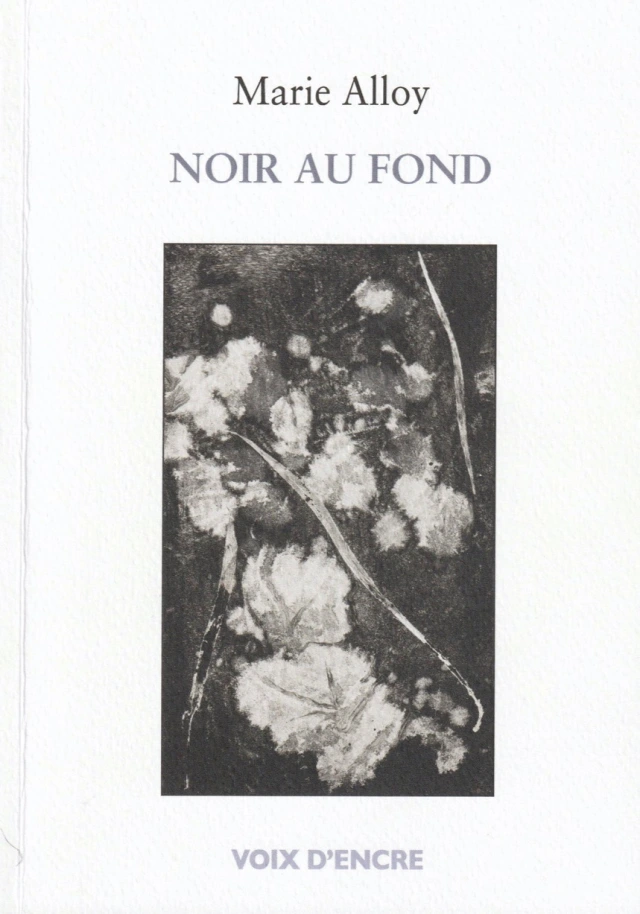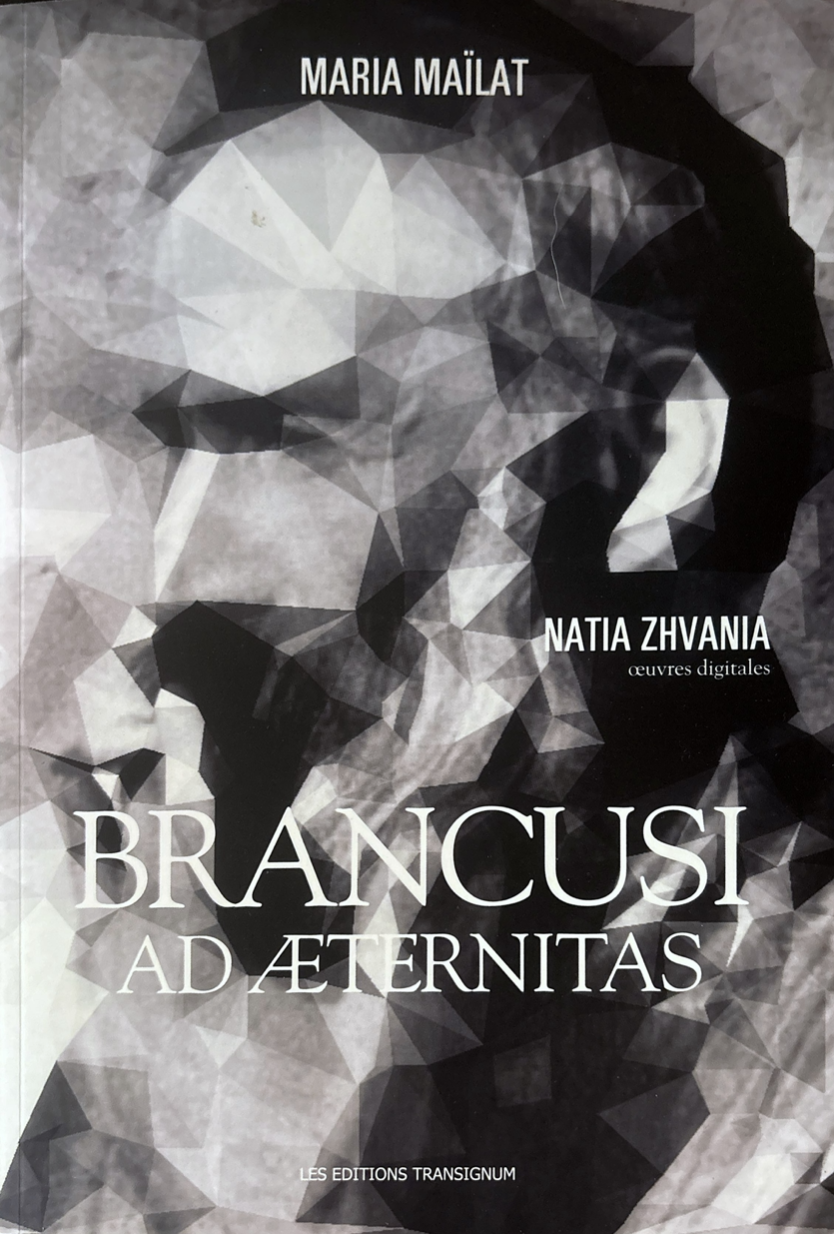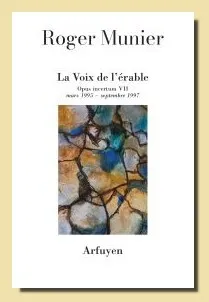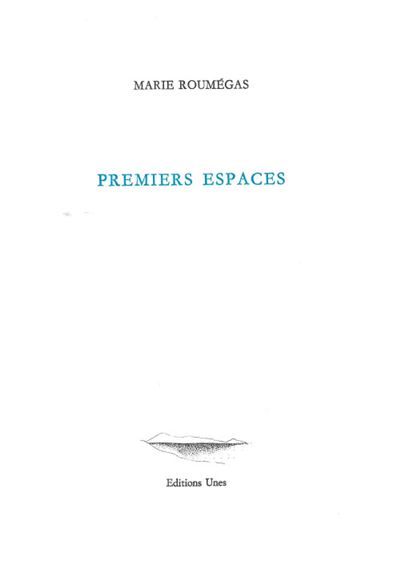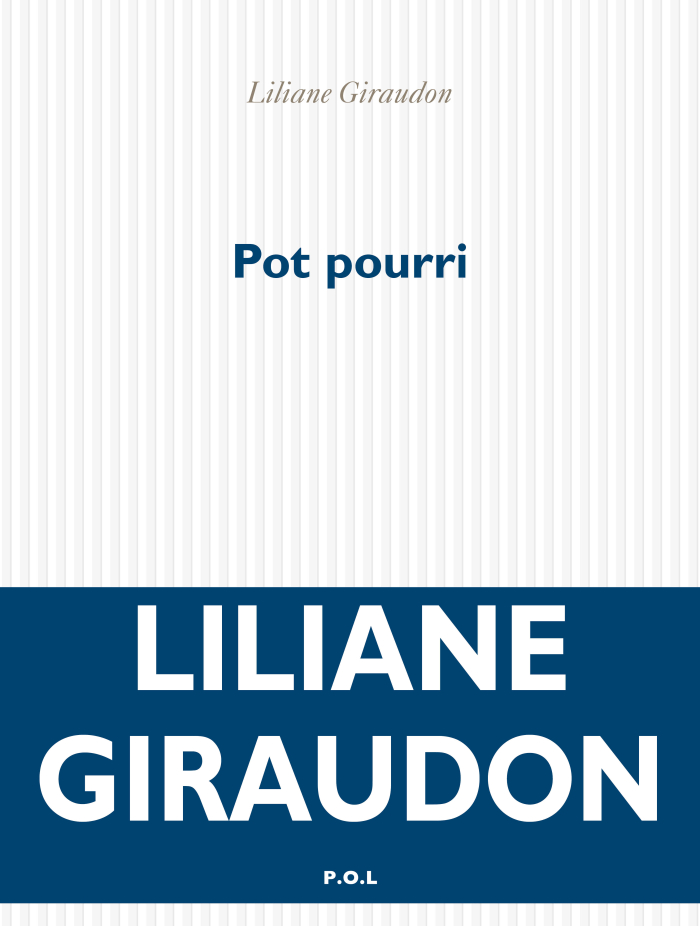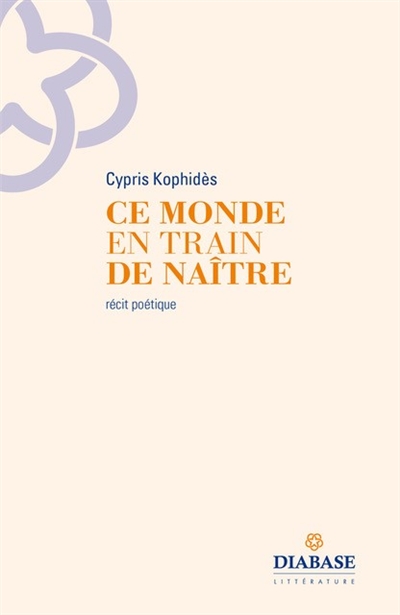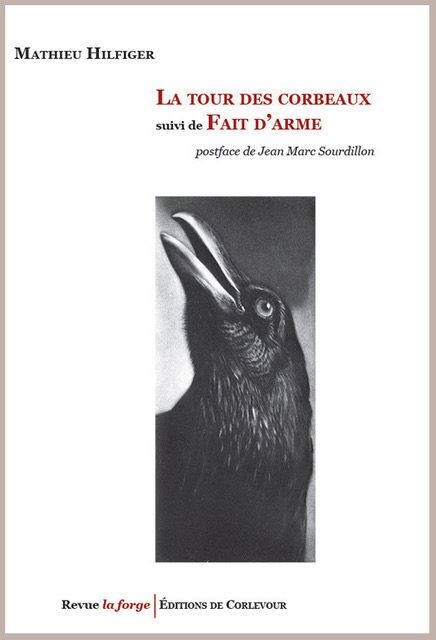Chronique musicale (15) : Devenir une fulgurance : Becoming Led Zeppelin
Premier documentaire cinématographique et musical sur la genèse du groupe mythique validé par les artistes fondateurs, Becoming Led Zeppelin raconte la création de ce quatuor d’origine londonienne, formé en 1968, entre free rock et free jazz, héritiers de la tradition blues et précurseurs du courant hard, décloisonnant les genres établis dans leurs morceaux expérimentaux dont les quatre membres furent les artisans inventifs de ce son, tour à tour léger et massif, toujours tranchant, décisif, sur le fil, tel l’envol d’un « dirigeable de plomb » sur le point d’embraser le ciel d’une époque où « faire de la musique » signifiait encore « faire l’amour et la révolution » et arpenteurs de grands espaces, forçant les portes des studios pour écrire des albums conceptuels traduisant l’A.D.N. de leur identité hybride, à la rencontre, à l’ouverture et pourtant si personnelle qui ont tracé les horizons pour longtemps des courants de tant de musiciens…
La force de ce témoignage de la naissance et de l’avènement de cette formation qui a tant marqué les esprits, réalisé par Bernard MacMahon, écrit par Bernard MacMahon et Allison MacGourty, est d’exprimer l’association initiale, le travail acharné, la recherche perpétuelle de ces artistes majeurs de leurs débuts jusqu’à leur ascension avec la création de leurs deux premiers albums et le succès emblématique de Whole Lotta Love, Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham, John Paul Jones, explorateurs sur des chemins de traverse, et c’est là tout l’intérêt de ce regard initiatique à ce processus collectif si pluriel, il laisse sa part belle aux hasards, aux accidents, à l’inattendu comme à la beauté de la rencontre, à la magie des premières répétitions et au sublime des concerts historiques, pour mieux nous questionner sur la dimension exceptionnelle, entre coïncidence et destinée, de la ligature de cet alliage à huit mains pour sertir alors en lettres de feu cette fulgurance, toujours envisagée ainsi, en instant suspendu, disruptif et éruptif, à la fois hors du temps et en disant tant d’une époque où l’on allait, par exemple, connaître des conflits mondiaux dévastateurs mais également marcher pour la première fois sur la lune, tout à la fois une trouvaille singulière et une échappée à plusieurs, en devenir, un devenir, devenir Led Zeppelin…
Devenir Led Zeppelin bande annonce.
Un entretien inédit et touchant qui justifie à lui seul la découverte de ce film est l’enregistrement de la voix de John Bonham qui parle de son plaisir à jouer dans ce groupe dont il est apparu peu à peu comme la clé de voûte, se confiant sur sa joie sans simulacre à partager les répétitions, la scène et la présence de ces personnalités également radieuses… Que dire alors quand la narration de ces aventuriers éclaire ô combien la bifurcation dans la carrière de chacun pour la constitution de ce collectif hors du commun tient tant de la déprise des habitudes que de la prise de risques, et n’aurait, semble-t-il, sans un concours de circonstances qui paraît tenir de l’alignement des planètes, ne pas voir le jour ? Dès les premières rencontres, le sentiment partagé fut alors d’œuvrer à quelque chose de grand, qu’il ne fallait ni mettre entre parenthèses, ni brader face à l’industrie du disque comme face aux diktats de la mode, puisque Led Zeppelin à l’avant-garde allait lancer l’écriture du futur…
Led Zeppelin interprète « Whole Lotta Love » au Royal Albert Hall en 1970.
Tout alla très vite, sitôt le premier album, entonnant le chant de la beauté troublante des femmes qui rayonne, dans une convulsion aussi érotique que surréaliste, dans l’encre de chacune de ces mélodies entre ballades blues et déflagrations hard rock, laissant leurs auditeurs aussi éblouis et confus, entre ruptures de communication, départs impossibles, nécessités de renouer avec sa chérie, dans un éloge de l’amour charnel, entier, total dont le deuxième album, repoussant encore plus loin les limites du standard rock-and-roll, pour lier à la fois finesse et puissance, à la fois bestialité du corps et spiritualité de l’âme, dans une invitation au voyage comme une métamorphose de l’amour en chanson dont le titre Ramble On résonne en métaphore d’une vie en traversée désormais nommée Led Zeppelin pour les chapitres qui suivront : « Promenez-vous / Ramble on / Et c'est le moment, c'est le moment / And now's the time, the time is now / Chante ma chanson, / Sing my song / Je fais le tour du monde, je dois trouver ma copine / I'm goin' 'round the world, I gotta find my girl / En chemin / On my way »…
Led Zeppelin interprète « Stairway to Heaven » en concert à Earls Court en 1975.