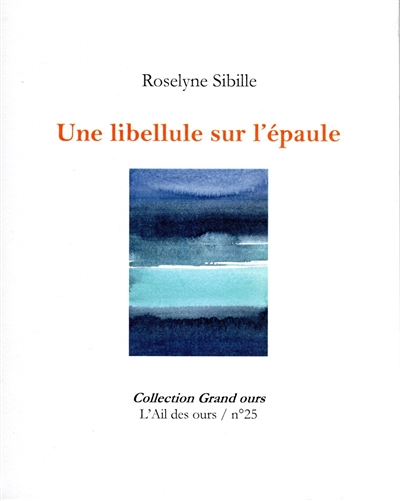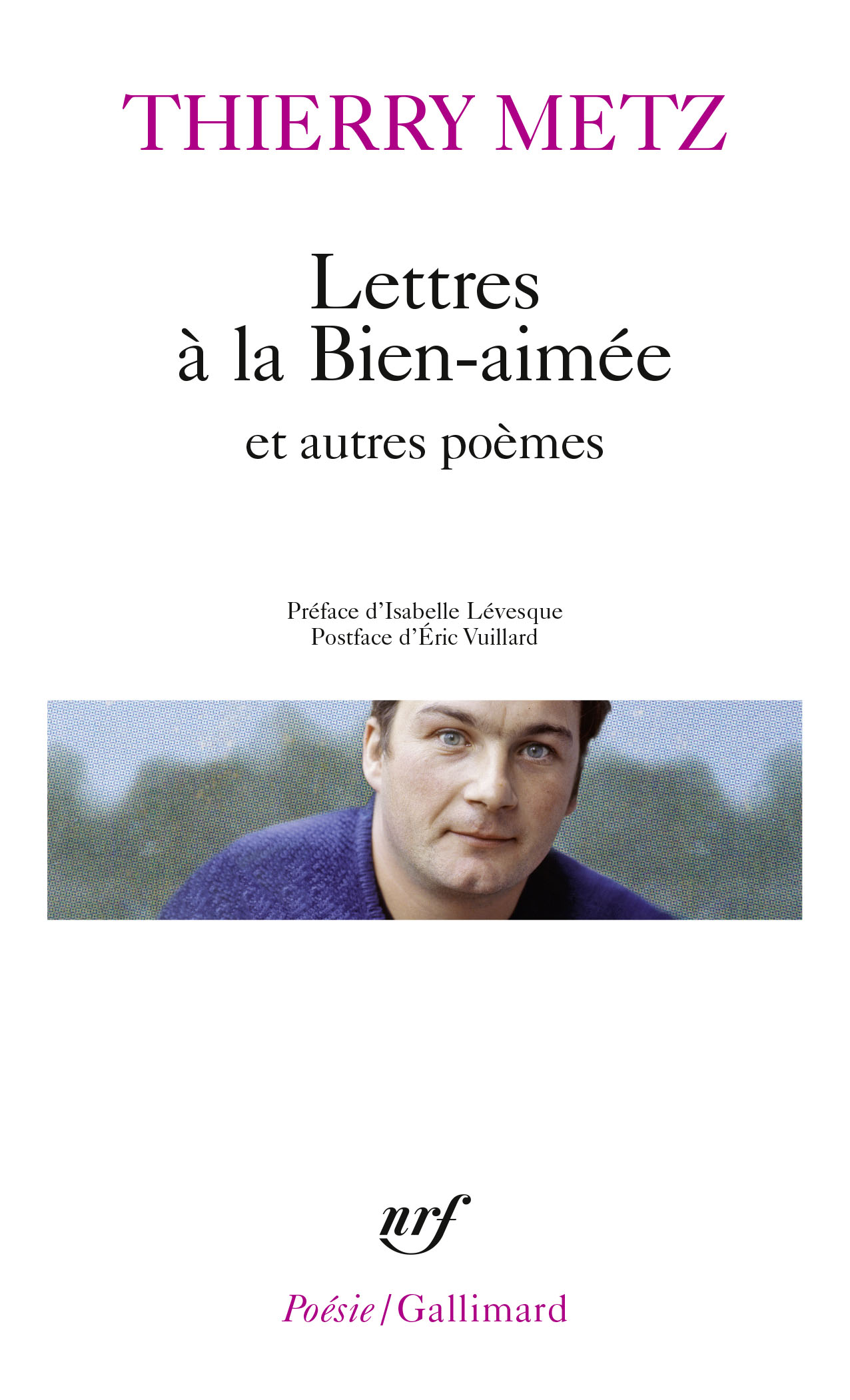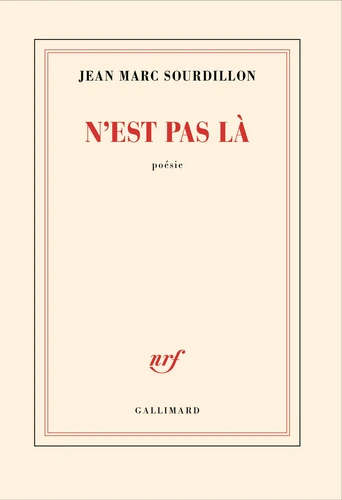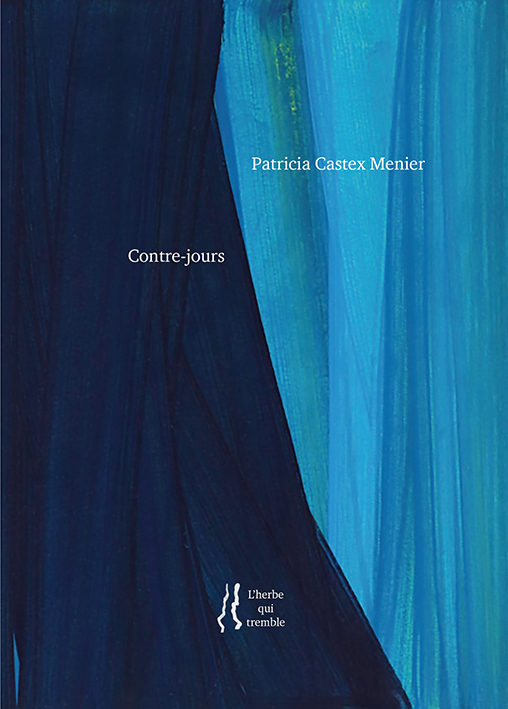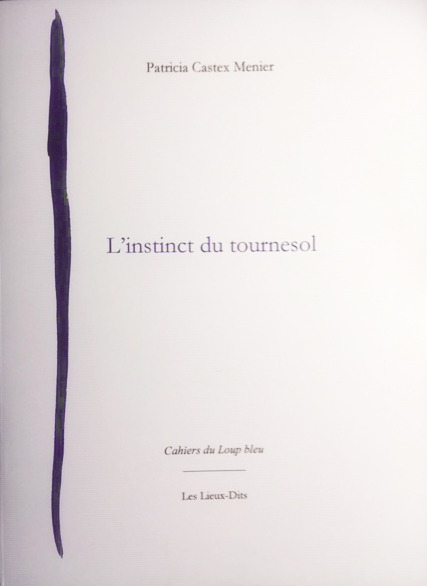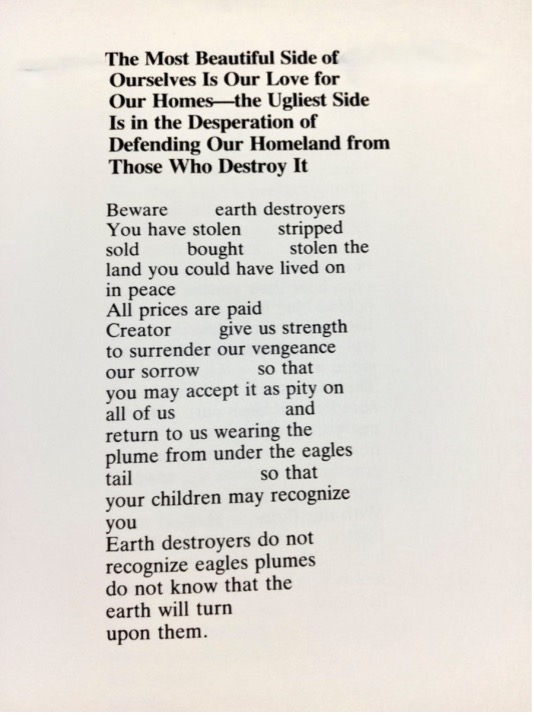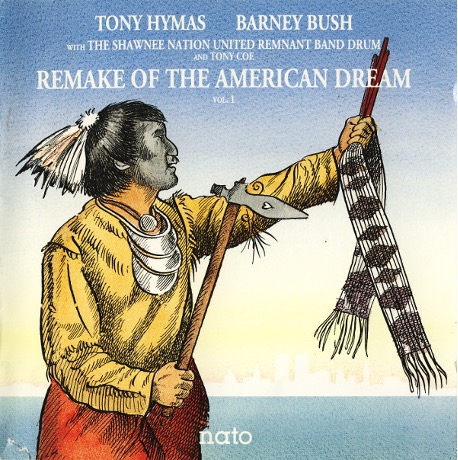Alberto Comparini, palimpseste
2.1.
les passages piétons les voitures débordant en double file les feux verts clignotants
cette hâte adolescente de vouloir à tout prix vaincre l’attente lourde du lendemain
après les convocations pour le stage d’été les entraînements les matchs les suicides
les dernières coupures tout s’achève dans un virage serré près du carrefour la force
centripète de la route ne suffisait plus le frottement dynamique cède à l’inertie
de la moto l’énergie cinétique se conserve ton corps devient pur mouvement
en une fraction de seconde tu es figé tu heurtes la tête le genou la poitrine
2.8.
tu composes le 0103621526 il s’était fait tard à la maison le téléphone fixe de la cuisine
avait longuement sonné c’était l’heure du dîner de l’autre côté du combiné on entendait en fond
le générique de Otto e mezzo quelqu’un avait baissé le volume de la télé à l’écran défilaient
en silence des publicités muettes jusqu’à l’explosion soudaine d’une voix confuse de mère ou fille
bonsoir ce n’est pas moi Alberto a eu un accident de moto il est vivant il ne respire pas très bien
après la chute il a dû perdre son portefeuille maintenant il est en état de choc il n’arrive pas
à bouger les jambes il est agité inquiet instable il répète à tous qu’il veut encore jouer au basket
3.8.
un an après l’opération la rééducation du genou gauche est
terminée le tonus la masse la mobilité du membre ne sont pas
suffisants pour reprendre l’activité sportive il faut attendre l’avis
de l’orthopédiste n’est pas positif dans l’autre jambe tu ressens
une douleur aiguë elle est intermittente elle continue de croître
en même temps qu’une autre vie entre la tête et le col du fémur
5.9.
tout a un prix même les trajets en train régional les vols low-cost de dernière minute
ces jeûnes collectifs dans les cabinets les discussions vos silences et mes demandes
pour un second avis après le dernier contrôle raté tu comprends ce que deviendra
ton corps une fois obtenu le prêt d’honneur à la banque de l’os cette cicatrice
une vieille blessure ta mémoire diluée dans une perfusion analgésique
8.8.
au moment de la sortie tu reçois le protocole de départ
un symptôme constant du mal obscur est le syndrome
du membre fantôme tu en perçois tout de suite la position
la douleur va et vient elle est épisodique il serait risqué
d’intervenir encore sur le fémur les décharges tendent
à croître elles traversent entièrement le corps du patient