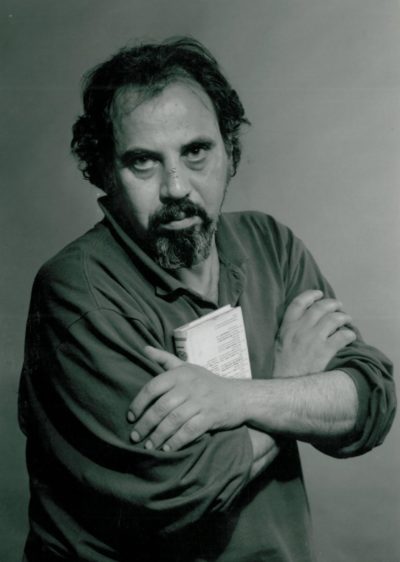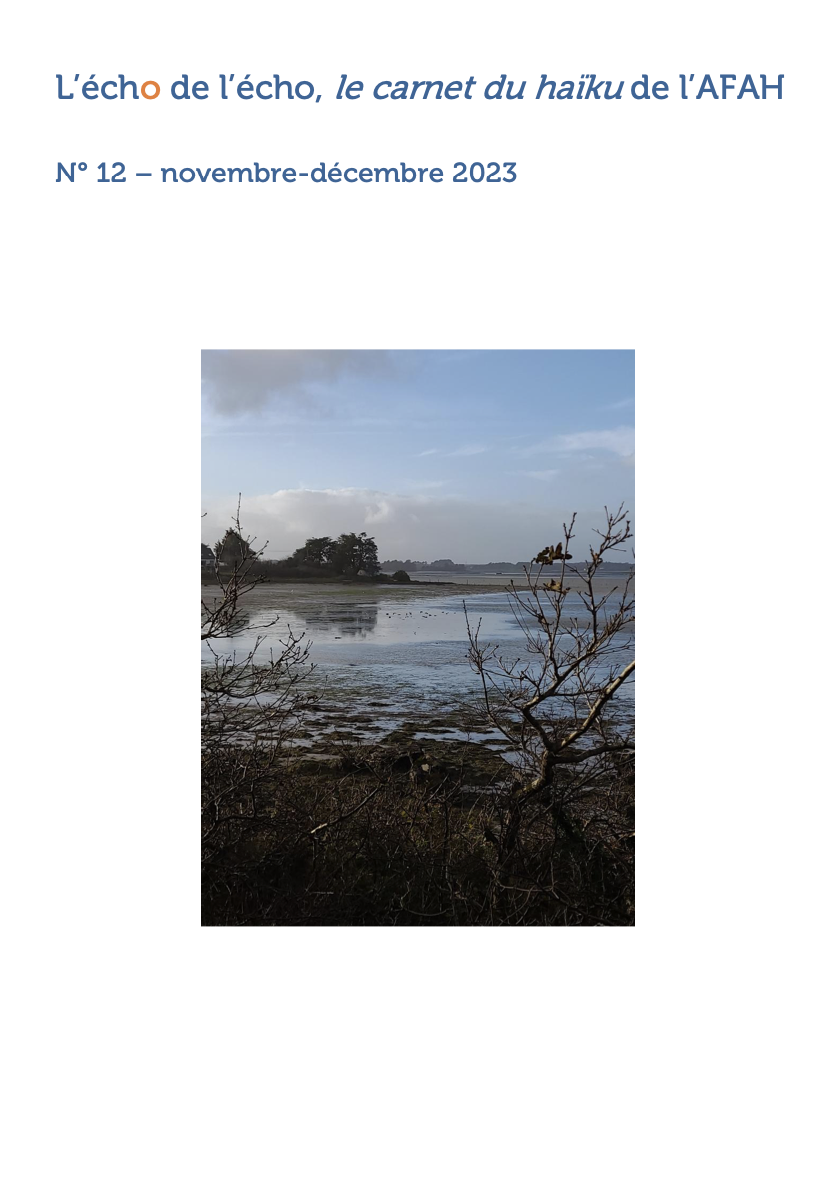Autour de la traduction — et de la poésie turque
Traduction en tant que Re-création
La traduction c’est du tango argentin qui exige un certain respect de soi et celui des autres. Loin d’une simple succession de pas, c’est une marche vers la vie de l’autre. C’est une autre façon d’exister. C’est le désir de démontrer qu’on ne veut plus avancer seul, qu’on a besoin de l’autre dans toute son altérité. C’est la reconnaissance de l’autre dans sa différence. La traduction, c’est une émotion qui se danse à travers les langues.
Si nous nommons la traduction : œuvre de re-création et le traducteur : créatif, le processus de la traduction deviendra créatif en soi comme produit créatif entouré d’une aura de mystère.
Si nous prenons l’originalité et la nouveauté comme deux critères essentiels de la création, le texte traduit (c’est-à-dire la traduction) en tant que résultat d’un processus de création se prétendra être le même dans une autre langue par l’intermédiaire d’un entremetteur, qui déjà écrivain nous présente une beauté à demi-voilée que nous n’apercevons plus qu’à travers un brouillard. Cette entremise, cette traduction qui se trouve entre création et théorie – telle la philosophie – cette image de la belle étrangère qui excite en nous le désir frustré, le désir irrésistible de connaître l’original, exprimera le rapport le plus intime entre les langues.
La traduction de la poésie c’est la folie : Folie-poésie-traduction : C’est la difficulté de créer, c’est la restriction… En voilà deux éléments nécessaires dans l’art, comme disait Goethe qui aimait traduire des auteurs presque intraduisibles et qui considérait sa création comme faisant partie de son activité de création.
Il ne nous est pas impossible de considérer la traduction comme une partie intégrale d’une activité littéraire-poétique d’une autre histoire, d’un autre monde cognitif, d’un monde de perception-langage-mémoire, d’un autre espace conceptuel – intellectuel, d’un espace de pensée – aussi bien d’autres sensibilités que de compétences.
La traduction de la poésie en tant qu’activité créatrice permet à l’original sa survie que nous nommerons « la retraduction », au dire de Benjamin, « l’intraduisible », le renouvellement de la lecture selon les changements des normes esthétiques des époques.
Si nous prétendons que la traduction est un art, dans le sens grec du mot – ars, teckné -, technique qui ne doit pas envier l'art comme création, nous dirons que l'acte de traduction, ne fera que « se reconstruire » dans la traduction.
Si nous acceptons que la traduction de la poésie est une "technique", un "savoir-faire″ à travers lesquels se créent les idées, les mots, nous dirons que c'est quelque chose d'analogue à l'art d'écrire et que la traduction peut être (ou elle mérite d’être) considérée comme un art de réécrire.
Si nous disons toujours que la traduction est un art comme tous les autres arts, l’acte de traduire exigera une maîtrise élevée.
Si nous disons que la traduction devient une activité incontournable dans un monde qui compte plus de 3000 langues, nous prendrons cette fameuse activité comme produit créatif et en parlerons à la lumière de plusieurs questions telles que :
- La traduction serait-elle l’une des clés de la communication ?
- Serait-elle l’ombre de l’original ou son double ?
- Le produit (texte traduit) serait-il conflictuel par rapport à ces deux critères essentiels et serait-il toujours le même texte dans une autre langue ?
Nous n’ignorons toujours pas que la traduction est un travail sans fin, une tâche difficile vu la variété du style, la singularité de l’œuvre, de la langue de départ et d’arrivée. C’est une tâche difficile avec des expressions intraduisibles, des vocables (terme signifiant quelque chose de précis) irremplaçables, des formes poétiques inchangeables selon leur valeur unique.
La traduction de la poésie se présente comme un fait de savoir offrir un dispositif technique et esthétique permettant d’atteindre son objectif poétique via la combinaison des différentes compétences linguistique, discursive (méthodique, logique, cohérente), socioculturelle et référentielle.
Les formes poétiques qui sont assez riches causent des problèmes énormes aux traducteurs : Comment faire avec Calligramme : poème à disposition graphique particulière ; Haïku : forme poétique japonaise codifiée de textes courts de quelques vers ; Lai : forme poétique médiévale de nombreux genres ; Motet : forme poétique se rapprochant de la musique ; Poésie en prose : forme poétique bien particulière qui utilise la prose au lieu des vers ; Rondeau : poème à forme fixe de 3 strophes isométriques construites sur 2 rimes, avec des répétitions obligées ; Sonnet (italien, français, shakespearien ou élisabéthain) : forme poétique bien particulière. Le sonnet suit obligatoirement une règle d’organisation strophique fondée sur la succession de deux quatrains et de deux tercets. Le système de rimes obéit à certaines contraintes variables selon le temps et les traditions nationales.
Pour les quatrains, jusqu'au XVIe siècle, l'usage dominant est la rime embrassée (abba / abba) identique dans les deux strophes (mais Shakespeare pratique : abab / cdcd). Pour les tercets, il n'y a pas de règle mais un usage différent selon les poètes ou les traditions nationales : rimes italiennes (cdc / dcd); françaises (ccd /ede); marotiques (ccd / eed); shakespeariennes (efef / gg). Au XIXe siècle l'usage se diversifie considérablement ». Bien que le sonnet respecte certaines modalités de construction qui constituent un art de la composition, Baudelaire pratique des systèmes de rimes différents. Avec une grande sensibilité et en privilégiant le cadre du sonnet, il donne à sa poésie - L’Homme et la mer - une dimension symbolique. Il est le premier poète moderne qui sait rompre avec la thématique traditionnelle de l’idéalisation de l'amour et de la nature...). J’ai le plaisir, à cette occasion, de vous rappeler L’Homme et la mer avec sa traduction en turc par le grand poète-traducteur Orhan Veli :
L’Homme et la mer
Homme libre, toujours tu chériras la mer!
La mer est ton miroir, tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image;
Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets;
Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets!
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, Ô frères implacables !
İnsan ve Deniz
Sen, hür adam, seveceksin denizi her zaman;
Deniz aynandır senin, kendini seyredersin
Bakarken, akıp giden dalgaların ardından.
Sen de o kadar acı bir girdaba benzersin.
Haz duyarsın sulardaki aksine dalmaktan;
Gözlerinden, kollarından öpersin, ve kalbin
Kendi derdini duyup avunur çoğu zaman,
O azgın, o vahşi haykırışında denizin.
Kendi âleminizdesiniz ikiniz de.
Kimse bilmez, ey ruh, uçurumlarını senin;
Sırlarınız daima, daima içinizde;
Ey deniz, nerde senin iç hazinelerin?
Ama işte gene de binlerce yıldan beri
Cenkleşir durursunuz, duymadan acı, keder;
Ne kadar seversiniz çırpınmayı, ölmeyi,
Ey hırslarına gem vurulmayan kardeşler!
(Traduit par Par Orhan Veli)
La traduction de la poésie est très compliquée pourtant c’est une beauté, c’est la beauté d’une esthétique de l’à-peu-près, comme le dit Serpilekin Adeline Terlemez dans l’un de ses recueils :
Traduction
Une fugue, l'effacement d’une langue
devant un rival amoureux, le mariage désiré, la cohabitation
impossible,
l’amour fou qui fait preuve
d’effacement au profit de sa bien aimée,
une apparition progressive, une naissance, une traversée, une
sortie
pour l’émergence d’une beauté émergente
au sein de l’effacement, une beauté qui vit au reflet du splendeur
de tout ce qui s’efface, de tout ce qui
émerge.
La traduction
chose simple qui n’est pas
facile.
La traduction, une fugue,
un renoncement, la beauté de ce
renoncement, la beauté d’une esthétique de l’à peu- près,
[…]
C’est le miroir qui reflète l’image d’un visage...
Il l’est et il ne l’est pas,
le visage qui se regarde, qui se sourit, qui tend la main, qui veut se toucher,
mais hélas impossible!
C’est une bataille perdue d’avance...
Une bataille qui émerveille à
merveille une bataille qui ravit, surprend, enchante
admirablement, fâcheusement regrettablement,
une beauté qui déçoit… une rencontre, une genèse,
c’est la renaissance d’une langue
dans une autre langue.
Serpilekin Adeline Terlemez
La traduction de la poésie considérée comme une belle rencontre de poésie- traducteur-lecteur qui s'attirent, s'aiment ou se détestent en raison d’inhospitalité langagière n’est qu’une dispute entre l’identité et l’altérité et entre les langues qui se rencontrent, s'entendent, se disputent, se parlent, s'ignorent, se chérissent et se détestent.
Et quant au traducteur qui est à la fois lecteur et auteur, nous dirons qu’il ne baisse pas les bras. Serviteur de ses deux maîtres, il continue à traduire pour faire passer tout texte aussi bien traduisible qu’intraduisible. Il est obligé de servir ses deux maitres mais à qui donnera-t-il la priorité? Restera-t-il fidèle au premier pendant qu'il sert l'autre et vice-versa? Comment arrivera-t-il à ne pas les trahir ?Et comment sortira-t-il de cette impasse?
Le traducteur demeure seul face à de nombreux dangers qu’il doit déjouer sans savoir toujours comment faire. Car la belle connaissance de ces deux langues ne l’empêchera pas de tomber dans le piège des mots qui exigent une connaissance encore plus vaste, celle du domaine particulier de la langue de départ. Ce passeur de langue est souvent confronté à l’obligation de faire son choix entre plusieurs mots identiques. Ce n’est pas facile, comme nous venons d’évoquer, il y a beaucoup de choses qu’il doit respecter comme style, sujet, contexte, tout ce qui se cache derrière chaque mot, tournure, expression, couleur, image. Il se peut qu’il n’arrive pas à trouver le mot juste qui dirait exactement ce que dit l’autre. Car il est bien normal qu’il y ait des difficultés provenant de l’arrière plan culturel de la langue de départ. Pour cette raison, nous disons que traduire relève d’un art, d’une science, d’une poésie, d’un re-création.
Traduire, dans ce contexte-là, devient une tâche qui secoue toutes les frontières de sens, mots, expressions, culture. Elle va au-delà de toutes les connaissances du traducteur, elle passe à la dimension métaphysique de toutes les données. C’est à cette dimension que doit travailler le traducteur, il doit se dépasser afin de pouvoir traverser ce pont de traduction et atteindre l’autre rive passionnante où l’attendent ses nouveaux lecteurs. Il a tout le droit et devoir de provoquer la même réaction chez le lecteur en modifiant - si cela lui paraît indispensable – la forme, l’exemple de Ali Poyrazoğlu (Mes inconnus, in Le Crocodile en moi, présenté et traduit par Sevgi Türker&Serpilekin Adeline Terlemez, éditions A Ta Turquie, Nancy, 2010, pp. 30, 32, 33) :
Mes inconnus
Que je les réunisse et qu’on discute pour de
bon, ai-je pensé.
Et en plus je m’y connais pas mal
dans la grande cuisine...
J’ai préparé des plats raffinés aux goûts exquis de chacun.
J’ai bien travaillé quand même
car je les connais bien.
Et j’ai bien dépensé…
Ce que l’un mange l’autre le déteste. Ce que l’autre boit l’un le refuse...
J’ai dressé quatre couverts, j’ai allumé les bougies.
Tous les quatre aimaient Eric Sati
je me souviens…
j’ai mis la musique ils sont arrivés...
J’ai assis mes trente-cinq ans en face de mes vingt ans.
Je me suis mis en face de mes quarante ans.
Mes vingt ans ont trouvé
vieux jeu mes trente-cinq ans.
Mes quarante ans les ont trouvés
tous les deux nuls.
J’ai essayé de détendre
l’atmosphère … casse-toi pépère, m’ont-ils dit.
Quelle bagarre !
Les voisins du dessus et ceux du dessous
ont manifesté leurs mécontentement
en frappant aux murs.
Mes vingt ans ont lancé
un verre
sur mes quarante ans. Et
ils m’ont bousillé la maison.
C’est de ma faute… Quelle idée !
Quelle mauvaise idée d’inviter chez-
soi
les gens qu’on ne connait pas !
Ali Poyrazoğlu
traduit par Serpilekin Adeline Terlemez & Sevgi Türker
La traduction, c’est comme ce tango argentin, il ne reste qu’à chercher et à reconnaître les émotions que chacun désire exprimer. La mission du traducteur est de transmettre cette émotion, ces sentiments, pensées et cette ambiance.
Qui est donc ce traducteur ?
Qui serait-il ?
Celui qui fait passer l’écriture d’une langue à une autre ?
Celui qui va au-delà de deux langues et en crée une troisième, c’est-à-dire un créatif ?
Serait-il Le Dieu tout puissant qui décide tout ?
Ne serait-il pas le mari modèle, l'amant infidèle?
Serait-il le lecteur privilégié qui fait passer ce qu’il reçoit ?
Se nommerait-il comme celui qui démonte le texte pour le remonter ou celui qui dévoile le dévoilement pour redessiner le texte d’arrivé ?
Serait-il un passionné de l’insuffisance qui se laisse au charme de la langue et des mots ?
Serait-il un audacieux qui prend des risques, qui marche sur un fil ?
Et que dire de cet ordinateur traducteur ?
Serait-il un traducteur puissant et rapide ?
Serait-il plus performant qu’un cerveau humain?
Est-ce vraiment possible d’imiter ou remplacer le cerveau humain par un ordinateur ?
Particularité de la langue turque
Le turc/Türkçe (de Turquie) est une langue de la famille ouralo-altaïque ou finno-ougrienne, apparentée au finnois-finlandais et au hongrois. Elle n'est ni indo-européenne comme le français, l'allemand, l'anglais ou le persan, ni sémitique comme l'arabe ou l'hébreu, malgré la longue influence qu'elle a subie pendant des siècles de vie commune avec les Arabes et les Persans. Il est parlé à l’heure actuelle par plus de 200 millions de personnes dans le monde (Europe, Chine, ex- Soviétique, Afghanistan, Iran, Azerbaïdjan, Irak, pays balkaniques, etc.).
C’est une langue agglutinante (comme tamoul, mongol, estonien, finnois, hongrois, coréen, japonais, basque, somali, géorgien), chaque morphème correspond à un trait et chaque trait est noté par un morphème. Ex ev (maison) on forme : evler (les maisons), evlerim (mes maisons), puis evlerimde (dans mes maisons) ou encore evlerimdekiler (ceux de mes maisons).
Les traits caractéristiques de cette langue sont l’harmonie vocalique, l’agglutination au moyen de suffixe et l’absence de classes nominales ou de genre grammatical.
Son ordre SOV (sujet, objet, verbe) s’oppose avec l’ordre SVO (sujet, verbe, objet du français).
Le turc otoman (Osmanlıca, turc ancien (eski Türkçe), Lisān-ı Osmānī – la langue officielle de l’Empire Otoman (1299-1923, période pendant laquelle le turc n’est parlé que par les paysans) – s’écrivait avec une version de l’alphabet arabe et se caractérisait par une proportion importante de termes d’origine arabe ou perse.
En 1928, Mustafa Kemal Atatürk entreprend la réforme de la langue turque. L'adoption de l'alphabet latin a comme objectif de supprimer toutes les « capitulations linguistiques », d'insister sur le caractère moderne et de minimiser l'influence des conservateurs religieux, de toucher les masses populaires analphabètes.Le nouvel alphabet (comptant 29 lettres dont 8 voyelles - a, e, ı, i, o, ö, u, ü – et 21consonnes) est phonétique, toute lettre écrite est prononcée. Il n'y a pas de groupement de consonnes et des voyelles. Chaque consonne comme chaque voyelle est unique. Chaque lettre correspond à un seul son. Les lettres Q, W, X n'existant pas, elles se remplacent par Ç, Ğ, I (sans point), Ş, Ö, Ü
Quant à la poésie turque, nous commencerons par indiquer :
- La poésie populaire :
- Poésie de « clan » qui existait bien avant l’islam avec la musique du saz, ses thèmes éternels, son inspiration, ses ballades et ses chants a été à l’honneur en Turquie parallèlement à la poésie du « Divan ».
- La poésie des troubadours (Aşık) – la poésie amoureuse – Köroğlu etKaracaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Veysel. Leurs chants épiques, une sorte d’harmonie de la parole et de la musique, s’élèvent comme le symbole de l’insoumission contre les inégalités sociales. Ils chantent l’héroïsme, la bravoure, l’amour, la nature.
- La poésie classique, dite du « Divan » avec des vers métriques, moule arabe, elle descend des seldjoukides (Selçuklular) qui, à travers la guerre, sont en étroit contact avec les Perses. Les premiers essais de vers métriques datent du VIIe siècle et appartiennent aux poètes turcs de l’Asie centrale. Cette forme de poésie connaît trois périodes :
-
- Préclassique : XIV-XVe siècles ;
- Classique : XVI-XVIIe siècles ;
- Postclassique : XVIII-XIXe et début du XXe siècle.
Poésie anachronique, par son caractère durable jusqu'à nos jours, elle résiste à l’arrivée du vers syllabique et du vers libre. La poésie de Divan est lyrique :
-
- Gazel (Ghazals) thème de l’amour, 5-9 strophes
- Kaside (qasides) éloge au pouvoir, 33-99 strophes
- Mesnevi, amour, beauté ; poésie, textes poétiques en prose, poésie narrative « Leyla et Mecnun » de Fuzûlî)
-
- Le vers syllabique (hece vezni) (XXe siècle) émerge comme une réaction contre les locutions arabes et persanes. Il a une brève existence, il fait le pont entre le vers métrique et le vers libre. Tevfik Fikret, poète-philosophe accusé pour ses convictions politiques rentre à Istanbul après dix années d’exil. Fortement influencé par les symbolistes français, il écrit parfois en langue française.
Restés d’abord sous l’influence persane, arabe et ensuite (après 1839) française, les poètes turcs négligent leur langue jusqu'à la Première Guerre Mondiale. Nazım Hikmet, Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday, Fazıl Hüsnü Dağlarca, font de leur poésie une poésie de combat. Nazım Hikmet et Fazıl Hüsnü Dağlarca, deviennent par leur audace et talent les pionniers du vers libre. Et Behçet Necatigil, poète de petits mots que nous venons de traduire réunit dans sa poésie toutes les formes de la poésie turque :
ROSE FANÉE QUAND ON LA TOUCHE
La plupart font tomber tant de choses mais
Les passagers ne les voient pas
Je me penche je la prends
Elle devient rose fanée quand on la touche.
Ou bien dans une grande ville
Dans des arrêts surpeuplés elle se promène
Ou bien dans un lieu éloigné du pays
Dans le coin d’un café, dans la chambre d’un hôtel
Où qu’elle aille à cette heure du soir
Elle met les mains dans ses poches
Parmi des cigarettes, des papiers,
Elle glisse doucement
Je me penche je la prends, personne n’est là
Elle devient rose fanée quand on la touche.
Ou bien dans le rouge à lèvres
Qu’une fille seule efface
Au seuil d’une nuit fatiguée
Quand elle met sa tête sur l’oreiller.
En pleine journée certaines viennent à mes côtés
Plutôt pendant les mois d’automne et lorsqu’il pleut
Comme un nuage descend dans un nuage de tristesse.
Je me penche je la prends, personne n’est là
Elle devient rose fanée quand on la touche.
Sur les mains, sur les lèvres, en des écritures désertées
Elle se fait piéger par des rets tendus
Comme des bêtes blessées elle respire
S’étouffe, veut s’enfuir
Le long des chemins ou des souvenirs.
En la prenant je reviens, elle ne dort pas de la nuit
Elle bouge dans le noir dès que je la touche
Elle devient rose fanée quand on la touche.
Behçet Necatigil