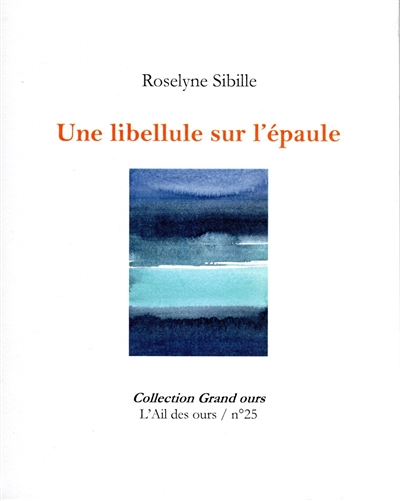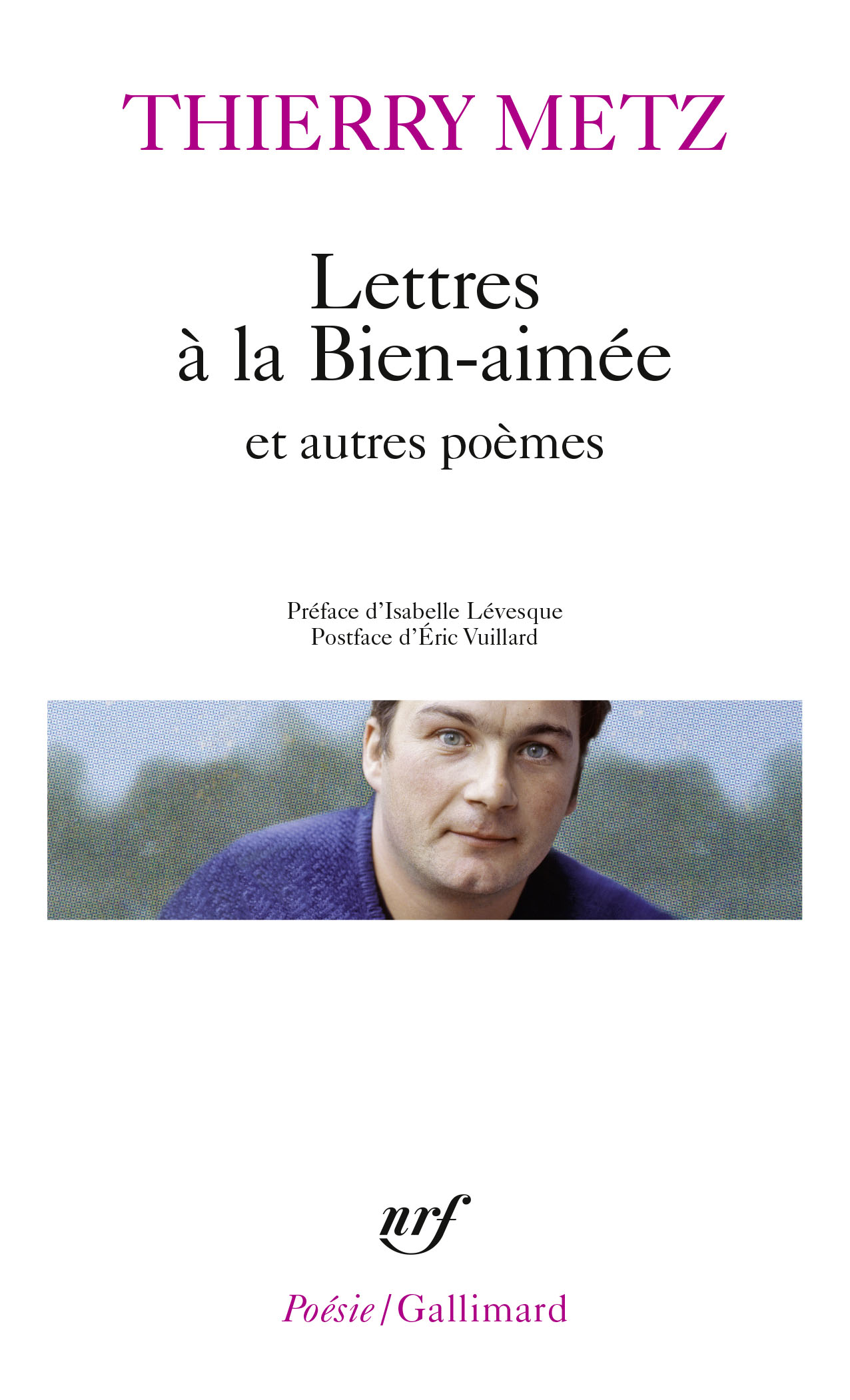∗∗∗
Pour Elisa Pellacani
1 –
à l’aube
tendre la main
cueillir la joie
dans les trilles du platane
puis saisir dans ma paume
le doux ombrage des nuages
humer dans l’air limpide
le clair matin qui vient
et
devenue source de joie
les diffuser moi-même comme
ténue
la fumée du café dont l’arôme
emplit l’âme
d’un sens de plénitude.
all'alba
tendere la mano
cogliere la gioia
nei trilli del platano
poi afferrare nel palmo della mano
la dolce sfumatura delle nuvole
annusare nell'aria limpida
il mattino che arriva
e
diventata fonte di gioia
trasmetterli come
sottile
il fumo di caffè il cui aroma
riempie l'anima
di un senso di pienezza.
*
2 –
Chaque matin est un miracle
quand les yeux s’ouvrent sur le monde
Mon horizon est le platane –
derrière l'éventail de ses branches
l'horizon fait son cinéma
et profite de la dentelle noire
qui danse avec les nuages
pour me faire rêver de montagnes
Ogni mattina è un miracolo
quando si aprono gli occhi al mondo
Il mio orizzonte è il platano –
dietro il ventaglio dei rami
l'orizzonte fa il suo cinema
e si approfita del pizzo nero
che balla con le nuvole
per farmi sognare le montagne
*
3 -
j'entends les goélands ce matin au réveil -
je sais qu'il fera gris
il y aura du vent
mais leur clameur me porte à Sète
invariablement
De même que le cri aigu des martinets
fera exploser le bleu du ciel d'été
en fragments de mémoire Parme
Sento i gabbiani questa mattina al risveglio-
So che sarà grigio
ci sarà vento
ma il loro clamore mi porta a Sète
invariabilmente
Proprio come il grido acuto dei rondoni
farà esplodere l'azzurro del cielo estivo
in frammenti di memoria Parma
*
4 -
Février - cinq heures du matin
— un instant hors du temps —
parfum de foin frais et
vrombissement d'insectes
Furtives des silhouettes
dans la nuit de la ville
rasent l'herbe sur la place
puis disparaissent
Et l'odeur qui rémane
ramène de l'enfance
— le temps d'un souvenir —
les bottes de foin
dans lesquelles on s'enfonce
dans le grésillement
des grillons de l'été
Febbraio - cinque del mattino
— un momento fuori dal tempo —
profumo di fieno fresco e
ronzio di insetti
Silhouette furtive
nella notte della città
tagliano l'erba in piazza
poi scompaiono
E l'odore che rimane
ramenta l'infanzia
— l’attimo di un ricordo —
balle di fieno
in cui si sprofonda
nello sfrigolio
dei grilli estivi
*
5 -
matin gris sur le platane -
la cage de branchage
chargée de fruits jaseurs
est un orchestre en lambeaux
d'aile noire
qui s'essaie à voler
puis soudain se recompose
et laisse un grand silence
suivre l'ombre qui part
le jour peut se lever
- drapeau d’espérance
mattina grigia sul platano -
la gabbia dei rami
carica di frutti rumorosi
è un'orchestra in brandelli
di ali nere
che tenta di volare
poi all'improvviso si ricompone
e lascia un grande silenzio
seguire l'ombra che fugge
il giorno può sorgere
- bandiera di speranza
(publié en Italie, dans Book of Joy, d’Elisa Pellacani, ed. Consulta, 2025)