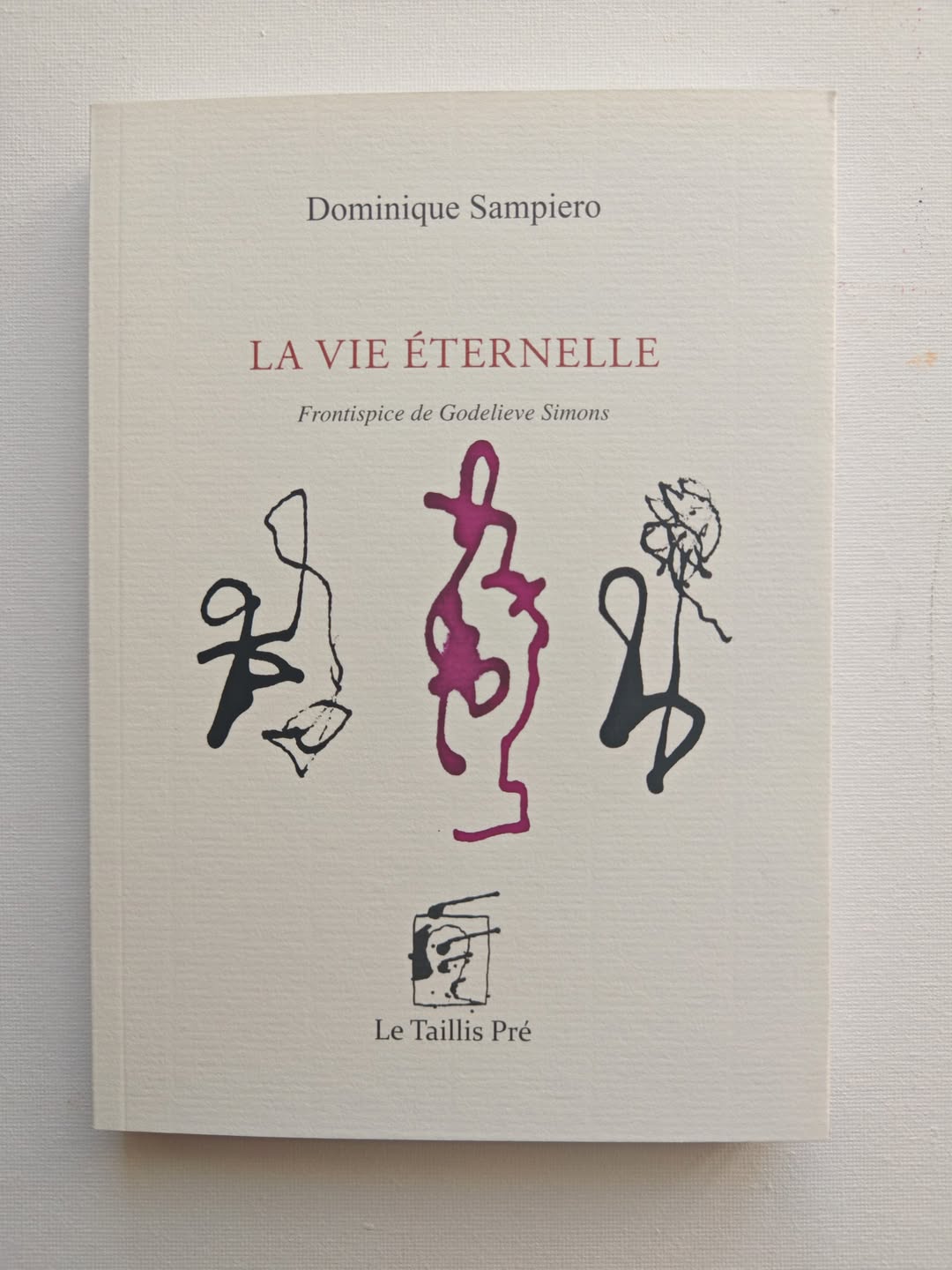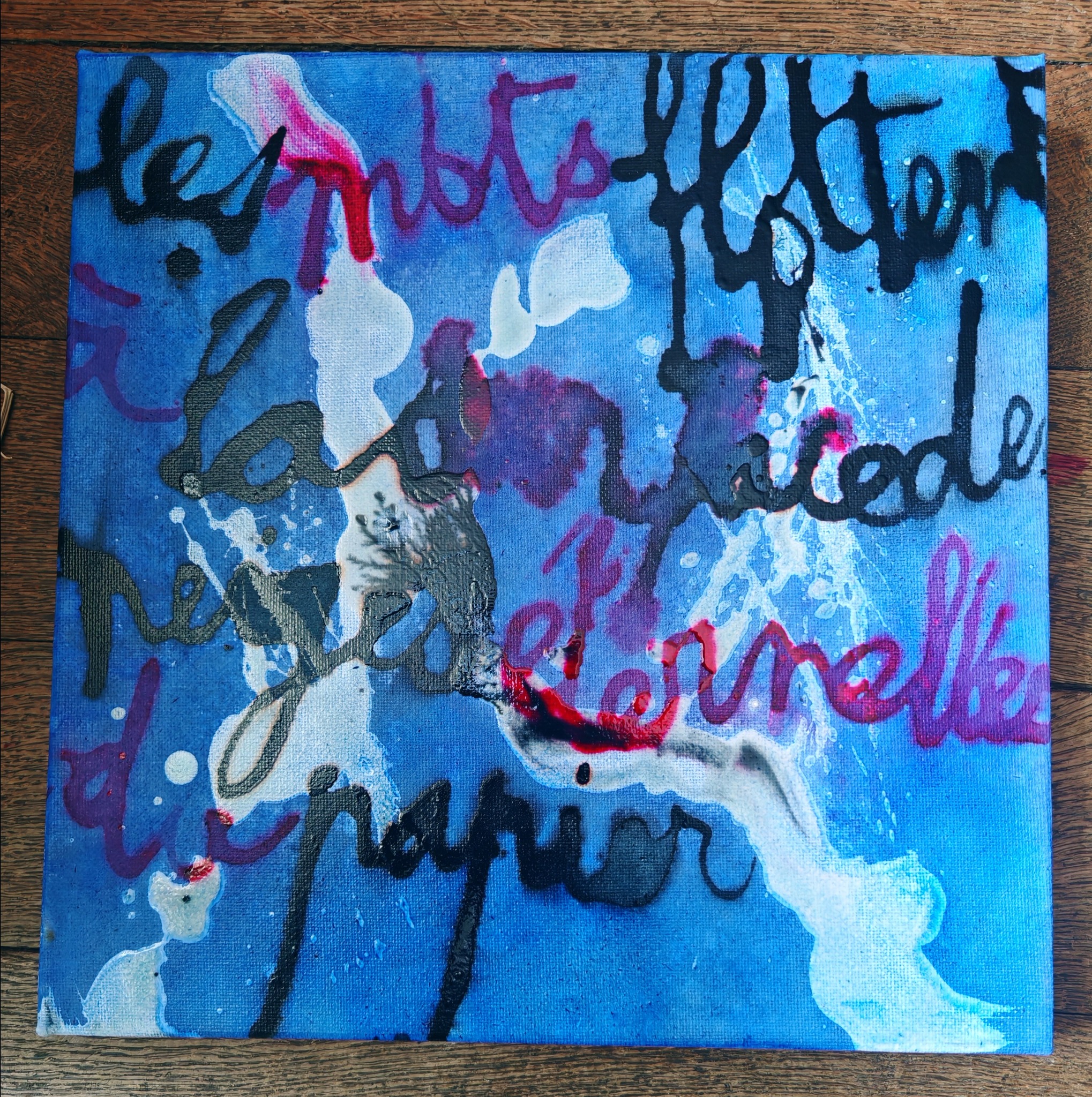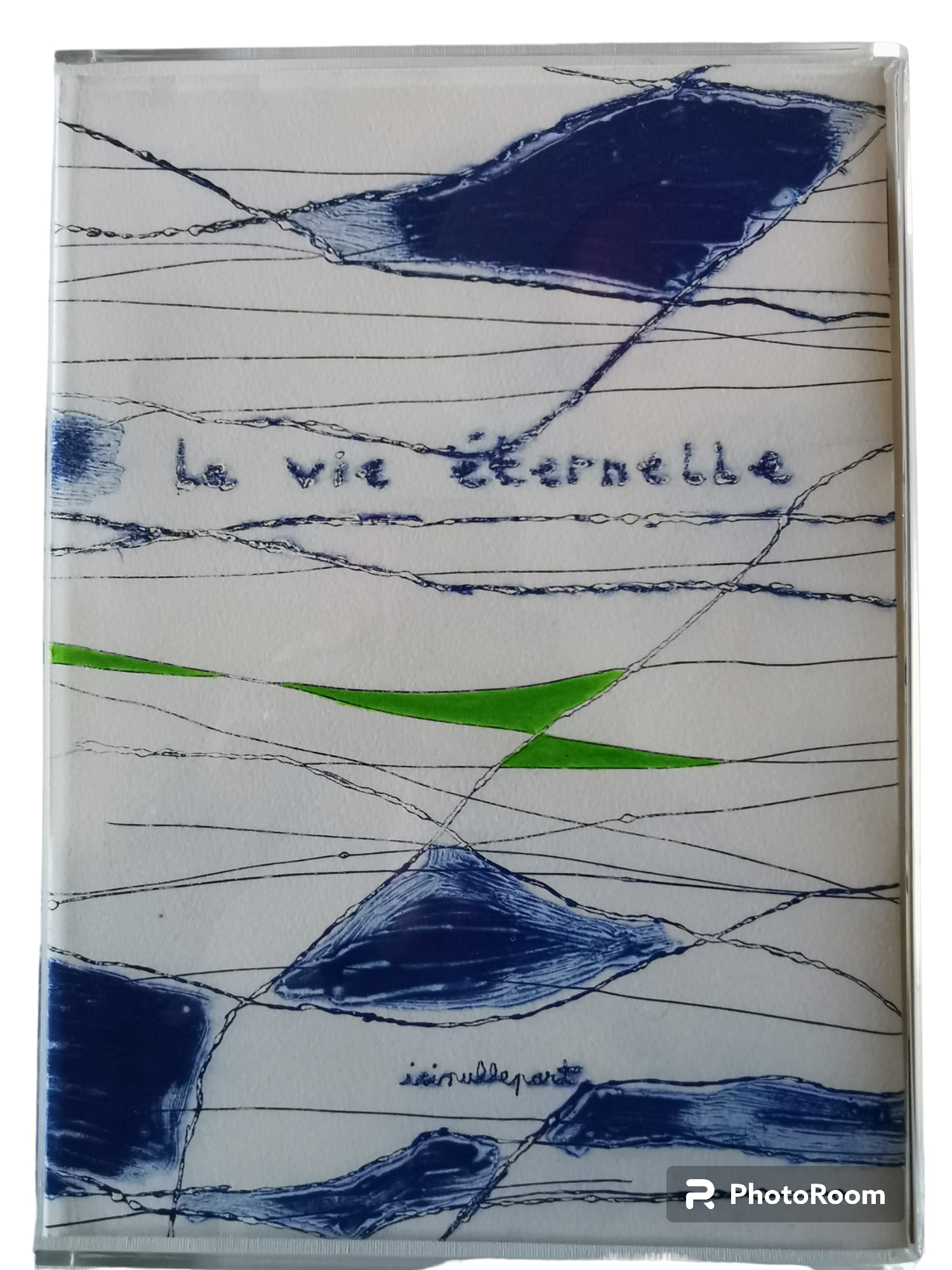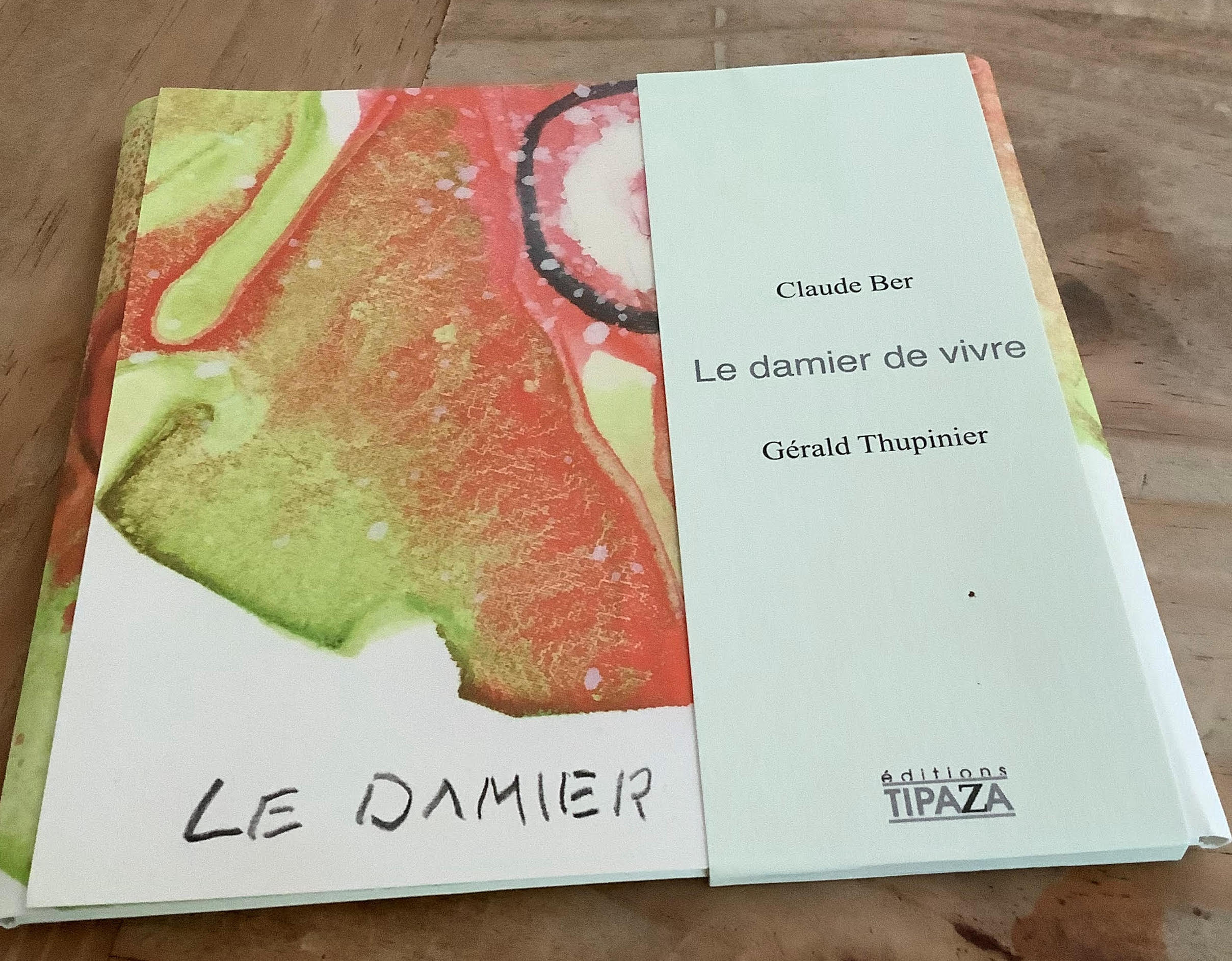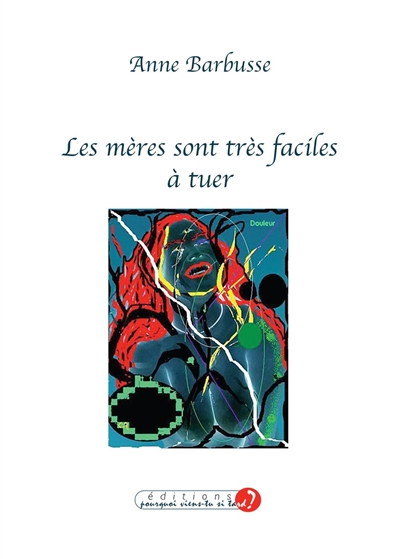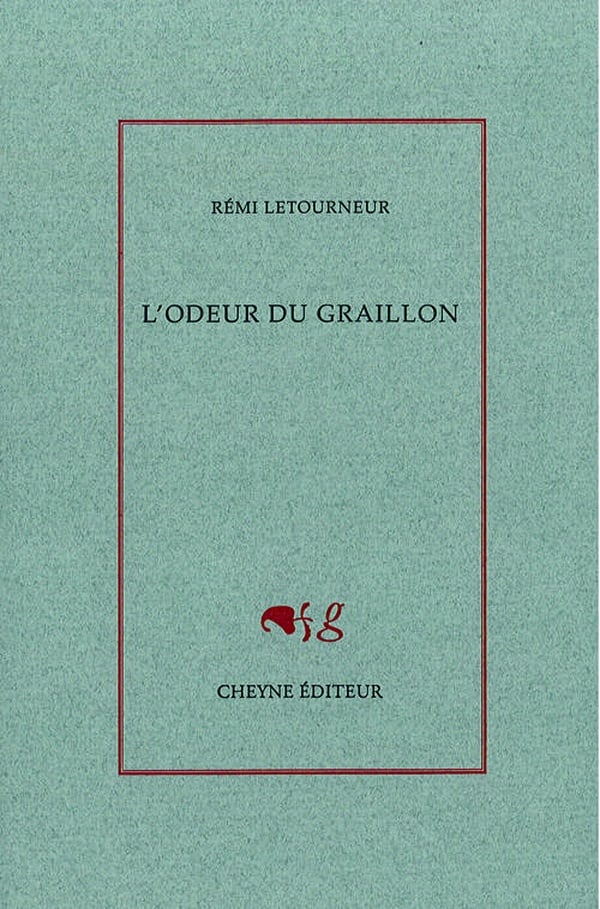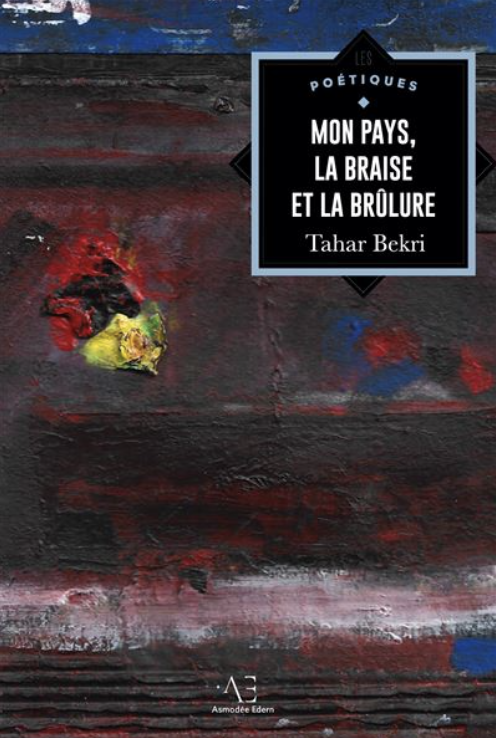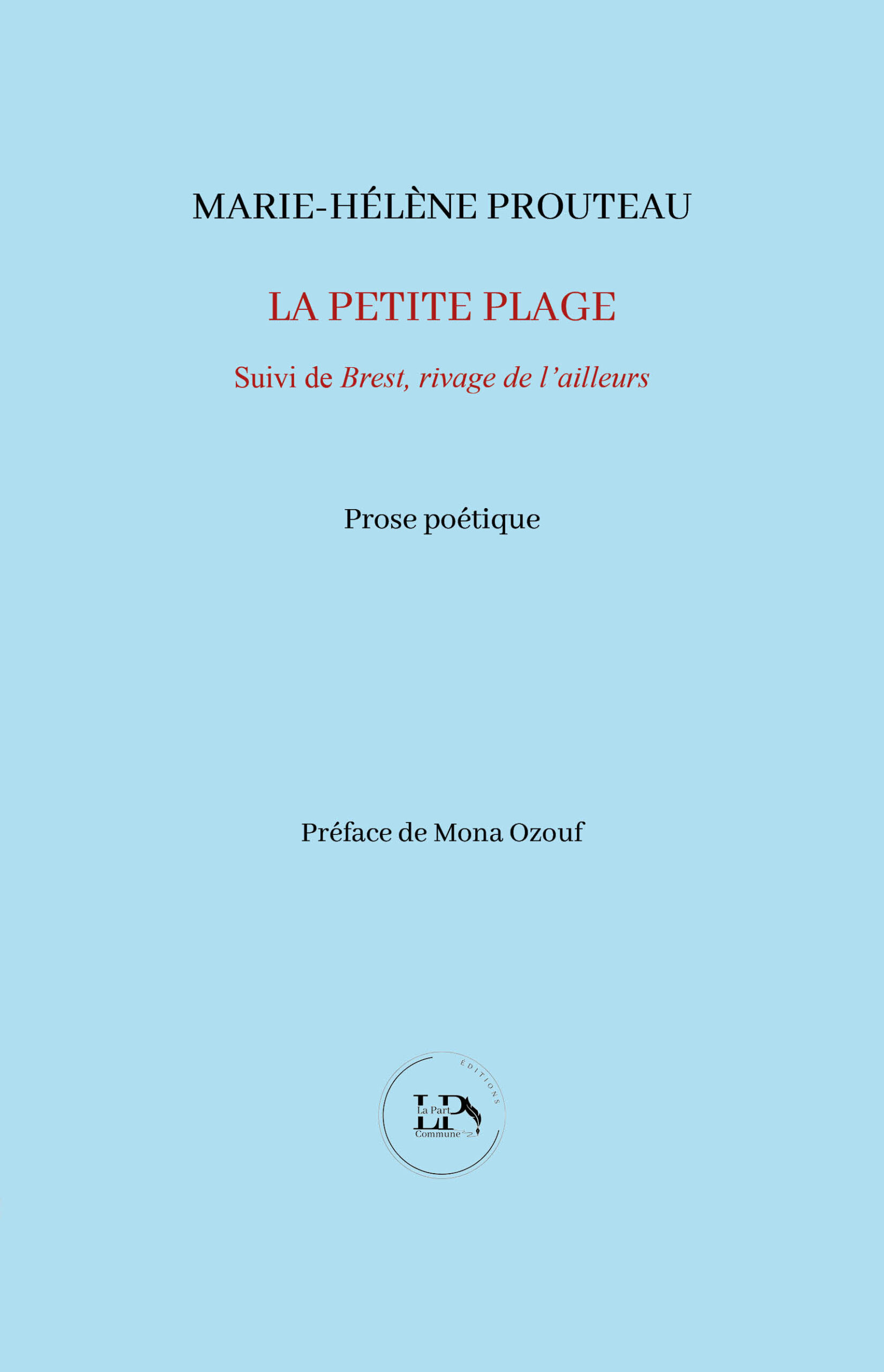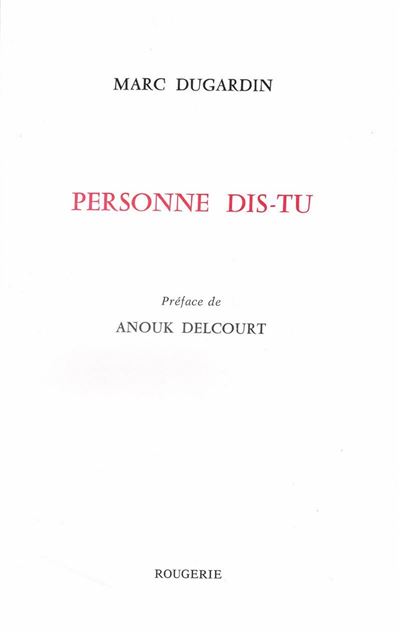Adeline Miermont Giustinati, Poèmes
je glisse dans une fente de la souche
recouverte de laine
pulsation de caillou
je flotte dans le ventre de l'arbre
dans la nuit des racines
le silence désossé
j'aperçois des portes d'ivoire
un tunnel tapissé d’œillets rouges
et des lamelles de brume
je rampe dans une fosse
des ombres tremblent
des vents s'épuisent
j'atteins un palais aux pierres bleues
devine la matrice de l'outre-monde
je rencontre le fantôme du soleil
et les ossements de la lune
je quitte ma peau de laine
le silence s'élargit à mon passage
des oiseaux sans plumes font leur nid dans ma gorge
je suis tous les visages
toutes les écumes
je gravis une grande cité
je traverse une croûte de fer et de nickel
je goûte aux entrailles de Pangée
me frotte contre le magma noir et durci de sa bouche
je me lamente dans une steppe interminable
je me noie dans un fleuve
tapissé de coraux et d'insectes
je m'accroche aux cheveux de Méduse
j'atteins la maison de l'obscurité
je n'ai plus de souffle
je n'ai plus de visage
je n'ai plus de squelette
je tremble aux pieds de la déesse
elle ouvre grand sa gueule
elle m'engloutit entièrement
elle me mâche goulûment
je naufrage dans sa poitrine
j'emprunte l'échelle d'entre les mondes
les eaux elles-mêmes chavirent
je n'ai plus de souffle
je n'ai plus de visage
je n'ai plus de squelette
j'expire mon dernier atome
je retourne à mon argile
au tambour du commencement
et au fleuve qui coule dans mes racines
extrait de « la mue » (inédit)
∗
marcher
un pas devant l’autre
un mot devant l’autre
marcher
parmi les herbes grasses
encore brillantes de gouttes d’eau bien fraîche
parmi les roches imposantes
le long du sentier escarpé
le long de la côte
entre deux immensités
entre l’avant et l’après
entre se réfugier et se jeter à l’eau
marcher entre
dans sa propre peau et son propre pas
marcher
parmi les genêts en fleurs
le jaune se mêlant au bleu au blanc et au brun
je suis ivre de couleurs et de
pensées traversantes
qui affluent
au rythme de mon souffle et de mon pas
le mouvement de mon corps est un coryphée
au paysage alentour
marcher
au son de la rumeur marine
foire d’écume contre les rochers
en contrebas
j’entends la voix de la pierre
se mêler à celle des oiseaux
c’est le printemps
je crée mon chemin
chaque pas est l'empreinte d'une promesse
inédit, 2025
∗
les premiers temps j’avais le corps en friche et
la cervelle poisseuse
mon terrier était devenu caduque
ma forêt était en dormance
mon regard s’était calcifié
et le courage de regarder l’horizon
par delà la timidité des cimes
me manquait
les jours
et les nuits
ont passé
sans rien dire
et
ton souffle
ton souffle qui a traversé ce jour-là ma peau
ton souffle qui a transpercé ce jour-là mes muscles
ton souffle tend désormais
tout doucement
ma colonne vertébrale
ton souffle fait vibrer les racines de mes allées
je m’en remplis
je le bois
le moindre geste fait craquer des bouts de souvenirs de nous
l’horizon avale le jour et chaque matin le soleil revient avec ton odeur
à cause de toi je mets un pas devant l’autre
à cause de toi je mets un jour devant l’autre
à cause de toi je mets un mot devant l’autre
les sapins me parlent à nouveau et
reboisent mes cellules
leurs sourires caressent mon écorce et
je sens mon courage se ramifier
désormais le souvenir de toi
ne me déchire plus le ventre
il s’est métamorphosé en
une source chaude jaillie des profondeurs
une présence diffuse le long de mon dos
un vent tiède sur ma peau désertée
un mica scintillant dans mes organes
même si je suis toujours comme l’akène
ce fruit sec qui ne s’ouvre pas et
ne contient qu’une seule graine
je joins les mains et j’espère
que
comme au désert d’Atacama
il suffira d’un filet d’eau
pour fragmenter mon écorce
et faire pousser des merveilles
inédit, écrit et lu pour La P'tite veillée de Chloé, Chez Mona, mars 2023
∗
sous ma peau
il y a une femme
quelqu'un l'a laissée là
de dos
assise
la tête penchée
sa main appuyée
contre ma craie
dans la galerie profonde
dans la pénombre
elle n'entend ni le vent ni les oiseaux
ni les hommes ni les femmes
juste le bruit sourd des pioches et les pas des soldats
dans sa galerie il n'y a ni arbres
ni paroles
ni naissances
juste le silence de l'eau qui perle sur son corps
elle a vu passer les visages
elle a senti la peur dans leurs souffles
la peur des hommes prêts à mourir
elle a pris leur douleur
leurs regards de bêtes sonnés
quand les chariots avec les corps
ont défilé
dans un chaos de métal et de sang
elle qui tournait le dos
elle a tout vu tout reçu
les fusils les cris le désordre
elle a tout gardé
elle en perd l'équilibre
elle se tient
fragile
prostrée dans sa peau
incrustée dans ma chair
ma mémoire calcaire
depuis trois décennies elle sent
que des êtres la scrutent
que des lampes l'observent
sous toutes les coutures
elle ne dit rien
elle sait tout
elle tourne le dos
aux passants des galeries
elle voudrait oublier
le chaos
le sang
le métal
les cris
les chariots
remplis de corps
comme des poissons tordus de douleur
elle voudrait parler
elle voudrait raconter
comme ces hommes étaient beaux
dans leur courage et dans leur peur
que le pays à tous manquait
qu'elle pleurait le soir
à les voir
regarder les photos
les trésors de leurs poches
les amis les mères les soeurs
les pères les frères
les voisins
ils allaient mourir bientôt
ils le sentaient
ils regardaient les photos
ils priaient
ils dessinaient
ils gravaient
des mots qui font vivre
et des visages d'ancêtres
et un dos de femme
nu
extrait de Kauhanga, inédit, 2024