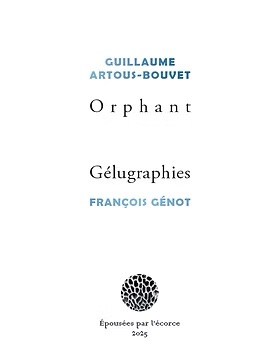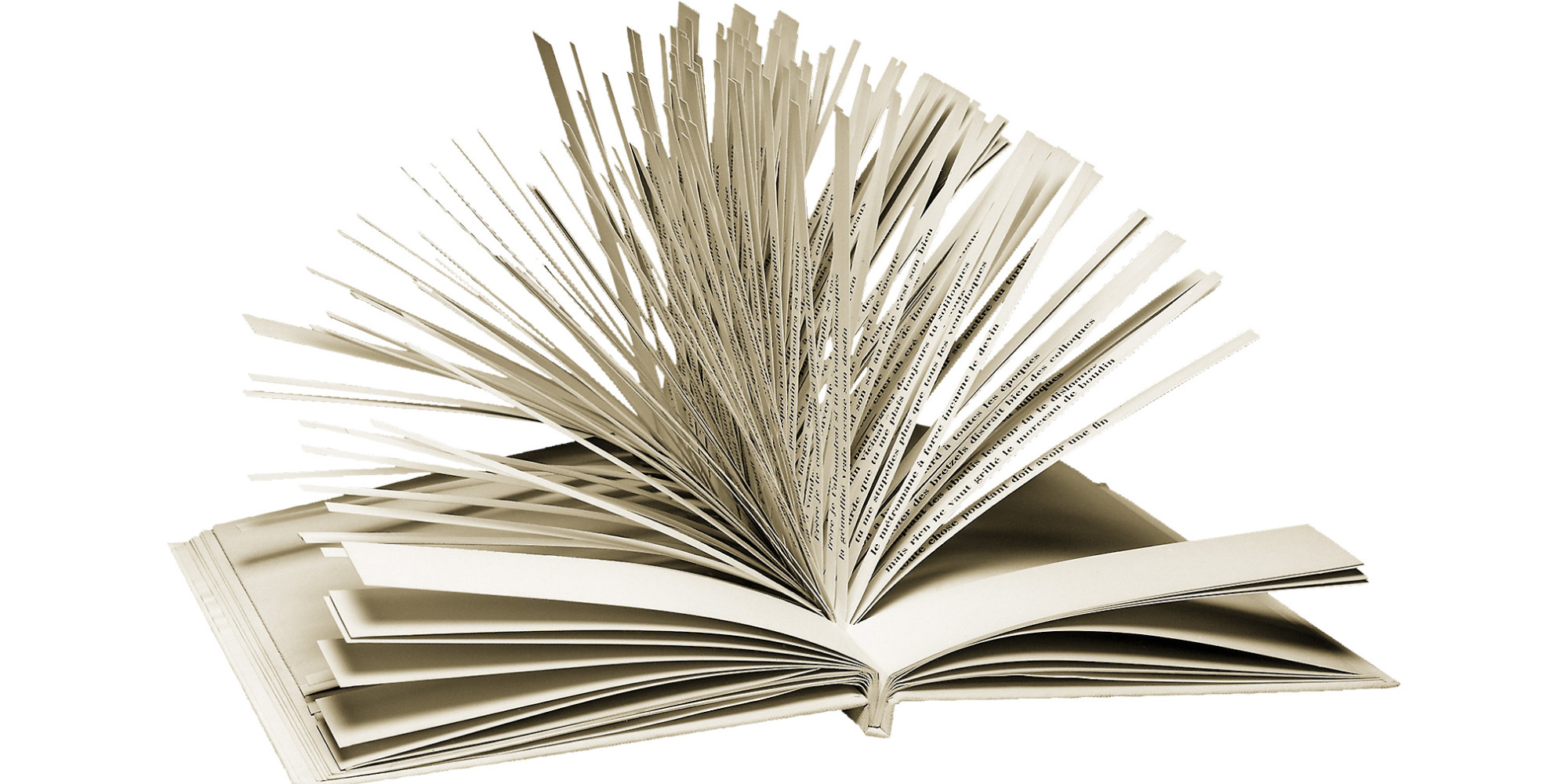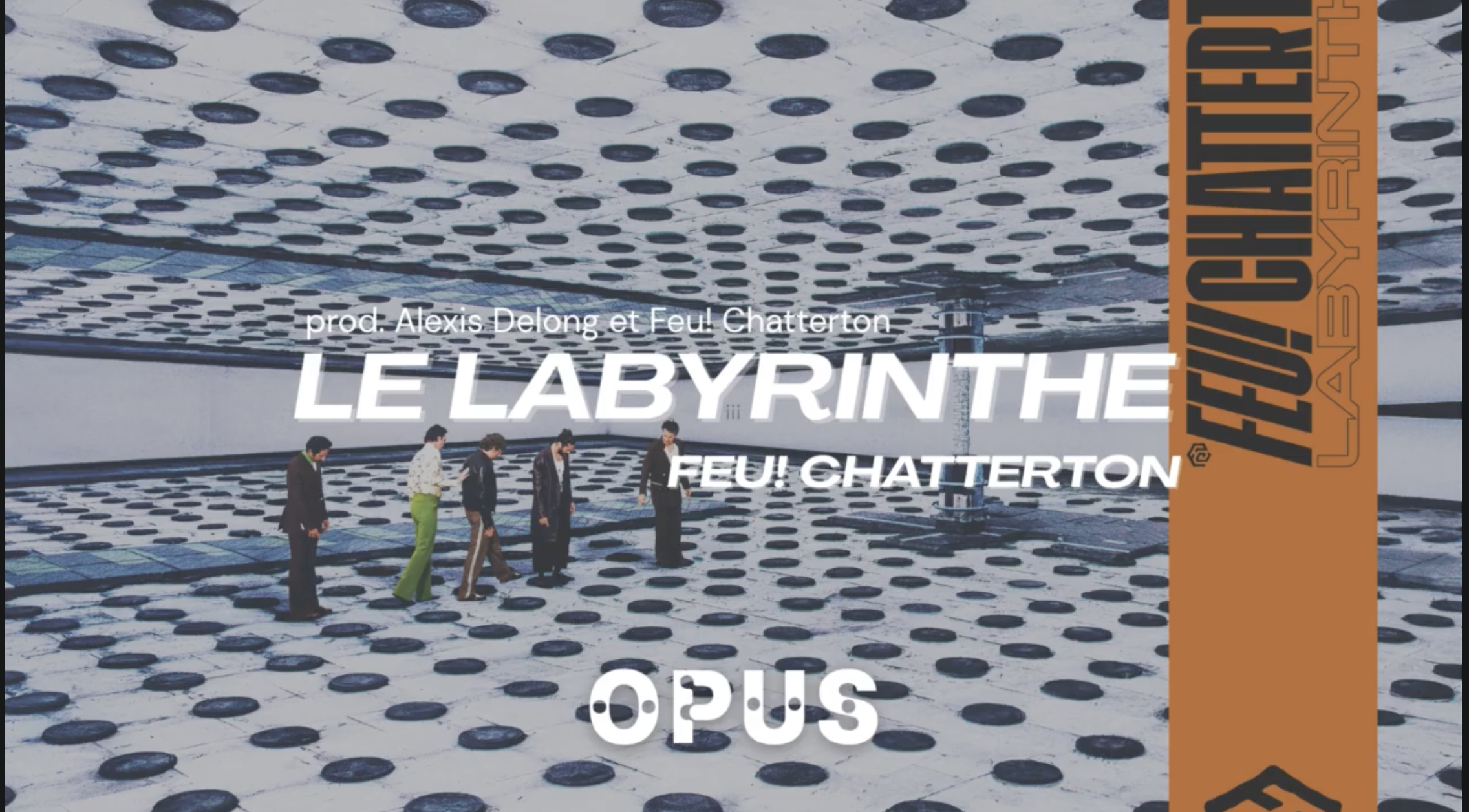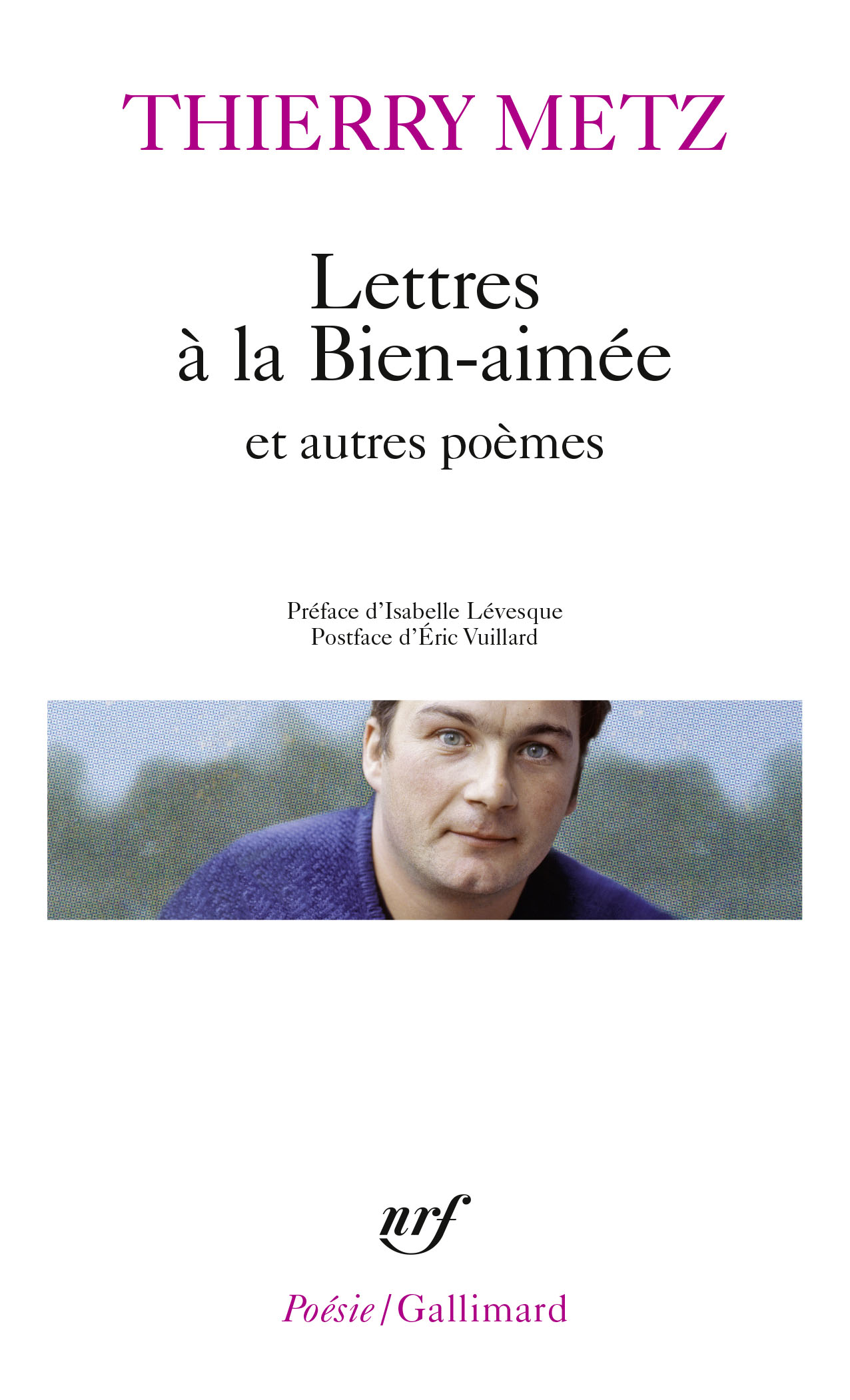Sur le bout de la glotte
L’Institut culturel aimait travailler avec moi. Depuis quelques mois, du moins. J’en étais vaguement interloqué mais plutôt heureux. Je le vivais comme une sorte d’élection, presque de promotion. Un jour, la responsable m’avait entendu dans un débat sur la littérature hongroise, et elle s’était rappelé mon existence, qu’elle avait oubliée sept ou huit ans plus tôt alors que j’avais déjà passé une tête dans des débats de l’Institut culturel. Depuis quelques mois, j’y avais passé tout le corps, on aurait presque dit que j’y passais ma vie. Disons que j’y suis revenu trois, quatre fois, en un temps record. Une coqueluche.
Je ne suis pas spécialiste de la langue de l’Institut. J’en ai chanté des comptines, traduit quelques poèmes, j’ai fait quelques voyages dans le pays, glané quelques diplômes çà et là, à la valeur toute relative. Dans ma vraie formation initiale, on ne pouvait pas faire de séjours linguistiques : littérature française, latin, grec.

Quant à mon autre grande passion, c’est la langue et la littérature hongroises. Aussi, ce soir là, je ressentais quelque appréhension à présenter une soirée avec deux vraies grandes traductrices professionnelles de la langue de l’Institut. Mon baluchon de bon élève ne faisait pas contrepoids à l’angoisse. Je jetais toutes mes forces dans mon point faible. J’avais lu leur livre avec passion, griffonné les jolis beaux volumes au crayon à papier, comme j’aime faire avant les rencontres littéraires, reconnaissant envers l’existence des points d’exclamation, d’interrogation et surtout des smileys pour marquer les passages émouvants, étranges et humoristiques. J’avais pris, comme souvent, des notes sur de multiples feuilles volantes, tel le gamin de L’Argent de poche, prêt à y fourrager comme dans des feuilles d’une salade livide, le jour J, comme si l’angoisse de ne pas trouver la question suivante activait mon cerveau…
C’est bien ainsi que je procédais ce soir-là et le débat semblait s’être plutôt bien passé. À vrai dire, à côté de la finesse d’analyse des deux traductrices, j’avais un peu l’impression de jouer l’Appassionata avec des moufles mais enfin, de fil en aiguille, les choses se sont mises en place, le dialogue a eu lieu entre elles, entre nous et même avec la salle. Les gens du public sont repartis heureux avec leurs livres dédicacés. Le mien, consacré aussi à la traduction et que l’Institut culturel avait pris la peine d’annoncer et proposer également à la vente, est resté vierge d’acheteurs : les modérateurs ne sont pas les auteurs, aux yeux du public, pas plus que, suivant le proverbe, les conseilleurs ne sont les payeurs. La séparation des genres est ici de l’ordre du dogme, de l’interdit ontologique. On ne franchit pas si facilement une telle frontière. On ne change pas de casquette à vue, et la retourner reste mauvais genre. Bref, nous nous acheminions doucement vers le dîner traditionnellement offert par l’Institut culturel après ces rencontres, ripailles financées par la Centrale au nom des « coutumes locales » – ah la gastronomie française… La troisième mi-temps commençait, joviale. Je sentais confusément que l’occasion m’était donnée de démontrer que je n’avais pas que des moufles et des gros sabots, que je pouvais articuler quelques gammes délicates en société, produire avec prestance quelques entrechats de conversation.
Tout commençait à merveille avec quelques gentils traits d’esprit visiblement appréciés de mes consœurs elles aussi plus détendues. Forcément, n’étant pas un spécialiste de la culture ni de la langue de l’Institut, c’est le hongrois qui est devenu le terrain d’exploration favori de la conversation… D’ailleurs, entre spécialistes d’un domaine on ne parle pas plus de sa spécialité que de corde dans la maison d’un pendu. Lors de la troisième mi-temps, la coutume locale veut que l’on ne discute jamais de ce que l’on a en commun. On ne parle pas boutique. On trouve un terrain tiers. On s’ouvre à l’autre sur ce qui le différencie. Tout allait parfaitement bien, je continuais à égrener quelques bons mots au gré des questions grammaticales et lexicales de mes amies, quand soudain, l’une d’elles, traductrice et écrivaine très impressionnante, me demanda en plein milieu de ma tirade : « D’ailleurs, comment dit-on cerise en hongrois ? » Comme cela, à brûle-pourpoint, sans raison, la question a fusé presque comme un reproche, et je me suis arrêté net de parler tout en fixant son regard attentif. J’ai freiné brusquement et versé dans le fossé. « C’est…cerise en hongrois… c’est… non, non, c’est cse…, euh cse quelque chose, euh, je ne sais plus, csecse… oui, non, euh, csecse ».
- Ha ha, c’est csecse alors en hongrois me questionna, interrogatrice et réprobatrice la responsable de l’Institut culturel. Alors c’est « tchêtchê », hein ?
- Euh presque, je crois, je…non, c’est…
Décrire l’ambiance de glace qui a commencé à étreindre et étrangler le dîner, je ne saurais le faire. Tout ce que je disais semblait désormais suspect. Les yeux se plissèrent sur l’imposteur. Quoi ? Il traduit du hongrois et il ne sait pas dire « cerise » ? C’était d’autant plus grave que je venais justement d’expliquer la façon dont j’avais traduit des poèmes slovènes sans connaître la langue… et que j’avais découvert à cette occasion le nombre des mots slaves présents dans le hongrois… Imposture sur imposture, belote et rebelote… Mais cerise, à propos… ?
Je tournais et retournais la question dans ma tête, tandis que nous quittions le fromage pour la poire. « Mais pourtant, c’est cse… ». Je m’arrêtais là à chaque fois. Csernye ? Et le cerisier csernyefa ? Non, non je confonds ocsi csornye et La Cerisaie…Ah, les gros yeux noirs des cerises… Rien à faire, le mot ne me venait que sous une forme tronquée… Pourtant, c’est comme en russe, avais-je essayé d’articuler justement, sauf qu’en russe, c’est… ? C’est quoi ? En allemand au moins, me demandais-je à part moi, je le sais… Mais le mot ne me venait pas davantage… Cherry en revanche me trottinait, trottait, que dis-je galopait dans la tête avec un son de grelot insolent, cherry cherry cherry cherry… Cherry, je ne t’aime pas, cherry je ne t’adore pas… Je prétextais alors minablement, dans une incise, que ces derniers temps je n’avais pas beaucoup traduit du hongrois et tâchais, de toutes les forces de mon amertume hébétée, de terminer la soirée à la manière d’un match de football raté – avec le visage impassible du joueur qui a mis son pénalty au-dessus de la cage à la 75e minute et continue à jouer au ballon, il le faut bien puisque le coach ne veut pas le sortir, mais qui poursuit en fuyant tout éclat, par pur acquit de conscience, pour dissuader du lynchage par la sobriété de sa mécanique musculaire, la banalité de ses contrôles et de ses contres, la sueur de son rostre incliné.
Pour l’allemand, c’est le lendemain seulement, dans l’après-midi, que Kirsche m’est revenu, remonté comme un petit soleil rouge du fond de ma mémoire, et surtout bien classé comme sur un livre d’image à côté de sa sœur et quasi homonyme l’Église, Kirche, elle-même se déroulant aussitôt en chapelet avec Küche et Kinder… Il était temps qu’un cliché vienne à ma rescousse…
Mais en hongrois, dans ma langue chérie, la cerise restait bloquée au seuil du cerveau, démesurée pour franchir mes synapses. J’ai donc fini par prendre le dictionnaire. Et j’ai vu : cseresznye. La honte m’est à nouveau tombée dessus comme une visière. Des stryges me croassaient aux oreilles mentales « Csecse, csecse » avec des ricanements de mouettes, ce qui dans leur langue signifie (car bien sûr je parle stryge) : « Gros crétin ! ». J’essayais de me sangler dans une excuse quelconque, de toutes les forces de ma mauvaise foi. Ma mémoire s’en mêlait. Le rythme et les rimes merveilleux de la rime « csecse/becse » du célèbre poème « Pour mon anniversaire » d’Attila József, tournaient et retournaient dans ma tête, comme des castagnettes consolatrices – l’inverse de celles du rêve du Vertigo d’Hitchcock :
Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse
Années, voici ma 32ème –
Ma surprise ? C’est ce poème
le beau
bibelot
Tout le poème joue sur un même procédé – un mot coupé en deux qui rime avec lui-même (« csecse/becse »), ce que je n’ai pas réussi à rendre totalement avec « le beau / bibelot ». Y a‑t-il un terme savant pour décrire ces rimes intérieures tirées d’un seul et même vocable ? Comme il doit être beau, ce terme, cet anacoluthodiplose qui manque à mon vocabulaire… Peut-être ressemble-il, comme si souvent, à ce qu’il décrit, telle l’anapeste deux brèves une longue, tel le spondée deux longues, tel le dactyle une longue deux brèves, telle l’ïambe une brève une longue, tel le trochée une longue une brève ? Ah l’anapeste de Budapest… Voilà que je dérive sur le Danube… Chacun comprend bien pourquoi je ne sais pas dire « cerise » : qui trop dérive mal retient… Si je pouvais au moins m’attacher à une branche du fraisier sortant de son feuillage, « az eperfa lombja » (« le feuillage du fraisier ») de mon cher Kemény, l’un des rares poèmes du H muet (A néma H) que je n’ai pas traduits… Et si c’était pour cela que je ne savais plus dire cerise ? À cause de la fraise ?… Non, non… J’essaye vraiment de me raccrocher à toutes les branches de salut que j’entrevois au bord ou au fil de l’eau, même des fruits qui n’en ont pas (c’est le cas des « baies de la terre », les Erdbeere, les fraises qu’on écume au ras du sol) :
Aux branches
Aux planches
Csecs, tss tss…
Est-ce qu’il y aurait des mots autorimes (appelons-les ainsi) en français qui me permettraient au moins de rendre csecsemecse à défaut d’avoir retrouvé cseresznye au dîner de l’Institut culturel ?
Beau Brim-
borion
Cela ferait une sorte de rime de début de ligne entre beau et –bo… Pas très orthodoxe du point de vue sonore, il faut bien le reconnaître. Voilà qui plairait à l’ami Vinclair.
Ah je pourrais tenter un jeu de mot :
Joli
Fichet
Mais outre que cela ne rime pas, à aucun moment le poète hongrois ne qualifiait son colifichet, c’est moi qui ai, pour la rime, introduit l’idée d’un « beau bibelot », et me voilà qui avance de liane en liane dans l’inexactitude…
Ah, mais en voici un, plus que parfait, plus qu’une autorime, une auto-holorime :
Jou
jou.
Trop court hélas…
Faut-il dire :
Un chou
Joujou
Ou mieux :
Un jou-
Jou chou.
Peut-être, oui, mais c’est une satisfaction qui n’a rien d’un fruit rouge bien rond en bouche… Une compensation peut-être, bien que « joujou » ne rende que de bien loin « csecse »… Faute de griottes se contenterait-on de joujoux-choux, petit clin d’œil au Bled de jadis à la clef ? Parlons-en des griottes – quand j’ai cherché « cerise » dans mon dictionnaire en ligne, il m’a aussi donné « griotte », que je connaissais bien sûr (bien sûr, bien sûr) : meggy. Un mot amusant parce que c’est un homonyme presque parfait de « megy », « il (ou elle) va ». Au fond, un csecsemecse, à sa manière, en tout cas par association, par destination si l’on veut, un « megymeggy » (et vogue la griotte). En tout cas, ce soir-là, je n’ai pas non plus pensé aux griottes… C’était cerise ? néant, cerise ? cse quelque chose, cerise ? néant, cerise ? cse cse, cerise ? csernye, cerise ? non ça c’est les yeux noirs, cerise ? cse cse ? cerise ? bê bê. Voici pour mon encéphalogramme entre la poire et le fromage.
Plein des gens, je le sais, s’en seraient bien mieux sortis que moi. Ceux qui ne perdent pas leurs moyens devant une question embarrassante, qu’ils savent éluder avec une assurance toujours agrémentée d’un soupçon de dédain.
Voici leur méthode.
Version primaire : je n’ai pas entendu et je change de sujet.
Version péremptoire : « Non, non (voire « t’t’ », bruit de la langue sur le palais), les noms de fruits ne sont pas les plus significatifs ! ».
Version plus sophistiquée : « Non, avec cerises justement ça ne colle pas, mais avec framboise oui ! » Et de dérouler…
De fait, outre tout ce à quoi mon cerveau était occupé (la langue de l’Institut culturel, mes moufles sur le piano, la troisième mi-temps…), je pensais très fort au mot málna, framboise, parent du malina des langues slaves. En somme, ce n’était pas la cerise sur le gâteau ni l’arbre qui cache la forêt mais la framboise qui cachait la griotte…
Je ne fais clairement pas partie de ces élus de l’habileté sociale qui se sortent de tous les mauvais pas par un salto arrière bien propre. Au contraire, j’appelle à moi les phares comme un acteur les feux de la rampe, je me mets bien en face d’eux, je fais freiner le véhicule et l’on découvre que le responsable de l’accident n’est même pas un beau cerf, mais un petit lapin.
Comment un traducteur du hongrois ne sait-il pas comment on dit cerise ?
Comment peut-on être persan ?
Ah voilà encore une citation salvatrice… Qu’insinuent les pages roses de mon inconscient qui s’insinuent à chaque difficulté ? Que tout cela serait à ironiser, que ces dames n’ont pas de questions de hongrois à me poser, qu’elles n’ont pas de leçon de maîtrise de la langue à me donner, qu’un dîner n’est pas un grand oral… Peut-être, mais enfin… Connaissez-vous un seul traducteur chevronné d’une langue qui ne sache pas dire un mot aussi courant et, loin d’avouer vraiment le trou de mémoire bête, se met à bégayer ?
Maudit csecs (mamelon, lolo – évidemment le « csecse » de « csecse/becse » veut dire « son lolo » mais c’est une fausse piste génialement créée par le poème en coupant le mot en deux… quelqu’un pourrait toujours s’amuser à traduire : « bibe/lolo »), affreux csecsen (Tchétchène), csecsemő, autre mot qui m’est venu tout de suite après… Le nourrisson ! Mesdames, pardonnez-moi, mais tout de même : je ne sais pas dire « cerise » mais je sais dire « nourrisson » qui lui ressemble !
Cela n’a aucune importance, me répondrez-vous, ce qu’il faut, c’est savoir le mot que je vous demande, pas le mot d’à côté, et, plus encore, tous les mots, tous les mots courants en tout cas, au rasoir, comme disent les comédiens. Imaginez-vous un comédien qui ne saurait pas comment parle Cyrano ?
Et qui au lieu de :
C’est queuqu’ navet géant ou ben queuqu’ melon nain…
Dirait… vous m’avez compris… »
Non, mon erreur n’est pas que queuqu’queues de cerises. Hélas, c’est bien le fruit de mon incompétence. Ou bien ? Hourrah ! Serait-ce celui de mon inconscient ? Serait-ce la faute à Rousseau et à son « idylle des cerises », ou à D. H. Lawrence et la superbe scène de Sons and lovers que je donnais à traduire à mes étudiants anglais ? Serais-je fâché avec le temps, ou juste le teint des cerises ? Ce fruit oublié sera-t-il à jamais mon nez de clown de Christian démasqué sur les épaules de Cyrano… Un Cyrano qui, comme pour nous tous, s’appelle google… Car n’est-ce pas à force de traduire sur mon ordinateur, à force de vérifier les mots sur les dictionnaires en ligne que j’ai transformé ma tête en une passoire, en une pastèque pleine d’eau rouge, cerise géante sous son écorce verte ?
Oui, je n’ai pas le choix : il faut remettre en cause ma manière de travailler, d’apprendre. Essayer de comprendre les causes de l’impasse.
D’abord, je pourrais dire que c’est parce que je fais de la version, pas du thème. Voyez-vous, je reconnais très facilement le mot cerise dans un texte. Facile, c’est cse…cse…csernye…euh cseresznye… mais oui, et cseresznyefa est encore plus simple –fa voulant dire arbre, il va de soi que c’est bien de cela qu’il s’agit et non d’une confusion avec nos amis csecs, csecsebecse, csecsemő (je ne parle même pas de la csecsemőhalandóság, la mortalité infantile, car nous sommes au pays de Semmelweiss), je laisse de côté csésze (la tasse, on voit bien que l’étymologie arabe est la même qu’en français), à ne pas confondre avec « cseszés », « le frôlement », puis « la baise », allez savoir pourquoi, Csesznek (qui veut dire aussi « ils sont foutus » ou « ils baisent », allez savoir pourquoi) mais qui, avec majuscule, est un village hongrois du côté de Veszprém, cette magnifique fusion de « vesprée » et de « suprême »). Pour mémoire, citons aussi : csetepaté, l’escarmouche, avec lequel on aurait pu aussi faire un :
csete
paté
Simple assonance, mais qui semble démontrer que le hongrois est plus riche que le français en mots autorimants (dénomination voisine, renvoyant discrètement à la notion de four autonettoyant).
Mais vais-je vraiment me lancer dans la traduction de csetepaté sous prétexte de csecsebecse ? Je me vois déjà en train de chercher, en vain et vainement, une escar/mouche, une échauf/fourée en miroir… Stop ! Une cerise comme un sens interdit. Route barrée.
Alors pourquoi cet oubli ? Eh bien voilà, c’est qu’il y a des mots qui font plus ou moins partie de mon vocabulaire passif, ou actif, surtout en France… Voilà une manière bien laide de dire qu’il y a des mots avec qui je ne suis pas encore ami. Je les connais, bien sûr, mais ils ne font pas partie du premier cercle. Ils sont du deuxième ou du troisième, comme les garçons de l’autre classe, de l’autre côté de la cour. Je les connais de vue, je les observe du coin de l’œil, je les reconnais si besoin, mais d’ici à citer leur nom… Je dirais même plus. Les connaître du coin de l’œil, ne pas savoir leur nom me donne…un certain avantage… Je les ai bien repérés mais eux ne le savent pas. Alors, s’ils s’avisent de faire un mauvais coup, j’aurais, moi, un coup d’avance, je serai déjà prêt à bondir, à parer, à fuir… Si je les connaissais, si leur nom s’imprimait dans mon cerveau comme tes dents sur les citrons amers, ils me verraient, puisque je les verrais, ils me connaîtraient puisque je les connaîtrais, ils s’installeraient dans mon cerveau, ils l’espionneraient, ils me paralyseraient…
Pour moi, pas de traduction sans cache-cache. Oui, le mot un peu mal connu, aux contours encore flous comme un fruit dans le couchant, lorsqu’il reparaît dans un texte reprend toute sa force soudaine, en une épiphanie triomphale – comme le soleil de Baudelaire :
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s’être lavés au fond des mers profondes.
Oui, j’organise l’amnésie. Je fais le funambule, depuis des années, entre l’hypermnésie et les abîmes de l’oubli. Je refuse la maîtrise rationnelle qui ferait de moi, justement, ce traducteur automatique, cette intelligence artificielle qui fait si peur à Diane Meur… J’orchestre presque, à cette fin, ma propre ignorance… Pour pouvoir voir un mot ressurgir du gouffre du néant dans toute sa gloire de mot étranger, apparaître dans le liquide révélateur, dans la chambre noire de l’omission… Je me refuse de l’apprendre par cœur dans ma chambre parisienne, ce mot « cerise » que je n’ai jamais encore vraiment eu l’occasion d’inscrire dans ma mémoire émotionnelle, là-bas, en Hongrie, contrairement aux moustiques (szúnyogok) du village de Nyúl (« Lsapin »), l’été 1997…
Je sais bien que si je n’étais pas autodidacte, je n’aurai pas de ces trous de mémoire splendides, de ces cerises wannabe proustiennes… Si j’avais fait hongrois, 1ère, 2ème et même 3ème langue, un curus aux Langues‑O, que sais-je… Mais le hongrois n’est pas pour moi une langue de l’école, je ne veux pas devenir interprète à la Commission européenne, je ne cherchais pas un job… C’est la langue du poème, une langue O, si vous voulez, mais dans un tout autre sens, celui d’un œuf d’autruche mystérieux, d’un « mont analogue » à la coque, d’une marquise de Kleist, d’un œil au beurre blanc sur le monde, langue de vide et de vertige, pas une glotte rouge comme une griotte… Diable, me direz-vous, que la mauvaise foi est bavarde ! Ce type ne pouvait-il simplement avaler des listes de vocabulaire, comme tout le monde ? Et vous aurez raison… Et pourtant… Et pourtant, elle tourne assez rond, ma théorie de la cerise, mon anamnèse platonicienne du lexique : apprendre, c’est se ressouvenir, c’est-à-dire oublier sans cesse, pour mieux se retrouver, mon enfant…
Et c’est aussi pour cela que j’aime traduire.
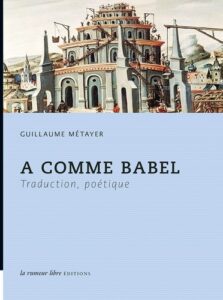
Guillaume Métayer, A, comme Babel, Traduction poétique, éd. La Rumeur libre, septembre 2020, 96p.
- Grzegorz Kwiatkowski, sillon nouveau d’un avenir poétique polonais - 6 mars 2024
- Pourquoi je ne sais pas dire cerise - 6 mars 2021