Réginald Gaillard et Pierrick de Chermont
Dans le livre de Réginald Gaillard, comme le signale la préface de Fabrice Hadjadj, un jeu de sens se fait entre verticalité et horizontalité. Qui cherche les barreaux de l’échelle qui monte aux Cieux peut les trouver dans les barreaux de fer de la fenêtre, s’il pense à regarder suivant l’autre axe des choses. De la même façon, dans ce livre qui participe, je crois, d’un renouveau historique de la poésie, la recherche de la transcendance se refait récit, se lit à nouveau à travers un cheminement diégétique manifeste. Est-ce curieusement que le nom du préfacier lui-même désigne en mots d’Islam celui qui fait le pèlerinage, celui qui fait le cheminement horizontal vers le lieu du sens transcendant ?
Le premier poème (dans la section des Kinderszene) donne le ton : poème strophique de plus de trois pages, composé de versets de trois vers non rimés, il sonne comme un poème narratif du temps des Romantiques, des Parnassiens, ou des Symbolistes, des Lamartine, Hugo, Musset, Lecomte de Lisle, Francis Jammes. Les poèmes suivants sont de thèmes aussi propices au récit : légende (noyade de l’enfant d’Istrie en pleurs), scène familiale (« Noli me videre »), réflexion sur la vie qui sépare (lettre à « l’ami perdu ») … Ils sont de formes et de mètres variés, en vers presque jamais rimés mais d’un si juste travail d’harmonisation, de retour échelonné des sons, qu’on n’a jamais une impression de prosaïsme sonore, d’idée sans forme.
L’harmonie, cependant, est délicate et ne résisterait pas bien aux marteaux-piqueurs du jour ; mais elle est en accord avec le caractère extrêmement soigné de la mise en page, ou avec la couleur même du papier, propre à l’éditeur et à la collection mais ici particulièrement seyante.
Pour les thèmes poétiques abordés, après celui de l’enfance et de sa confrontation avec la mort, voici, dans la section « Écarts », la femme, placée sous le signe devinable de la mythologie : femme au « cou de serpent » (est-ce Lilith ?), jeune fille aux yeux pers (est-ce Athéna ?), « babillage babélien », sacrifice barbare, animal et ancien : c’est le poème très beau et très court de « l’aubade à la gorge » (féminine sans doute) qui en même temps « à la gorge me prend », où le jeu de multiples sens accède aux vertus d’une concentration orgasmique et sanguine en son espace exigu de quatre vers brefs.
Celui qui dit, p. 23, « je ne sais ce qu’est la poésie – et ne veux le savoir » le sait, quoi qu’il en dise, ou en sait, du moins, assez long.
Et puis voici « Acédie et colère », le temps d’après les émerveillements premiers du désir. Voici « la fureur amoureuse », et voici le voile d’une sainte face humaine qui est celle de chaque homme souffrant (poème p. 45) ; elle nous ramène à l’idée de parcours, de chemin de croix, d’itinéraire biographique augustinien, et nous emmène vers (au-delà de la souffrance et de l’exaspération) « la gratuité de la beauté », la poésie donc.
Après le « dies irae », après la section « Lacrimosa » qui mèle à nouveau les poèmes très courts et le long poème VI (« Les larmes de Saint Pierre »), sorte d’oratorio en attente de son Charpentier moderne, vient la section « Naissance », plus directement religieuse.
L’harmonie serrée des vers s’y défait parfois un peu, au profit de la formule et de L’ÉNONCÉ, de la profession de foi martelée, plus militaire et cornélienne. La poésie du miles christi remplace un temps celle d’une mélancolie fusant vers la lumière incomprise et sensible ; mais ce n’est pas sans une émotion martiale qu’on lit la litanie des noms de poètes qui sont les référents déclarés de l’auteur, et comme sa profession de foi poétique.
Mais quelle est, ensuite, cette « maison vide » en son « trou de verdure » du poème III p. 87 ? Maison vide aujourd’hui de la poésie rimbaldienne ? Maison vide du temps présent tout entier ? Maison vide de la poésie toute entière, qui n’est pas comme on croit chant du Voyant, mais de l’Aveugle, pour Réginald Gaillard (« le poète ne voit rien – au mieux entrevoit-il »), comme l’annonçait déjà le poème « Psaume », p. 79, « in memoriam Ernst Wiechert » (« Aide-moi à voir le monde comme toi tu le vois / en aveugle. »)
Cette désertion de la maison conduit aux solitudes individuelles et alpines de la thébaïde monacale (poème IX p. 98), à
Gravir avec lenteur, là où disparaissent
les chemins, les sentiers, là où rien
n’altère la noble attente de la roche
[…]
la plénitude d’être là, si seul, ivre de toi.
Elle conduit, par variante, à la « solitude divine au cœur de la ville » (p. 100), mais aussi au « Retournement » de la dernière section, qui rétablit la condition poétique dans son horizontalité historique, celle de la « mémoire » et de « l’origine » des objets (p. 107), celle du « retour de l’aîné » (p. 108), celle de l’après et de l’avant (« avant que Philippe ne t’appelle », p. 109), celle du dialogue, non plus avec le divin par nature transcendant au temps, le divin vertical des sommets, mais, dans le temps se déroulant, avec « la femme du puits » (p. 111) : dialogue qui se déroule tout entier dans le temps du corps, de l’amour et de la mort, quand « passe le vent qui attise le temps » et qu’il fait passer de « soif » à « vraiment soif » dans l’expérience de la durée.
Au final, le poète restitué à sa temporalité se trouve donc placé au centre d’un triangle dont les trois sommets sont : 1- « la femme nouvelle, joyeuse et courbée » du puits de la rencontre, entre héritage et libération, 2- la liberté intérieure de l’homme « dénué d’autre juge que toi » (p. 113), et 3- la mort et sa vie éternelle, évoquée dans le dernier poème, « Envoi ». Cette triangulation définit à la fois la vie et la poésie, pour Réginald Gaillard ; elle permet le pas de confiant et d’aveugle qui les caractérise l’une et l’autre, éthiquement et poétiquement.
Je ne sais si cette voix d’homme et ces vers d’homme peuvent être pris et assumés également par une femme, s’ils veulent dire mixte la condition humaine, mais ils sont beaux. Et d’aujourd’hui car, je le redis, ils réinscrivent le temps du récit dans leur être et leur beauté.
N’en citons que les trois dernières strophes du recueil :
J’avance en aveugle avec pour clarté cette flamme intérieure,
jaillie d’une vieille tombe toujours chaude en terres froides
jaillie d’une église de Lyon, à Nizier dédiée, ce saint oublié.
Qu’elle me pardonne si je la nourris si peu.
Elle persiste et c’est heureux, et consume
la laideur qui souvent m’habite.
Je lui fais confiance, aveugle ; elle m’attend.
Car je sais qu’à la fin je serai, fidèle, son serviteur ;
alors alors plus rien d’autre n’importera.
*
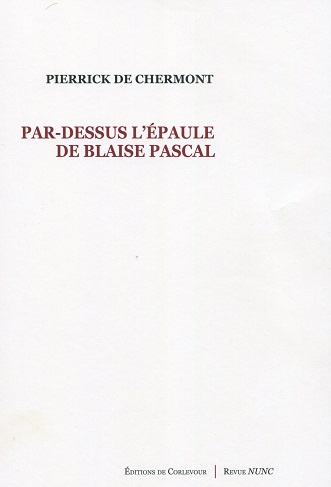
Point commun de Pierrick de Chermont avec Réginald Gaillard : la narrativité, quoique sous une forme tout à fait différente.
La référence titulaire à Pascal donne à hésiter : s’agit-il d’un « livre » marqué par une continuité diégétique, ou d’un « recueil » de poèmes indépendants ? La numérotation même des poèmes, ou des fragments, comme celle des pensées de Pascal, importe cette ambiguïté spécifique du discontinu comme étape préparatoire à un projet de discours continu (une apologétique, en l’occurrence). L’irréalisation (car les Pensées restent un chantier à jamais) et même l’ordre problématique du classement (celui de Brunschvicg, celui de Lafuma, celui de Le Guern, etc.) n’abolissent pas le problème mais au contraire l’exacerbent : la question « quel ordre ? » tend naturellement à l’emporter sur le simple « quel sens ? ». Pierrick de Chermont joue d’ailleurs à augmenter ironiquement cette exacerbation en proposant ses propres poèmes-pensées dans un ordre numéral … désordonné : 85, 122, 47, 157, 108, etc. !
Le « message » d’une suite continue et ordonnée n’en reste pas moins immédiat et définitif dans l’esprit du lecteur, mais, quoique l’auteur explique dans sa postface que sa numérotation correspond à l’ordre initial d’écriture de ses poèmes (tous composés de quatre versets), il ne pourra être, pour ce qui est de la correspondance avec Pascal, qu’une nostalgie de la raison. En effet, si l’on y songe, chercher à relier ces poèmes aux Pensées qui correspondraient constitue une entreprise d’emblée ironisée puisque la citation de Pascal mise en exergue par le poète est à la fois référencée en Br. Et en La. ! Il faudrait donc que les n° de poèmes puissent renvoyer à deux Pensées différentes (par exemple : la 85 à 85 Br. Mais aussi à 85 La.). La thèse d’une référence combinée, si elle était jouable, abolirait alors l’hypothèse de la linéarité du discours, puisqu’il faudrait combiner deux linéarités différentes du même texte. Cela signifierait alors simplement que tout fait sens, quel que soit l’ordre des choses et des fragments. Et c’est peut-être cela, en vérité, qu’il faut comprendre quand même, mais en revenant à la simplicité concrète du contenu de l’exergue général : « les rivières sont des chemins qui marchent ». C’est le cours fluent du texte comme il se présente qui constitue l’ordre. C’est celui qui, si l’on rejoint les titres de section du début et de la fin, signifie : « Où l’on veut aller » « La poésie est communion et présence ».
Passons au contenu de ce recueil jeu et malicieux.
Le « je » y parle. Un « je » engagé dans une voie intuitive et paradoxale : « j’ai choisi d’être fidèle au chemin qui relie l’homme de lettres / à l’homme d’action. J’ai suivi les sentes de la prière. » (85). Énoncé ironique, en même temps, pour le matérialisme productiviste et financier d’aujourd’hui ! Prière => action. Énoncé de l’ironiste pascalien, incertain de lui-même mais critique du « divertissement » et de l’agitation mortifère et angoissée, quoiqu’il semble pratiquer lui-même les déplacements de par le monde.
Ailleurs, c’est un côté rimbaldien, Bateau-ivre et Saison en Enfer, que l’on trouve :
Les jours coulent en abondance. Mais que vaut l’homme ?
Sa force face à celle du présent ? J’ai résolu de vider
mon âme de l’ennui et du néant. »
La modernité de Pierrick de Chermont est de combiner cela à la variété des matériaux du discours poétique, des situations et des occasions d’énonciations. L’hétéroclite et la richesse du monde moderne y transparaissent, comme dans un roman, un genre dont la richesse des procédés narratifs est aussi mise à contribution.
Ainsi dans « Villes » (p. 39) :
22- Une photo avec des visages à Hong-Kong, des collègues
alignés comme sur une photo de classe.
J’aurais voulu être la seconde d’après, quand l’escalier fut
à nouveau vide et fixa le point d’où partit le flash.
71- Une branche avec du ciel gris autour. Quand verrai-je
le jour tel qu’il est : du vivant indéchirable ?
Pourquoi ai-je couru de Sao Paulo à Berlin ? Préféré me perdre et
disperser mon visage ? Suis-je déjà du côté de la mort ?
Ou dans « Pré » (p. 41) :
158- Dans les prés, à côté des machines agricoles, on trouve une
paire de bicyclettes. Laquelle enfourcherai-je
[…]
38- Hier, une soirée, des lèvres trempées dans un verre de vin
et un rire perlé de joie.
Vrai, le jour avait un goût d’herbe et de foin. […]
Le « je » de Pierrick de Chermont est celui d’un exilé dans la modernité dé-réglée : « Je vis dans une société vaniteuse et qui a choisi de se défaire du mètre. » (p. 49). Mais c’est aussi celui d’un observateur des instants sensibles de la nature, d’un disciple de Reverdy attentif à « l’étoile » (24 et 2 p. 49) et aux « ardoises du toit » (9 p. 52). Cette nature est tout aussi bien celle de la ville pérecienne et du monde machinique, encore un peu à la façon des années 60 ou 70, avec ses usages, ses bruits, ses silences, ses liens humains et commerciaux :
78- Deux étudiantes ont un questionnaire en main. Elles portent
un badge autour du cou. Une mobylette se gare£
auprès d’elles.
Le silence, ou plutôt une impression de silence revient
après l’arrêt du moteur. Leurs visages et leurs questions
se répandent alors en ville.
Depuis un jardin public je les observe. Je ne suis pas seul :
un homme parle avec son chien blanc : « Qui
m’instruira sur le bien vivre ? »
Des klaxons accorent des rues avoisinantes. Des étourneaux
jacassent dans les arbres. Il sourit ; Cinq heures
de l’après-midi, dans un quartier de Pékin.
« Je » moderne, il s’inquiète de l’Histoire et donc, paradoxalement, de son absence de lisibilité : « L’histoire s’est effacée » (p. 63) ; « Que fait Beaugency quand les cloches carillonnent ? » (p. 65).
« Je » en réseau, il dédie un grand nombre de ses poèmes à des poètes contemporains, vivants et probablement amis, et qui semblent plutôt constituer pour lui un monde divers qu’une tribu uniforme.
« Je » de croyance et d’itinéraire, enfin, il mène son récit fragmenté des « ténèbres impénétrables » (p. 85) vers la « joie » (p. 135) du « si je pouvais » (p. 127), à travers les étapes d’une « conversation intérieure » (p 99) et les expériences du « trop » (p. 115) pascalien : « trop de bruit nous assourdit […] trop de vérité nous étonne ».
Mais jusqu’au bout, la fragilité inquiète et, en effet, pascalienne, du poète subsiste ; la juxtaposition est définitive de la monotonie des jours et de la frêle apothéose de certains ; la juxtaposition fragmentaire de la bicyclette (n° 8) et de l’avoine (n° 119) marque le dernier poème (n° 136). Il le consacre, malgré la modernité de son monde d’apparence, en poète de la bougie et de l’errance, entre Georges de La Tour et le romantisme maritime (mais paisible) des rivages pierreux et des hauteurs où hurle … non, dort le vent :
136- Pourquoi la joie est-elle solitaire ? Même celui qui l’abrite
lui demeure étranger. À peine aperçue,
Elle s’en retourne du côté du loriot, d’un caillou ou du vent
endormi sur l’écume frissonnante.
Pourquoi est-elle sauvage ? Pourquoi préfère-t-elle la chair
et le sang ?
Qui l’a érigée en gardienne de la conscience ? Mon existence
s’est consumée pour la suivre.
*