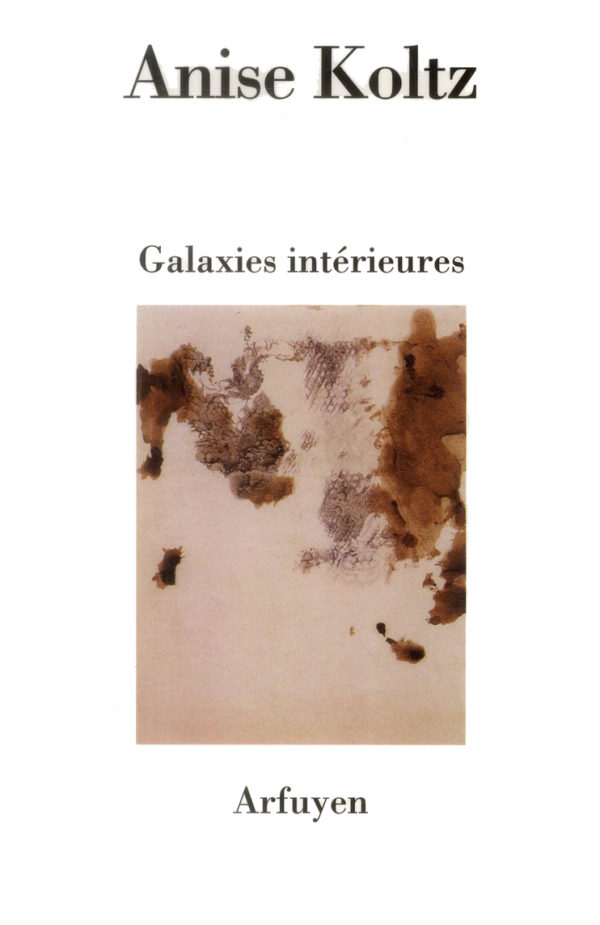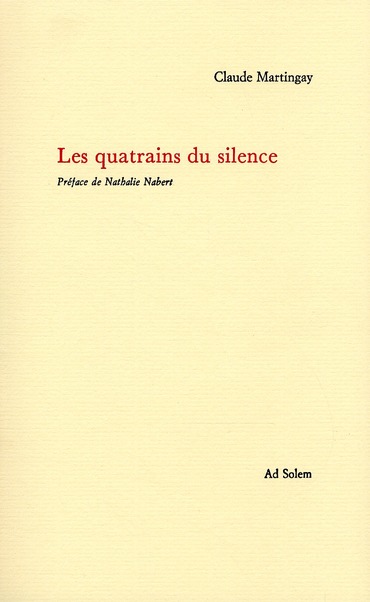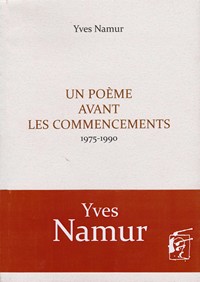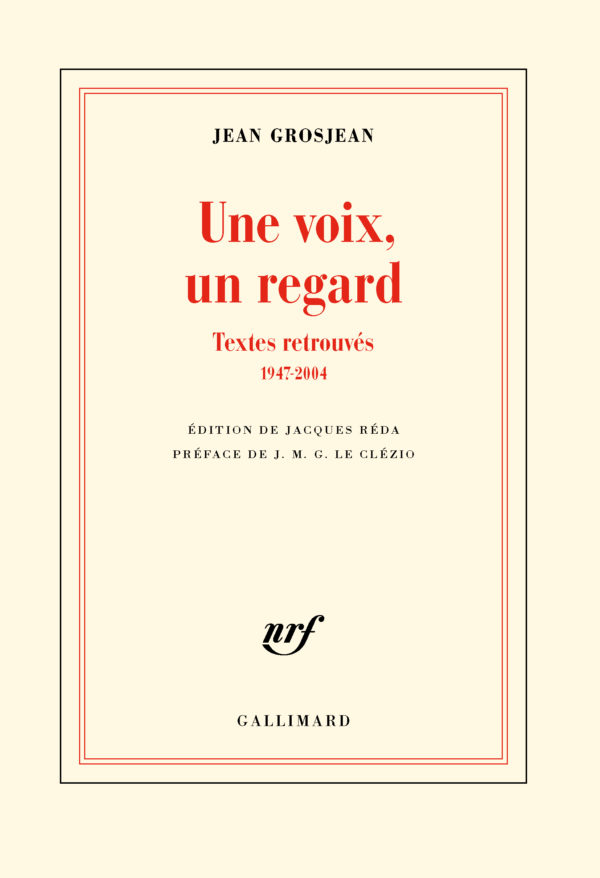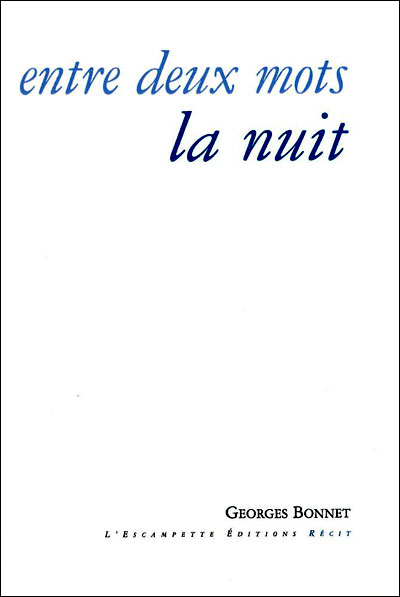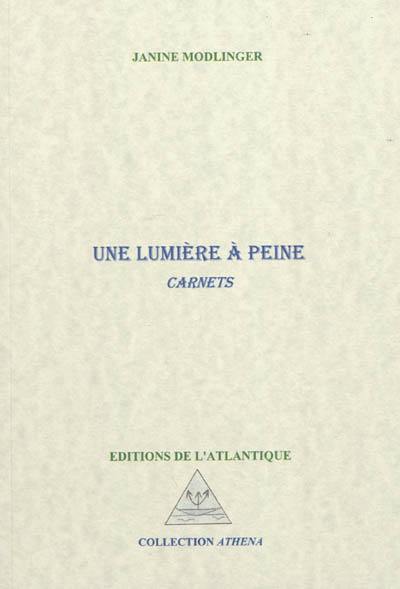Chronique du veilleur (11) – Anise Koltz, Galaxies intérieures
Anise Koltz est née en 1928 au Luxembourg. Elle a publié ses premiers livres de poèmes en langue allemande à partir de 1960. Les français ont pu découvrir un premier volume dès 1966, dans une traduction d’Andrée Sodenkamp, chez Seghers, Le cirque du soleil. Dans les années 80, elle a progressivement abandonné la langue allemande pour écrire en français. Depuis 2007, les éditions Arfuyen ont publié 5 livres, le dernier paru étant Galaxies intérieures.
« Entre vie et mort / il y a peu d’espace », écrit-elle, et toute l’œuvre, d’une remarquable homogénéité, illustre cette affirmation essentielle. Dans des poèmes dont elle s’applique à sertir le silence de mots et de phrases qui le respectent comme une réalité sacrée, Anise Koltz ne cesse de s’interroger devant nous sur l’invisible qui la « poursuit », l’éternité qui l’attend, le monde qui change « sans changer ». La parole touche aux réalités les plus vastes :
Je vis dans la fraternité
des astresIl n’y a qu’aux solitaires
que l’univers
ouvre ses portes
Ces réalités apparaissent parfois dans une ambivalence mystérieuse. Ainsi, la vie et la mort :
La mort
est la force
qui me fait vivreQui me fera retourner
à mon image de glaise
Visions de la vieillesse qui s’entourent d’images de terre, de chemins, d’ombres, de siècles entassés…
Mon âge m’alourdit
ma mémoire est périméeJe me regarde
regarder
les paysages empilés
sous mes paupières
Même les images du déluge « tapissent encore notre mémoire. » Ce n’est pas la sagesse ni l’expérience qui façonnent le poète, mais une inquiétude sans cesse ravivée, qui n’altère pas les forces de l’esprit, mais qui , au contraire, semble les décupler. Anise Koltz s’observe face à la page que le poème va remplir : paroles « suspendues » où le poète « renouvelle » son image « continuellement », langage qui travestit le réel, recouvre la vérité. Ce sont « des orbites de paroles », chacune « alourdie » par l’univers, retrouvant d’autres paroles anciennes, si semblables finalement.
Chaque poème
que j’écris
existe depuis toujoursVoyageant avec la lumière
je le capteLe faisant vibrer
avec les herbes du champ
« Et mentant / je dis la vérité », écrivait-elle dans Soleils chauves. La poésie sans concessions d’Anise Koltz circule entre déchiffrable et indéchiffrable. Elle exprime en cela, parfois jusqu’à l’angoisse, toute la condition du poète contemporain.
Chronique du veilleur
Retrouvez l'ensemble de la Chronique du veilleur, commencée en 2012 par Gérard Bocholier