John TAYLOR, Boire à la source
Auteur de 6 recueils, traducteur de Jaccottet, et Dupin, notamment, John Taylor, poète originaire de Des Moines, vit en France depuis 1977 et nous propose ici un bel ouvrage dans un format italien parfaitement adapté au thème du paysage qu’il y développe au rythme de la marche, en parallèle avec les aquarelles crépusculaires – entre indigo et gris de payne — de Caroline François-Rubino.
Marche le poète, “toujours plus haut”, en quête de perfection, partant des “grenats dans les graviers” qu’apporte “la lèvre du glacier” pour accéder au sommet où le porte son “bâton de saule”, au cours d’une méditation aussi flottante qu’attentive aux détails, ces signatures de la nature qui le portent à extraire l’essence de toute chose, la poésie du monde, magnifiquement et simplement offerte au lecteur.
La très belle introduction de Sabine Huynh souligne “la belle leçon de poésie anglo-saxonne offerte par John Taylor, une leçon de vie aussi et d’humilité”, citant le grand poète américain William Carlos William. Je l’ai quant à moi lu avec la sensation de pénétrer dans un vertigineux et rude paysage rupestre de Caspar David Friedrich : “la cascade inacessible à cause de la moraine”, les ombres énormes telles des chamois, le silence de ces lieux habités par les oiseaux, aigles et choucas, où flotte, à portée de main, une sacralité archaïque, une harmonie panique, entre les gentianes évoquant les vitraux de Chartres, les candélabres des montagnes, et “le “Paradisea liliastrum”, le lis de paradis : fleur alpine commune au nom divin”.
Entre pluie et brouillard, “l’humidité, comme une loupe” modifie l’aspect des choses, tandis que le promeneur amorce le retour :
“chaque versant, chaque perspective sur le fond des vallées et entre les pics, semblent changé de façon significative.
Et évidemment, ils n’ont pas du tout changé de façon significative.”
Quoique… ce voyage dans l’infiniment banal de la matière – les chaumes, les chemins, les fleurs alpestres… “les feux du tracteur sur la route”… — toutes ces rencontres provoquées par la marche paisible du poète indiquent au lecteur le “mode d’emploi” du regard qu’il lui faudrait porter sur le monde, retournant à la source de toute chose, pour y boire “en imaginant qu’elle est autre chose. / Elle n’est pas autre chose” : elle est en effet La Chose elle-même, révélée et fugace. C’est ce que disent à leur façon les lavis de l’artiste, qui ponctuent ce recueil : paysages nuageux et indécis, éclats aqueux de nuit qui sourdent de la page blanche, comme les “nuées de l’inconnaissance” évoquées par John Taylor, flottant sous la nappe du brouillard.
Le recueil présente en dernière partie le texte original – rappelant s’il le fallait l’excellent travail de la traductrice, qu’on a lue comme si ce poème était né en français.
*
Sabine HUYNH, Kvar Lo
Des encres de Caroline François-Rubino accompagnent également le recueil de Sabine Huynh, dont le titre est un mot hébreu, signifiant “ce qui n’est déjà plus” et désignant ici la perte précédant l’être même, dans l’épaisseur du silence.
Epaisses et noires aussi, comme des oeuvres de Soulages, les encres de l’artiste, qui semblent refléter ces mots de la poète :
“des nuages tremblés
questions cumulées
verticales
signaux de fumée”,
évoquant une calligraphie nocturne, comme cet avant du langage qu’explorent les poèmes à travers l’arc d’une vie : depuis la naissance “sans mémoire, dans l’absence”, le mutisme et la confusion, généalogique et linguistique … souvent compagnons de l’exil, de la rupture d’avec la langue-mère, dont demeure un souvenir amnésique de
“ce lieu où tu es née sans
y être jamais
allée, ses faces aphones”.
Les encres, en pleine page, déterminent trois chants dans l’ouvrage de Sabine Huynh : et par ouvrage, j’entends aussi ce travail de ravaudage, de faufilage, (parents se dit horaille en hébreu, dit l’auteure, “tu entends mes trous, des trous dans ma famille”) — ce travail qui cherche à rapprocher les lèvres de la blessure d’être hors–là, dans le manque, le ga-agouine (l’auteure use de mots hébreux dont les sonorités semblent étrangement barbares et signifiantes dans ce texte-textile qui se – et nous — confronte à l’altérité, à la Babel qu’évoque en exergue une citation de Kafka). Les mots tentent de panser la blessure toujours ouverte d’être incomprise, de devoir toujours “se traduire” :
“ma : distance dure
le vide vous relie
comme une cicatrice”.
Le langage, dans Kvar Lo, a une terrifiante matérialité : “langue barbelée”, “langue avalée / membre fantôme”, qu’il faut conquérir, à défaut d’avoir été bercée par la “langue de l’écholalie / langue d’un bonheur / et d’une mère / inaccessibles, que la poète remplace, avec l’hébreu, par une langue de granit, socle solide – “un rocher où t’asseoir /d’où te lever”. Cette quête d’une possible fondation est la trame de ces trois parties : le chant de la naissance et de l’exil, celui de l’enfance et du rapport à la mère, puis la découverte des langues étrangères – la française, pour survivre, “le chinois / pour expulser la langue-mère”, et l’hébreu, dont on comprend qu’elle est langue d’amour et d’accueil. Cette troisième partie évoque aussi le nouvel enfantement qui rachète de l’exil, enracinant enfin l’auteure, dont les “fantasmes de foyer linguistique” se réalisent à travers son lien avec sa propre fille et l’hébreu, par lesquels elle fonde sa propre origine :
“L’hébreu langue de nomades
ancre ton corps brûlant
dans ses lettres de granit
langue de rocaille
un rocher où t’asseoir
d’où te lever
te leste et t’a faite
mère
en te donnant
une langue-fille
hybride”
On n’en dira pas davantage de ce très beau recueil, émouvant, vibrant et maîtrisé : la postface de Philippe Rahmy le fait pour nous. Sabine Huynh y écrit au scalpel, aucun mot n’est de trop, et tous font mouche.
*
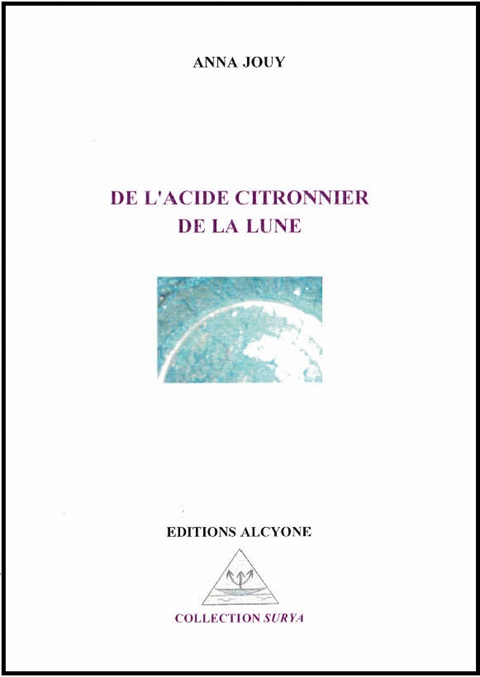
Anna JOUY, De l’acide citronnier de la lune
C’est de langage aussi, et du corps, que nous parle, avec l’acide douceur d’un oxymore, le recueil d’Anna Jouy, dont les mots nous proposent, en toute simplicité, de devenir, comme la monade de Leibniz telle que la lit Gilles Deleuze, une étoffe aux plis innombrables, à même de « [libèrer] ses propres plis de leur habituelle subordination au corps fini » et
“Eclater comme un drap dans le repli des langues.”
Deux poèmes en vers encadrent — comme les chassis d’une ouverture — de brèves proses : minuscules “gestes” – dans les deux acceptions du terme — de la vie quotidienne. C’est en effet de la fenête, où se poste la narratrice, que naissent ces observations-méditations, de cette fenêtre que la poète deviendra, par absorption du monde, dans une permanente inversion entre observant et observé, entre vie et matière. Le corps très charnel, le monde matériel, s’équilibrent d’une recherche de l’impondérable, à travers une imagerie originale, qui parfois suscite le souvenir de Rimbaud – tel ce dieu en tatane (p.32) ou le coeur obèse (p.34–35), ou encore telle peinture de Dali :
“j’atteins le perdu
j’ai mis ma danse dans une horloge molle” (p.38) .
En effet, la poésie d’Anna Jouy heurte de façon surréaliste les mots et les choses dans de surprenantes images, telle cette charnelle métaphore aussi marine qu’aérienne :
“l’anémone du dedans /bat des cils, courant d’air” (p.37)
“Tout se tient dans les floches, entre lourdingue et volatil” écrit la poète, qui ailleurs déclare ” J’ai encore trop parlé et mon dire est un duvet qui vole”. Il s’agit d’une ascèse, peut-être, dans laquelle la poète fait le vide en elle (ce dedans où se cachent “des demeures trop vastes, aux portes closes”) pour y accueillir, à travers les mots, toutes les sensations : ces couleurs merveilleusement décrites avec un savoir de peintre : “ce gris qui s’essaie à l’hématome”(p. 46), “le ton camaïeu des voyelles” dans le langage des oiseaux (p.50), ou encore “cette sensation de satin entre le corps et l’âme”(p.49).
Ce menu recueil, très sensuel (et le choix du papier irisé comme un aile de papillon en renforce l’effet) est une exploration/aspiration du monde extérieur à partir d’un état de rêverie éveillée très bachelardienne : les eaux évoquées dans le texte et celles du sommeil sont proches, et “l’inverse vie trempe comme un iceberg.”
On ne peut que conseiller au lecteur de s’y plonger, et de rêver.
- Daniele Beghè, La lettre à Silvia - 6 mai 2025
- Rossano Onano : carnet de poèmes inédits - 5 novembre 2024
- Luca Ariano, Demeure de Mémoires (extraits inédits) - 6 janvier 2024
- A Casa di a Puisia — maison sans murs de la poésie — entretien avec Norbert Paganelli - 24 octobre 2023
- Une maison pour la Poésie 3 : Maison-pont de la poésie : conversation avec Michel Dunand et Christine Durif-Bruckert - 29 août 2023
- CHEVEUX AU VENT… un projet poético-humanitaire et participatif d’Antje Stehn - 6 juillet 2023
- Un Petit Musée de la Poésie (1) : rencontre avec Sabrina De Canio et Massimo Silvotti - 6 mai 2023
- Roberto Marzano, poète sans cravate - 29 avril 2023
- Mari Kashiwagi : Papillon (extrait) - 25 février 2023
- Trois poètes et leurs territoires : 1 — Christophe Sanchez - 25 février 2023
- Trois poètes et leurs territoires : 2 — Marien Guillé, poète de proximité - 25 février 2023
- Trois poètes et leurs territoires : 3 — Serge Prioul et l’appel de l’ailleurs - 25 février 2023
- CHEVEUX AU VENT… un projet poético-humanitaire et participatif d’Antje Stehn - 6 janvier 2023
- Mircea Dan Duta — Corporalités (extraits) - 31 décembre 2022
- Alberto Manzoli, le mythe au coeur de la poésie - 29 octobre 2022
- Giovanna Iorio : l’effacement des distances - 3 septembre 2022
- Charles Baudelaire, banal contemporain - 2 juillet 2022
- ll faut sauver la revue ARPA ! - 1 juillet 2022
- 6 poètes ukrainiens - 1 juillet 2022
- Les Journées Poët Poët, la poésie dans tous ses états d’art - 4 mai 2022
- Chiara Mulas, la poésie et l’expérience du terrible - 4 mai 2022
- A Casa di a Puisia : entretien avec Norbert Paganelli - 2 mars 2022
- Les prix de poésie 2021 de la Casa di a Puisia - 2 mars 2022
- 6 poètes ukrainiens - 2 mars 2022
- Bhawani Shankar Nial, extraits de Lockdown (confinement) - 1 mars 2022
- La revue M U S C L E - 3 février 2022
- La Confiance dans la décohérence — poésie et physique quantique - 5 janvier 2022
- ll faut sauver la revue ARPA ! - 21 décembre 2021
- I Vagabondi, revue littéraire des deux rives de la Méditerranée - 5 décembre 2021
- La Volée (poésie) (écritures) (rêveries), n. 19 - 22 novembre 2021
- La rue infinie : entretien avec Jean-Marc Barrier - 6 novembre 2021
- Alessandro Rivali, La Tomba degli amanti, La Tombe des amants (in La Terre de Caïn) - 2 novembre 2021
- Sommaire du numéro 210 — dossier sur poésie et performance - 8 septembre 2021
- Sabine Venaruzzo, la Demoiselle qui prend le pouls du poème - 6 septembre 2021
- De la Performance aux poésies-performances - 6 septembre 2021
- Un poète s’éteint : disparition d’Henri Deluy - 21 juillet 2021
- Edito et sommaire du numéro spécial Mémoire — n. 209 - 7 juillet 2021
- Shuhrid Shahidullah - 4 juillet 2021
- Présentation de la revue VOCATIF - 30 juin 2021
- Margutte, non rivista di poesia on line - 6 juin 2021
- Charles Baudelaire, banal contemporain - 2 mai 2021
- La revue Davertige, en direct d’Haïti - 2 mai 2021
- Naissance d’une revue : POINT DE CHUTE - 20 avril 2021
- Giuseppe Conte : L’Erica — La bruyère - 5 mars 2021
- Gustave : de fanzine à mensuel gratuit et toujours en ligne - 21 janvier 2021
- Luca Pizzolitto — Lo Sguardo delle cose / L’Apparence des choses - 5 janvier 2021
- Vinaigrette, revue moléculaire de photo/poésie - 5 janvier 2021
- Claude-Henri Rocquet aux éditions Eoliennes - 5 janvier 2021
- Feuilleton Bernard Noël sur Poezibao - 21 décembre 2020
- Revue L’Hôte, esthétique et littérature, n. 9, « De la nuit » - 21 décembre 2020
- Les Haïkus de L’Ours dansant - 21 décembre 2020
- Poésie mag - 7 décembre 2020
- Poesiarevelada - 7 décembre 2020
- Yin Xiaoyuan : Les Mystères d’Elche - 30 août 2020
- Patmos au temps du Covid 19 - 6 mai 2020
- Femmes artistes et écrivaines, dans l’ombre des grands hommes - 6 mars 2020
- Redécouvrir Marie Noël : autour de deux livres chez Desclée de Brouwers - 6 mars 2020
- Conceição Evaristo, poète afro-brésilienne - 6 mars 2020
- Giovanna Iorio et la magie des voix - 6 mars 2020
- Chantal Dupuy-Dunier, bâtisseuse de cathédrales - 5 janvier 2020
- Contre-allées, n. 39–40 - 6 novembre 2019
- Angelo Tonelli — extraits de Fragments du poème perpétuel / Frammenti del perpetuo poema - 6 novembre 2019
- Eurydice & Orphée : la parole étouffée - 6 septembre 2019
- Irène Gayraud, Chants orphiques européens, Valéry, Rilke, Trakl, Apollinaire, Campana et Goll - 6 septembre 2019
- Guy Allix & Michel Baglin, Je suis… Georges Brassens, Les Copains d’abord - 6 septembre 2019
- L’Orphisme et l’apparition d’Eurydice - 6 septembre 2019
- Barry Wallenstein : Tony’s Blues (extrait) - 6 juillet 2019
- Ryôichi Wagô : Jets de poèmes, dans le vif de Fukushima - 6 juillet 2019
- Siècle 21, Littérature & société, Écrivains contemporains de New-York - 6 juillet 2019
- Traduire Lake Writing de Judith Rodriguez - 6 juillet 2019
- Ping-Pong : Visages de l’Australie, Carole JENKINS, entretien - 6 juillet 2019
- Du côté des traductions : Acep Zamzam NOOR, Federico Garcia LORCA - 6 juillet 2019
- La Part féminine des arbres (extraits) - 7 juin 2019
- Daniel Van de Velde : portrait en creux de l’artiste - 4 juin 2019
- Ivano Mugnaini, extraits de La Creta indocile - 4 juin 2019
- Tristan Cabral : hommage à un poète libertaire - 4 mai 2019
- Alma Saporito : Poèmes du Juke-box, extraits - 4 mai 2019
- Derviche tourneur, revue pauvre et artistique - 4 mai 2019
- Enesa Mahmic, poète bosniaque - 4 mai 2019
- Sara Sand /Stina Aronson, poète et féministe suédoise - 31 mars 2019
- Artaud, poète martyr au soleil noir pulvérisé - 3 mars 2019
- Le Retour de Mot à Maux - 3 mars 2019
- Beatritz : le Dolce stile Novo revisité de Mauro de Maria - 3 mars 2019
- Poésie-première 72 : l’intuitisme - 3 mars 2019
- Angèle Paoli & Stephan Causse Rendez-vous à l’arbre bruyère, Stefanu Cesari, Bartolomeo in Cristu - 3 février 2019
- Judith Rodriguez, Extases /Ecstasies (extrait) - 3 février 2019
- Didier Arnaudet & Bruno Lasnier, Laurent Grison, Adam Katzmann - 4 janvier 2019
- “Poésie vêtue de livre” : Elisa Pellacani et le livre d’artiste - 4 janvier 2019
- Georges de Rivas : La Beauté Eurydice (extraits inédits) - 4 janvier 2019
- Elisa Pellacani : Book Secret, Book Seeds & autres trésors - 4 janvier 2019
- Un petit sachet de terre, aux éditions La Porte - 5 décembre 2018
- Wilfrid Owen : Et chaque lent crépuscule - 5 décembre 2018
- “Dissonances” numéro 35 : La Honte - 3 décembre 2018
- Luca Ariano : extraits de Contratto a termine - 3 décembre 2018
- Wilfrid Owen : Et chaque lent crépuscule (extraits) - 3 décembre 2018
- REVU, La revue de poésie snob et élitiste - 16 novembre 2018
- Apollinaire, Le Flâneur des deux rives - 5 novembre 2018
- Un Album de jeunesse, et Tout terriblement : centenaire Apollinaire aux éditions Gallimard - 5 novembre 2018
- “Apo” et “Le Paris d’Apollinaire” par Franck Ballandier - 5 novembre 2018
- Giancarlo Baroni : I Merli del giardino di San Paolo / Les Merles du Jardin de San Paolo (extraits) - 5 novembre 2018
- Sophie Brassart : Combe - 5 octobre 2018
- Michele Miccia — Il Ciclo dell’acqua / Le Cycle de l’eau (extrait) - 5 octobre 2018
- Alain Fabre-Catalan et Eva-Maria Berg : “Le Voyage immobile, Die Regungslose Reise” - 5 octobre 2018
- Revue “Reflets” numéro 28 — dossier spécial “Poésie” - 5 octobre 2018
- Florence Saint-Roch : Parcelle 101 - 5 octobre 2018
- Les Cahiers du Loup Bleu - 4 septembre 2018
- Sanda Voïca : Trajectoire déroutée - 4 septembre 2018
- Les Revues “pauvres” (1) : “Nouveaux Délits” et “Comme en poésie” - 4 septembre 2018
- Résonance Générale - 4 septembre 2018
- Pascale Monnin : la matière de la poésie - 6 juillet 2018
- D’Île en Elle : Murièle Modély, de “Penser maillée” à “Tu écris des poèmes” - 5 juillet 2018
- Créolités et création poétique - 5 juillet 2018
- La Revue Ornata 5 et 5bis, et “Lac de Garance” - 3 juin 2018
- Journal des Poètes, 4/2017 - 5 mai 2018
- “En remontant l’histoire” du Journal des Poètes - 5 mai 2018
- Patrick Williamson, Une poignée de sable et autres poèmes - 6 avril 2018
- Revue Traversées - 6 avril 2018
- Daniele Beghè, Manuel de l’abandon (extraits) - 6 avril 2018
- Jean-Charles Vegliante, Où nul ne veut se tenir - 2 mars 2018
- La revue Cairns - 1 mars 2018
- Denise Desautels : La Dame en noir de la poésie québecoise - 26 janvier 2018
- La Passerelle des Arts et des Chansons de Nicolas Carré - 21 novembre 2017
- Revue Alsacienne de Littérature, Elsässische Literaturzeitchrift, “Le Temps” - 20 novembre 2017
- Jacques Sicard, La Géode & l’Eclipse - 14 novembre 2017
- Nouvelles de la poésie au Québec : Claudine Bertrand - 16 octobre 2017
- Martin Harrison - 2 octobre 2017
- visages de l’Australie, Carole Jenkins - 2 octobre 2017
- Feuilletons : Ecritures Féminines (1) - 2 octobre 2017
- Beverley Bie Brahic - 1 octobre 2017
- Entretien Hélène Cixous et Wanda Mihuleac - 15 septembre 2017
- Laurent Grison, L’Homme élémentaire et L’œil arpente l’infini - 15 septembre 2017
- John Ashbery : Le Serment du Jeu de Paume - 1 juillet 2017
- Patricia Spears Jones - 30 juin 2017
- Les Débuts de Cornelia Street Café, scène mythique de la vie littéraire new-yorkaise - 16 juin 2017
- Au Café Rue Cornelia, Village de l’Ouest, New York : Une Conversation - 15 juin 2017
- Voix féminines dans la poésie des Rroms : Journal des Poètes 4, 2016 et 1, 2017 - 19 avril 2017
- “Mahnmal Waldkirch” et quatre traductions - 18 avril 2017
- Eva-Maria Berg, poème pour le Mémorial de Waldkirch - 18 avril 2017
- “La Mémoire des branchies” et “Debout”, deux recueils d’Eva-Maria BERG. - 21 mars 2017
- Judith Rodriguez : l’aluminium de la poésie - 3 février 2017
- choix de poèmes de Carole JENKINS traduits par Marilyne Bertoncini - 31 janvier 2017
- Feuilletons… Rome DEGUERGUE, Marie-Ange SEBASTI, Chantal RAVEL Christophe SANCHEZ, Gérard BOCHOLIER - 21 janvier 2017
- GUENANE et Chantal PELLETIER, aux éditions de La Sirène étoilée - 9 décembre 2016
- Muriel STUCKEL, Du ciel sur la paume. - 9 décembre 2016
- PING-PONG : Gili Haimovich - 25 novembre 2016
- Aux éditions Henry — Valérie CANAT de CHIZY, Laurent GRISON - 16 novembre 2016
- Le Journal des Poètes, Phoenix et Le Festival Permanent des Mots - 8 novembre 2016
- Ping-Pong : Deux poèmes et un entretien avec Kent Mac Carter - 31 octobre 2016
- Poèmes de Jan Owen traduits par Marilyne Bertoncini - 20 octobre 2016
- James Byrne, Une poèsie qui vous explose - 30 septembre 2016
- Fil de lecture de Marilyne Bertoncini : autour de Dominique CHIPOT - 17 septembre 2016
- Trois recueils illustrés — John TAYLOR, Sabine HUYNH, Anna JOUY - 10 juillet 2016
- Fil de Lecture de Marilyne BERTONCINI : Eloge du silence et de la légèreté, Eric DUBOIS, Cédric LANDRY - 10 juillet 2016
- Ara Alexandre Shishmanian, Fenêtre avec esseulement - 30 juin 2016
- Denis EMORINE : Bouria, Des mots dans la tourmente - 25 juin 2016
- Cahiers Littéraires Internationaux Phoenix n°20, Hiver 2016 - 20 avril 2016
- Xavier Bordes, La Pierre Amour - 19 mars 2016
- Entretien avec Shuhrid Shahidullah - 24 février 2016
- Pierre Perrin : Une Mère, le cri retenu - 21 février 2016
- Fil de Lecture de Marilyne Bertoncini : Nouveautés des 2Rives - 22 décembre 2015
- Angèle Paoli : Tramonti - 1 décembre 2015
- BARRY WALLENSTEIN - 29 septembre 2015
- Eric Dubois, Le Cahier, Le Chant Sémantique - 13 septembre 2015
- La poésie de Jan Owen - 5 décembre 2014
- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (3) - 30 septembre 2014
- Martin Harrison vient de nous quitter - 9 septembre 2014
- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (2). Géraldine Monk présentée par Steven J. Fowler et traduite par Marilyne Bertoncini - 16 juin 2014
- Un regard sur la poésie anglaise actuelle (1) - 9 mai 2014














