Vincent Laisney, En lisant en écoutant
Faut-il se fier à ses premières expressions ?
Vincent Laisney, auteur de L’âge des cénacles (2013) chez Fayard, nourrit manifestement une passion pour les sociabilités et la vie littéraires. Dans En lisant en écoutant, qui sonne comme un hommage appuyé au célèbre titre de Julien Gracq et à sa critique impressionniste,((Julien Gracq. « En lisant en écrivant », Œuvres complètes II (Paris : Gallimard, 1995). La critique impressionniste de Julien Gracq, que l’on peut déduire de sa monographie intitulée André Breton (Paris : José Corti, 1948), comporte bien une dimension affective par la prise en compte de l’impact de l’œuvre littéraire sur le lecteur mais elle n’a fait pas l’objet d’une théorisation en bonne et due forme.)) c’est par petites touches pointillistes que Laisney mène l’enquête herméneutique d’un siècle de lecture à haute voix.*
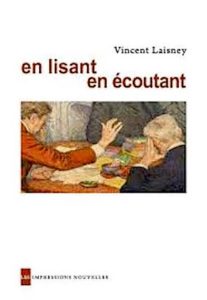
Vincent Laisney, En lisant en écoutant. Bruxelles : Les Impressions nouvelles, 2017, 224 pages, 17 EUR.
Petite précision : la lecture est à prendre ici dans sa seconde acception, à savoir l’extériorisation – et non l’intériorité – d’un phénomène cognitif. Comme le rappelle l’auteur, il est question de « l’oralisation d’un texte mémorisé ou non devant un public » (31-2). Ce projet pluridisciplinaire, prend pour point de départ l’analyse picturale de Une Lecture (1903), une huile sur toile de Théo van Rysselberghe qui immortalise cette pratique dix-neuvièmiste qui
contrevient à nos représentations d’un siècle dominé par l’imprimé, où le Livre serait l’aboutissement ultime. Il est en effet acquis que le phénomène majeur de la culture post-révolutionnaire […] est le triomphe de la publication, à savoir, la domination croissante, et bientôt écrasante, de la communication imprimée, sous les espèces variés du livre, du journal, de la revue, sans parler des autres produits de l’imprimerie (affiche, illustration, image). Cette hégémonie de l’imprimé a, par ricochet, informé la vision que nous avons de la littérature du XIX siècle, assimilée à une ascèse du bien écrire (le vers ciselé, l’art pour l’art, l’écriture artiste, etc.), en lieu et place d’un art du bien dire, suranné, caractéristique de l’âge classique. (19)
A ces mises en voix correspondent plusieurs objectifs variables selon l’intéressé : affinement de l’œuvre en cours (à l’image de l’étape du filage au théâtre qui permet les derniers ajustements), recherche d’un adoubement, sinon d’une forme de reconnaissance dans le regard d’autrui (s’exposant ainsi autant à l’approbation qu’à la désapprobation de l’auditoire), rite de passage pour intégrer le sérail germanopratin, déclencheur d’écriture (pour Musset, par exemple), moment privilégié de sociabilité (pour Vigny), pour ne citer qu’eux.
Véritable performance verbale, cet exercice de lecture – qui emprunte tantôt au style déclamatoire de la comédie (voire à l’envolée lyrique de la poésie), tantôt à une « diction inexpressive, détimbrée, mettant en valeur le texte et rien que le texte » (166)((L’on pense soudain aux représentations postmodernes de grands classiques de l’opéra qui ne s’encombrent pas de fioritures tels que décors et costumes pour parvenir au même effet : une attention exclusive à l’oralisation du texte.)) – n’est pas sans dangers ou dérives : auto-glorification, inter-glorification ou le poison des flagorneries (asinus asinum fricat !), ennui, angoisse du plagiat, distraction de l’auditoire, irascibilité du public (lire le cas Rimbaud), etc. Dans son étude fouillée, Laisney va même jusqu’à déceler une véritable scénographie de la lecture, selon qu’il s’agit de lectures performances ou de lectures discussions (le dada de Jean-Étienne Delécluze). Mais une grande majorité des lectures cénaculaires qu’il évoque ont pour objet principal la poésie et le théâtre, des formes d’écriture dont la finalité est précisément de se prêter à une mise en voix. Il est de temps à autre fait mention d’œuvres en prose comme Génie du christianisme (1802) et Les Martyrs (1809) de Chateaubriand, mais les exemples de lecture de romans restent trop rares. L’on en vient naturellement à se demander si ces lectures sont un phénomène homogène généralisable à tous les genres ou pas.
Le pape de la lecture est incontestablement Gustave Flaubert à qui un vibrant hommage est rendu :
Pour Flaubert, la lecture n’est pas un exercice anodin, c’est une pierre de touche grâce à laquelle s’évalue sans risque d’erreur la perfection musicale d’un texte. […] Aux yeux de Flaubert, un livre est une partition, et la voix un outil infaillible pour différencier la bonne littérature de la mauvaise. (125)
Cette parenthèse sur la musicalité du style qui s’évalue à l’aune de l’oreille musicale aurait pu donner lieu à des réflexions nourries de l’apport des sciences cognitives qui s’intéresse de très près à la parenté évidente entre la lecture de la littérature et la musique. Aussi les lecteurs anglophones pourront-ils consulter avec profit l’ouvrage paru sous la direction de Michael Arbib, Language, Music and the Brain (MIT Press, 2013). Paul Valéry, que cite Laisney, avait déjà ouvert dans « Souvenirs littéraires » une brèche en son temps en évoquant les préoccupations de Mallarmé :
Mallarmé avait longtemps réfléchi sur les procédés littéraires qui permettraient, en feuilletant un album typographique, de retrouver l’état que nous communique la musique d’orchestre; et par une combinaison extrêmement étudiée, extrêmement savante des moyens matériels de l’écriture, par une disposition toute neuve et profondément méditée des blancs, des pleins et des vides, des caractères divers, des majuscules, des minuscules, des italiques, etc., il était arrivé à construire un ouvrage d’une apparence véritablement saisissante. Il est certain qu’en parcourant cette partition littéraire, en suivant le mouvement de ce poème visuel, dont certains mots ou certains passages se répondent, imprimés qu’ils sont dans le même caractère, s’ajustent à distance exactement comme des motifs, ou bien comme des timbres dans un morceau de musique, on conçoit, on croit entendre une symphonie d’une espèce toute nouvelle. On comprend combien il serait précieux, dans la poésie, de pouvoir faire des rappels, des raccords, de poursuivre un thème au travers d’un thème et d’enlacer des parties indépendantes d’une pensée. Mallarmé avait osé orchestrer une idée poétique. (160-1)
Grâce à cette monographie, Laisney sort de l’ombre un pan modeste de l’histoire littéraire des lectures à haute voix, tandis que le reste de la fresque reste à dépeindre :
les lectures officielles pour faire recevoir une pièce, les lectures mondaines dans les salons, les lectures improvisées dans les cafés de la bohème, les lectures ponctuelles dans les banquets, les lectures publiques dans les salles de conférence, les lectures dans les cercles fumistes et les cabarets, les lectures dans les théâtres poétiques fin-de-siècle, etc. On y verrait alors qu’une grande partie de la production littéraire du XIXe siècle a été récitée avant d’être imprimée. (34)
Dans un format propice au grappillage, à l’image du Pourquoi lire (Paris : Grasset, 2010) de Charles Dantzig, En lisant en écoutant rappelle à notre bon souvenir la fonction originelle de la lecture – celle d’une pratique résolument sociale accompagnée du partage d’un moment de convivialité. Même si, dans le cadre d’étude que s’est imposé ce Maître de conférences à l’Université de Paris Ouest, cette pratique demeure en vase clos, confinée qu’elle est à des cercles littéraires ou des cénacles (quand d’aucuns y verront des cliques et des coteries), gageons qu’une histoire littéraire d’envergure des lectures à haute voix verra bientôt le jour. Ce pourrait être la prochaine étude de Laisney, une que nous dégusterons avec gourmandise, comme celle-ci.
* - cet article a fait l'objet d'une première publication dans la revue COnTEXTES : http://contextes.revues.org/6286