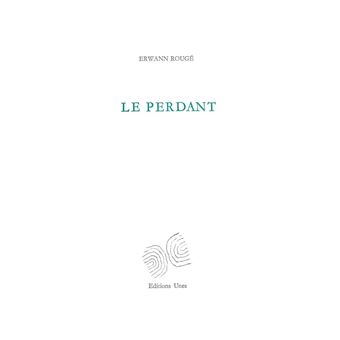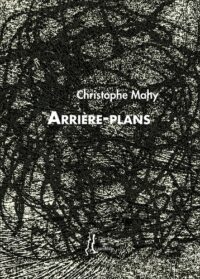Franck Villain, Saisi par l’hiver
Il faut le rappeler en exergue : long poème-journal, écrit du 11.12.2016 au 20.03.2017, dans une volonté de renaître, le recueil de Franck Villain est encore tout emprunt de la tragédie de Fukushima que le poète a vécu au plus près, résidant au Japon le 11 mars 2011.
Souvenons-nous que le crépuscule frappe. Obéissant à une rythmique immuable, celle des époques humaines, le soleil crie trop blanc avant de se refermer sur la vie. C’est le métier du poète que de, sans cesse, se repositionner, lui trop sensible aux forces telluriques, d’autant plus lorsqu’elles sont sismiques. C’est alors qu’on se demande que faire de ce corps engourdi ? Que faire sinon l’unir au printemps, le laisser bourgeonner à nouveau après que la terrible saison de l’hiver soit passée ? Un hiver et des pas « froids de ne plus sentir », blancheur de la page, « blanc mouvant de l’œil » contre ce vert du renouveau qui continue de tamponner l’intérieur de l’œil comme un souvenir, persistance rétinienne.
C’est dans les Cévennes que Franck Villain s’est établi, entre le mont Bouquet et Lussan, comme l’indiquent les parenthèses en fin de textes. Non loin de là, la centrale de Tricastin pèse comme un spectre du passé mortel sur la mémoire que l’on ne peut effacer. C’est là, dans la chambre (« ta chambre »), où l’air ne semble plus circuler que tu réapprendras à vivre : « comme une enfance / dans la ruade des / mots / cette joie de / découvrir ». L’écriture comme une convalescence, piochant ci et là, un mot, une parole prononcée par le voisin ou tout le délicat bruissement d’un buisson apparemment inerte. Vaincre la mélancolie car « l’eau coule dans les veines de la Terre, et tu as soif du sol des chemins ».

Franck Villain, Saisi par l'hiver, illustré par Nicolas Poignon, Po & Psy, Erres, 2020, 92 pages, 15 €.
Jour après jour, la douleur s’émousse, dans sa retraite le poète prend le temps de laisser planer les ombres, dans la blancheur omniprésente. Il sait qu’au bout du chemin se trouve le salut, parce que « polir la violence est un art quotidien » et que c’est la seule solution pour laver son cœur.