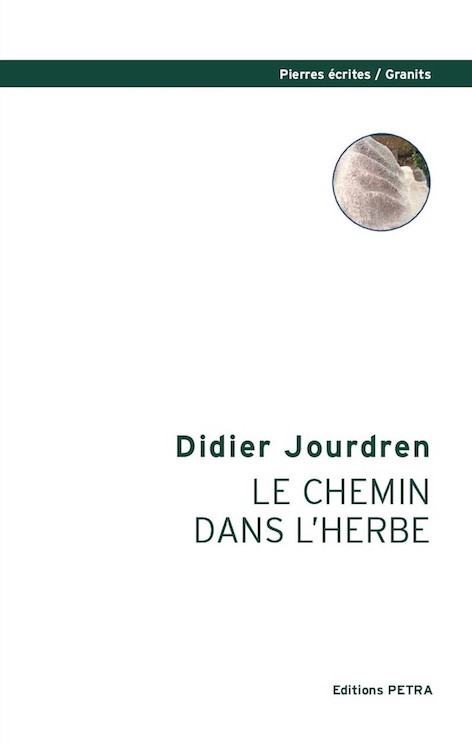Didier Jourdren, Le chemin dans l’herbe
J’envie Didier Jourdren d’avoir écrit ce texte, que je pourrais résumer par la formule : Saisir sans saisir, en demeurant dans le saisissement… J’éprouve à son égard une certaine admiration, presque teintée de jalousie : j’ai dans mes tiroirs un manuscrit titré « Au monde », traitant de la même question, dont un extrait a été publié par la revue Triages.
Dans « Le chemin dans l’herbe », Jourdren décrit ces moments où, dans l’ordinaire de notre vie, une brèche s’ouvre un instant :
Je dois préciser que l’inconnu dont je parle ne tient en rien à l’étrange ou à l’inédit, mais surgit au contraire dans le monde familier, dépourvu souvent de tout charme particulier, écrit-il.
C’est en cheminant qu’il se sent interpellé par un chant d’oiseau, une rangée d’étourneaux posés sur un fil, un menhir, un bouquet de pins, une jonchée de foins coupés… Il se refuse à parler d’extase (même sans dieu), et pourtant :
J’ai dit cette impression d’avoir soudain trouvé le terme, l’extrémité, le fin fond de tout : j’étais arrivé, sans l’avoir prévu, bien que ce fut une halte brève. Je répondais à une attente inattendue, si l’on peut dire, venue d’infiniment loin, arrivant sans y penser où je devais me rendre, où chacun doit se rendre. Devant ce bout de tout, le temps ne pesait plus, s’était distendu, ou dissipé.
Cette rencontre nous défait de tout en nous donnant tout. Alors,
Je sens que j’y suis, dit-il.
Au monde qui, tout en restant étranger, devient familier. On baigne dans un sentiment d’appartenance ; de grande paix, de délivrance. L’errance est terminée, et avec elle le sentiment d’une détresse apprise dès le plus jeune âge.

Didier Jourdren, Le chemin dans l’herbe, éditions Petra, coll. Pierres écrites/Granit, 2018. 150 p., 15 €.
À sa place un abandon de soi qui pourrait être la préfiguration d’une mort qui serait joyeuse (certains qui en sont revenus en témoignent) ?
J’imagine ce sentiment proche de ce que vivent ces gens qui ignorent le logos, qu’on appelle « primitifs ». Comme si on retrouvait là le mode de rapport au monde qui existait au temps où les arbres et les animaux parlaient, au moins dans les rêves. Chez les poètes, peut-être, se conserve la trace de ce monde d’avant la grande rationalisation ; comme signe d’une persistance, d’une résistance qui fut celle des sorciers et des sorcières (des femmes aujourd’hui ?).
Puisque la source de la poésie est bien là :
Lorsque, détaché de tout, et d’abord d’une part de soi, dépaysé, on se trouve soudain dans l’imminence des choses, l’esprit défait, dénué de toute parole.
Donc, plutôt dépossédé que possédé par une fulgurance qu’ont décrit les mystiques, et certains poètes (en ce sens je devrais plutôt parler d’instase que d’extase). Il reste ensuite à écrire ces moments, d’abord pour tenter d’approcher ce que l’on a saisi au moment du dessaisissement, en creusant la sensation passée autant qu’il est possible (et dans cet exercice Jourdren excelle) :
Pour ne pas rester les mains nues, dit-il.
Sans pour autant recouvrir l’expérience d’une explication qui permettrait de réduire l’étrangeté qui nous a dérangé, « dépaysé », angoissé peut-être bien, et de retrouver ainsi nos marques ordinaires.
L’écriture de Jourdren, au contraire, cherche à retrouver le chemin du dessaisissement dans une écoute de la langue, une ouverture à ce qui advient. Les mots viennent comme sont venus le bouquet d’arbres, le chant d’oiseau, Jourdren les accueille avec un même étonnement… reste ensuite à en faire un écrit. Alors, alors seulement, commence le travail de la langue...
Dernière minute : Didier Jourdren vient de publier, toujours chez Pétra : Petite route du dépaysement, qui prolonge Le Chemin dans l’herbe.