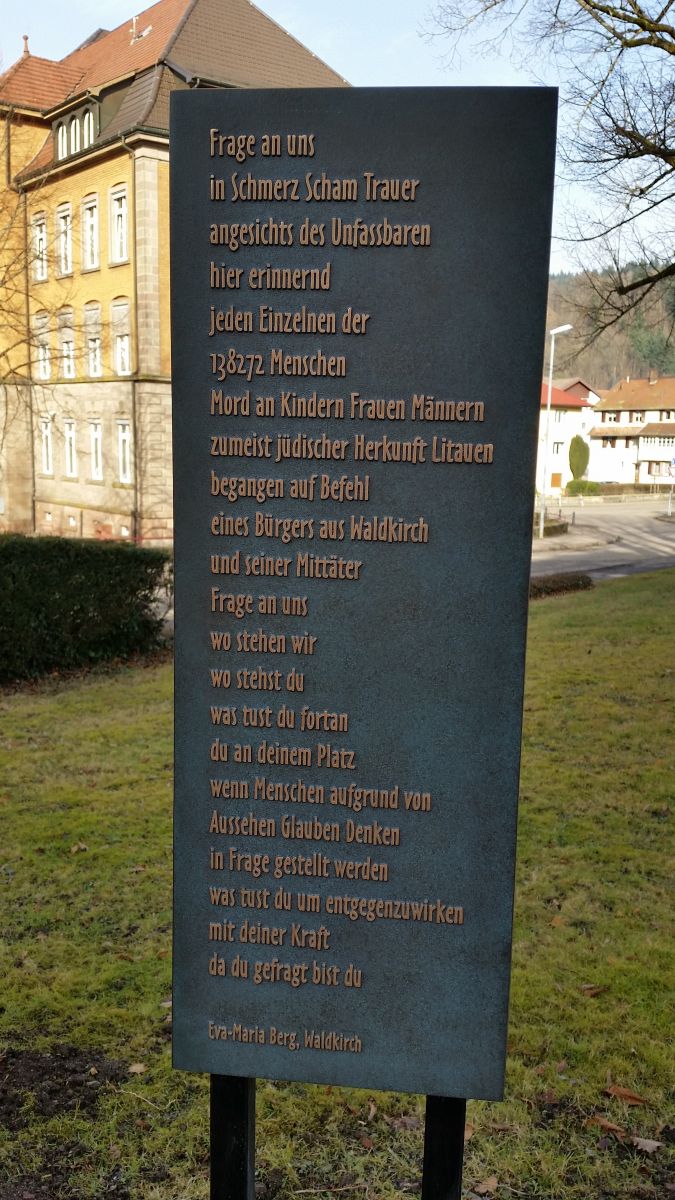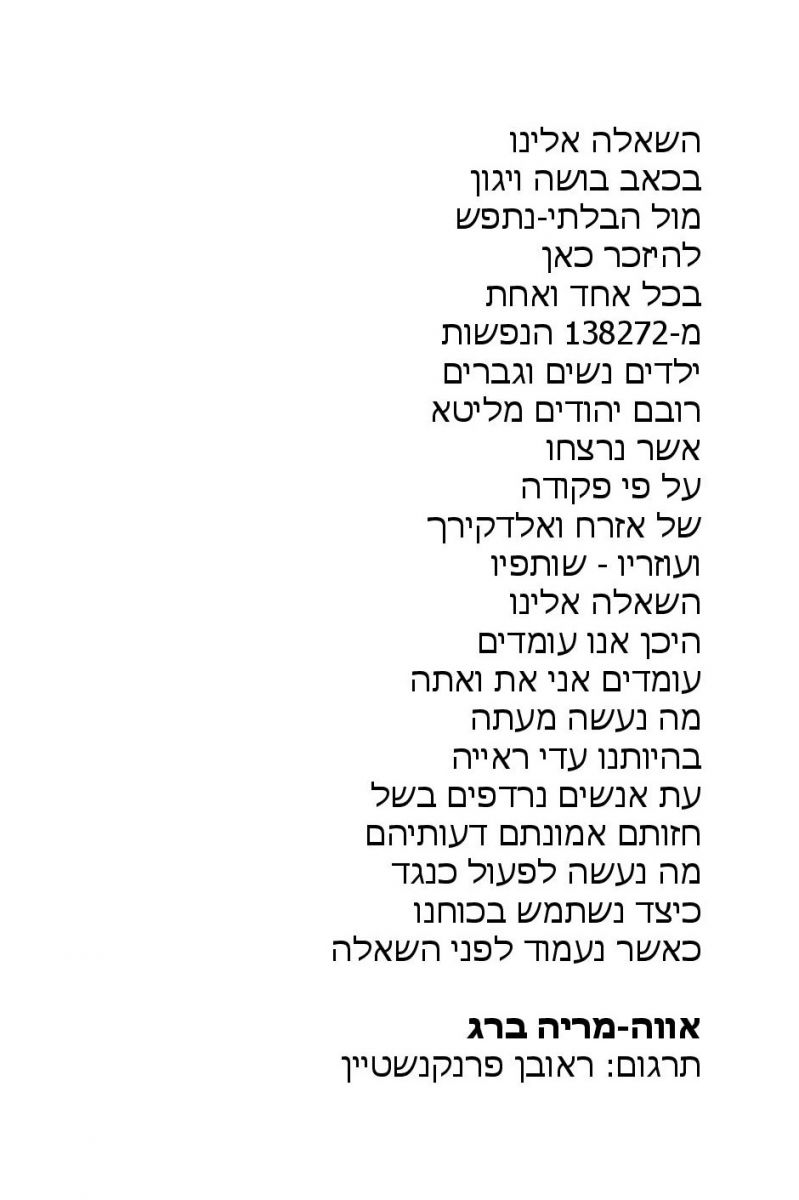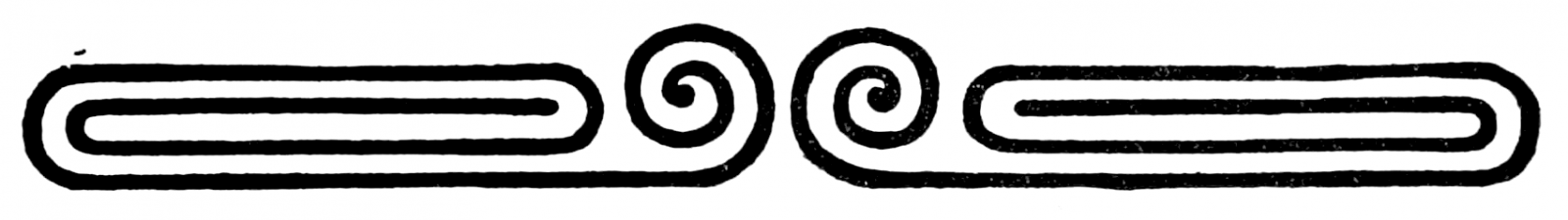Pendant de l’exposition qui vient de fermer ses portes au musée Paul Valéry, de Sète http://www.huffingtonpost.fr/francois-xavier/salah-stetie-et-les-peint_b_2314436.html, la BnF accueillait Salah Stétié (http://www.salahstetie.com) au sein de la galerie des donateurs (jusqu’au 14 avril), à l’occasion de l’ouverture du Fonds Salah Stétié : manuscrits et correspondance, documents et œuvres sur papier réalisées avec de grands noms de la peinture contemporaine (Alechinsky, Tapiès, Ubac, Velickovic, Titus-Carmel, Hollan, Baltazar, etc.) sont offerts à la curiosité des visiteurs qui peuvent, grâce à un subtil jeu de vitrines, assouvir leur appétence en plongeant leur regard sur la genèse de certains livres.
Point d’orgue de cette manifestation, l’hommage qui s’est déroulé jeudi 4 avril 2013 (http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_auditoriums/f.hommage_stetie.html?seance=1223909973877), consacré à cette œuvre entièrement écrite en français, désormais incontournable, pour ne pas dire majeure. En attendant le colloque qui se tiendra à Beyrouth les 18 & 19 avril 2013.
Parallèlement, trois nouveaux ouvrages viennent scintiller dans l’air déjà électrique, conducteurs d’émotions et de savoir, donc complémentaires, ponctuant cette arrivée du printemps de la plus noble des manières. Délivrer la parole poétique dans la clameur des foules libérées des morsures de l’hiver est un acte d’amour qu’il convient de saluer. Merci à Salah Stétié d’ouvrir l’accès à d’autres miroirs. Une poésie en réverbération de l’histoire littéraire qui se complète chaque jour. Un idiome qui enrichit le verbe français, cajolé dans l’écrin d’un livre imprimé sur vélin de Byblos.
D’une langue, estampillé par la griffe de Tapiès, s’ouvre sur l’idée du Non-Où pour bien imprimer qu’ici il ne sera question que du feu de l’amour, ce songe après lequel nous courons comme mort de soif après sa bouteille. L’amour en frissons de désir ou d’espoir, en pluie de déceptions, l’amour repoussé et toujours recherché. "L’amour [qui] est pour l’individu une éminente occasion de mûrir, de devenir quelque chose en soi-même, de faire de soi un monde, un monde en soi pour le profit d’un autre, c’est une grande et une immodeste exigence qu’on adresse à l’autre, qui l’élit entre tous et l’ouvre à de vastes desseins", rappelle Rilke dans ses Lettres à un jeune poète, que Salah Stétié ne manqua pas de lire et relire en son temps…
Fidèle parmi les fidèles à la langue française, Salah Stétié renversa le souffle de sa culture orientale au miroir de l’appel maternel de l’arabité, pour aller concasser les mots de Voltaire en ouvrant grand la voi(e)x d’un ressenti personnel dépassé pour embrasser toutes les cultures dans un seul et même idiome. Poète de l’amour, Stétié œuvrera pour décliner la dialectique du désir dans le désert de la langue par lui enfin enrichie. Toutes les variations seront convoquées, à défaut inventées, pour livrer à la criée cette langue unique faite sienne depuis l’enfance, coup de foudre précoce sous le soleil du Liban…
Une langue française qui est sauvée, en quelque sorte, souligna le "tout-jeune" académicien Michael Edwards (http://academie-francaise.fr/les-immortels/michael-edwards), par l’apport des étrangers qui viennent écrire en français et qui, apprenant cette langue, s’emploient à la déplier pour dénicher des espaces nouveaux entre le difficile et le possible. En cela ils participent à l’enrichir sans la pervertir.
Larme
L’air est au fond de l’air avec la longue feuille
Touchée par le cristal de la saison
Longue saison de l’air parmi les longues feuilles
De l’arbre, en partage avec l’enfant
L’agneau dans le rayonnement de l’esprit
Domine, le regard de l’air le regarde,
L’enfant avance dans l’esprit vers la nuit
Et le jasmin du soleil le découronne
L’enfant grandit dans l’air soudain grandi
Sur un chemin, larmes gelées qui brûlent,
La corne de la lune au théâtre des arbres
Promène, un peu de sang aux doigts, l’enfant
Parcourant la trame comme vagabond la steppe enneigée, le poète frigorifié saisira le feu dans le jardin des soies confuses, balise de survie, pour témoigner une fois encore, une fois de plus, que les dieux et les déserts ne peuvent finalement rien contre l’appel inhabité des colombes. Papillon d’un songe, ce chantre du vers libre ira dans les glycines en cheveux d’abandon pour questionner, une fois encore, l’eau froide gardée, s’y abreuver et goûter au délice d’une renaissance.
Le lecteur découvrira cette question d’infini portée par une langue musicale d’images projetées dans nos cœurs, estomacs noués, yeux humides, apesanteur vaincue : on lit Salah Stétié sur un nuage, en apesanteur.
"Nous habitons des mystères, nous sommes des mystères et le plus grand mystère est la langue", rappela Salah Stétié à la tribune du Petit auditorium de la BnF, insistant sur la quête de cette difficile union entre ce que le poète veut formuler et ce qu’il parvient à formuler. Car la poésie est recherche de signes, de sens et donc de la vie dans sa dimension humaine. Le poète puise dans les signes avant-coureurs la force dont il se saisit pour braver le jeu de la contradiction dans la construction du poème et approcher au plus près la tentation de dire l’innommable.
Annonce
Offrande à mon cœur d’un jardin
Par amour de la vérité des arbres
Par désir de leur contagion
Sous le nuage qui dragonne
Pauvre feuille
Tu protèges une palpitation d’insecte
Saveur des hommes. Chaleur des femmes.
La planète au soleil
La terre et ses grands vents pour l’accrocher aux fers
Qui sont rameaux, qui sont naseaux des purs chevaux
– Celui qui l’oubliera sera perdu
Toujours en questionnement, Salah Stétié se fit accompagner de Gilles du Bouchet qui peignit Une rose pour Wâdi Rum, pierre d’angle d’un fini actif qui ouvre à l’indéterminé comme pour rappeler que l’entrée de la couleur dans la ville est un leurre : l’œil saturé de lumière ne sauvegardera, au final, qu’un binôme noir ou blanc, noir et blanc, que l’esprit brouillera en d’infimes lavis de gris pour rappeler que l’âme prédomine à la vie. Et ce sera dans ce substrat inhabité qu’ira se loger la poésie, en prose, illimitée comme le désert, là où se retire Dieu, en ouverture d’un livre au format à l’italienne.
Mais il y a aussi Rembrandt et les Amazones qui tient dans la main, petit livre de compagnonnage qui doit demeurer dans la poche du voyageur, surtout s’il lui prend d’aller visiter les musées de Hollande. Guide spirituel et goguenard, les feuillets renferment des clins d’œil et des idées, le cocktail idéal pour apprendre plus sans en avoir l’air, et voir alors autrement cet étonnant pays sous la mer qui déposa au pied du monde parmi les plus grands peintres de tous les temps. Mais les Pays-Bas ce sont aussi le héron et le hareng, Vermeer et Baudelaire, Amsterdam et les tulipes… Foison d’images réinventées pour l’occasion sous la plume alerte et guillerette d’un poète à l’écoute d’un monde particulier dont il nous donne à apprécier les codes. À nous d’en déjouer les secrets pour nous plonger avec délice dans les rets de la tentation orangiste…
Enfin, somme des questionnements et des révélations qui accompagnèrent Salah Stétié dans ses relations avec le pourquoi et le comment, béquilles du poète en face de sa vérité, Sur le cœur d’Isrâfil enflamme l’esprit. Car cela semble si simple, si évident ainsi énoncé. On croit côtoyer la pensée de Senghor, Bonnefoy, Valéry et la comprendre, ruse du poète qui, sans lui, ne nous aurait pas permis de nous penser si fin l’espace d’une lecture. Isrâfil est le plus puissant et le plus compassionnel des archanges puisqu’il tient en permanence entre ses lèvres la trompette qui, lorsque l’ordre lui en sera intimé par Dieu, sonnera la fin du monde, même celle des anges. L’écrivain qui nous écrit ici est-il d’aussi redoutable clairvoyance ? Se sachant traqué il avoue, donne à lire sa pensée écrite, ajustée. Oui, l’écrivain fabrique, toujours, une tapisserie de ses propres lieux et se plait à élaguer, adapter pour mieux réapprendre les chemins de l’innocence. Un texte est une forêt de prétextes certifie Salah Stétié qui sait pertinemment qu’écrire c’est s’essayer à sortir de prison. Évasion couronnée de succès, ce qui laisse présager du meilleur à venir puisque prochainement vont paraître les Mémoires du poète, dont le manuscrit est désormais sous l’œil protecteur de la BnF et les quelques privilégiés qui ont eu l’infime honneur de les lire n’ont de cesse d’en parler comme du Grand Œuvre.