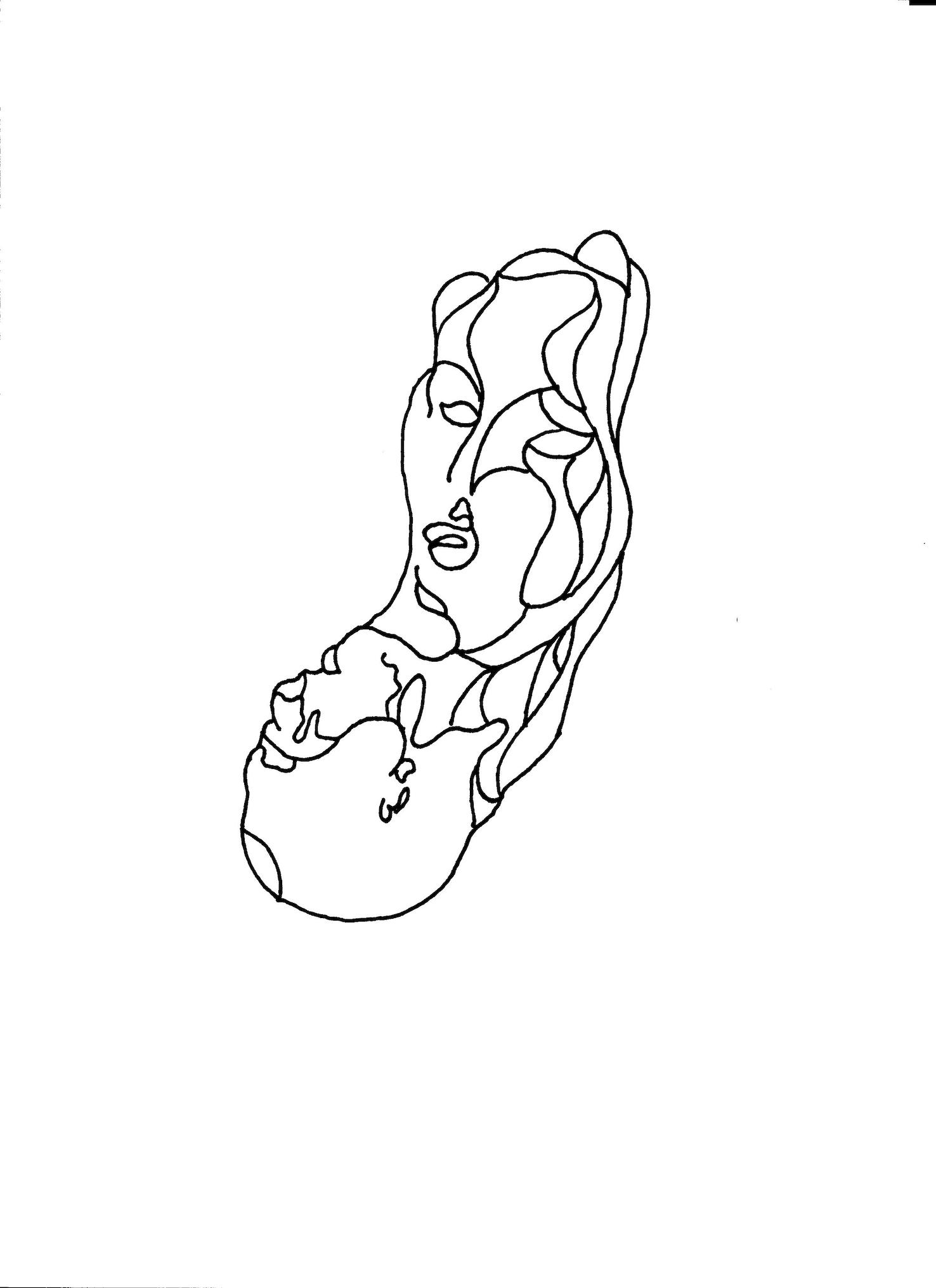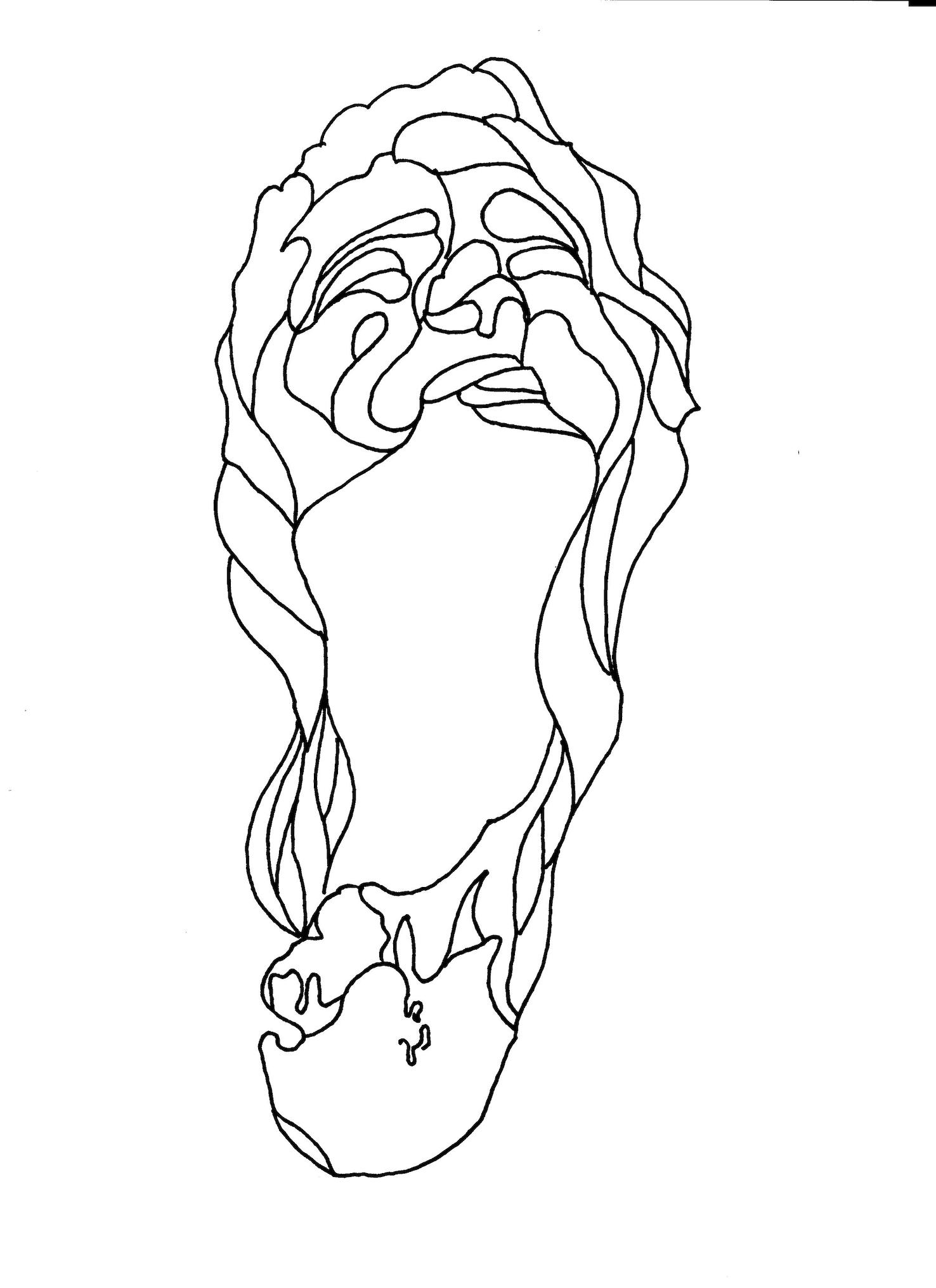Anne Barbusse, A Petros. Crise grecque, extraits
Poème 1
Sounion glacial
des oranges ornent les arbres de toutes les rues - près des ambassades, avenue large, maisons plus anciennes, des musées, un vaste parc exotique et grouillant, verdoyant et touffu -
Sounion empli d’un vent qui fléchit les corps historiquement perdus
la mer au pied se moire dans nos regards - de l'autre côté la mer dessine l’écume des vagues irréprochables - Sounion glacial - à fleur de mer l’hiver grec souffle sur des images - nous
sommes dans un décor inventé le temple se dresse dans le froid qui claque et les colonnes ne disent rien
l’hiver est un souffle de vent sur de la mer consentante
de l'autre côté des villas et des pins et des figuiers
la nuit les deux corps dorment l’un contre l’autre
à Sounion le vent bat la coulpe des terres froides et dures
la nuit les deux corps se cherchent
dans la crique un hôtel couleur de boue défigure le silence
il faudra bien que les dieux s’en mêlent
des ruines de maison et une petite église sur la colline inhabitée du monde qui fait face
peu de choses - les terres tombent dans la mer avec l’aplomb de la perfection de la Méditerranée sûre de son horizontalité antique - seul le froid fait douter - que
faisaient les dieux dans pareil hiver - nous nous
souvenons de Borée et de notre enfance éclatée
- Sounion glacial -
le temple a le vent entre ses bras et le laisse hurler
au bas la mer attire nos yeux dispersés
nous ne voyons rien nous ne sommes que vent traversé de froid
nous ne sommes que mer abrupte et lissée de vagues - nous sommes
la mer et le vent si lointains qui traversent nos corps séparés - ce sont les images que tu as capturées entre le vent et le soleil blanc comme hiver grec - là le froid
la veille du départ là le froid palpable comme ta peau tiède et brune - la nuit dans ton lit
plus rien ne peut m’atteindre du monde laissé derrière moi et du jardin taiseux - je puis
acquérir une autre vie malgré l’indécision du ciel gris d’Athènes et de décembre finissant - je
puis parcourir la route sinueuse et les constructions éparses sur la route de Sounion avec la Grèce muette et inconnue la Grèce de décembre qui me parle la langue froide de sa beauté moderne - beaucoup de quatre-voies de train de banlieue de voitures et de panneaux publicitaires mais des maisons et des objets qui ne trompent pas - j’entre
dans mon monde
avec le vent hurlé de Sounion et le temple qui tient face à l’hiver qui tourne autour des colonnes de décembre - et une petite réparation de briques romaines et rouges au milieu du socle
sûr - avec le vent qui plaque la mer contre le monde et frappe nos corps hivernaux
Poséidon hurle avec la passion du monde
au retour aux mines du Laurion des bateaux pour partir à l’île de Sappho des bateaux en attente de Mytilène et un port mort au bord de l’hiver court
des oliviers avec de l’herbe si verte au pied et touffue - comme un printemps d’avant l’hiver -
il y a les mines fermées et l’argent introuvé et les ferries qui ne partent pas
il y a la route effrayée de la veille du départ
les heures qui plongent le monde dans le vent et Poséidon qui résiste
il y a - encore - un homme qui conduit pour moi
la nuit tombe tôt sur l’Attique d’hiver

Poème 2
la ville vendait toutes les marchandises inventées par les hommes et les kiosques vendaient les cartes téléphoniques internationales
la ville offrait des policiers casqués et porteurs de boucliers et les manifestations criaient et chantaient lentement autour de Syntagma
la ville avait le pas tuméfié de la neige froide et la clarté de sa poussière
au coin des rues le béton entretenait la laideur de la douleur
à peine un balcon, à peine ai-je ouvert la fenêtre, les derniers jours, dans le soleil
les cabines téléphoniques étaient en panne
le jardin derrière Syntagma était sombre
le bas de la ville grouillait et regrettait les rocs clairs qui respirent - Acropole, Lycabette, colline de Philopappou - le reste s’effrayait de poussière et de voitures - la ville
avait tué ses rêves - les rues avaient froid - peu à peu
dans le déploiement de mes marches j’ai appris avec mon corps le plan inconnu d’un territoire
j’ai usé les heures pleurées pour que mes pas montent à l’Acropole d’hiver et que la neige soit réalité de mars
cela ne grouillait plus à terre - en haut on tâchait de restaurer la beauté
- du Lycabette, Acropole et mer derrière, au sud, de l’Acropole, montagnes au nord et mer au sud, de Philopapou, Acropole et neige sur les hauteurs vers le nord - on variait les points de vue on essayait la caméra les angles de vue pour ne pas haïr la ville - il fallait sauver l’essentiel parer au plus pressé ne pas haïr la ville en sus de l’amant - la neige
n’avait aucun mot
je ne tuerai pas la ville avec mon malheur de femme
devant le parlement, à la nuit tombée, un beau travelling d’hommes jeunes et bruns, serrés, avant la ligne des policiers, je passe devant cette ligne d’hommes très beaux, je voudrais filmer la jeunesse de l’humanité révoltée et calme
le sigle des drapeaux - allons - la témérité des corps debout
dans la grande avenue une librairie silencieuse, un homme qui lit a oublié son sandwich sur une table, un rayon de livres anglais, une citation de Gertrude Stein disant en substance que
l’homme seul veut être avec les autres et que l’homme avec les autres veut être seul -
des livres de grec ancien avec la traduction de grec moderne sur la page d’en face- on mesure les siècles qui ont modifié les mots, les esprits, la qualité des phrases, les accents - des livres de poésie ou de mythologies pour les enfants - le calme - Anne did you eat something - la tranquillité des livres et de sa voix - une première paix
la ville me laisse filer vers l’hôtel avec mes pas de femme
la longue ligne des hommes bruns devant le parlement
la ville est femme indigène
demain il aura reconquis son calme d’homme d’été et de décembre
la neige de mars fondra avec la facilité éclatée de la folie
demain il me préparera l’huile d’olive et les figues
la neige deviendra confuse et Athènes reconquerra la luminosité maritime d’une amoureuse

Poème 3
un voyage pour que s'élèvent des signes - trajets illusoires, vanités, fin d’hiver -
un canal, le long du Rhône, deux petits ponts de pierres, vieux, les vagues du Rhône,
le Rhône, toujours le long des mes histoires amoureuses
une masure avec des chèvres
les centrales nucléaires, un enfant peint sur une cheminée, deux éoliennes, la menace et l’énergie, l’une tourne l’autre pas
je refais un voyage de décembre, les voyages ne touchent rien, mars n’est pas Noël,
un aviron quatre hommes deux cygnes
une femme qui porte un œil bleu, dans le métro, à Lyon de la première chute,
I will never be your boyfriend what is the truth - unforgettable -
il est plus difficile de se séparer des vivants que des morts - le choix est l’abstraction de notre malheur - nous n’embrassons que des totalités émiettées - les jacinthes embaument sans notre vouloir - les violettes ont succédé à la fugacité des crocus et des âges -
le lyrisme est ébréché l’amoureuse a eu froid dans la neige
Athènes était glaciale
entre nuages et soleil qu’avons-nous à dire - nous ne survolons que l'à-plat de nos mystères - au-dessus des nuages la lumière ne dit rien aux avions qui ne savent que le passage
nous étions les spectateurs démunis de nos rêves - North by Northwest, un homme sillonne l’espace, cherche un homme qui n’existe pas tout en étant pris pour cet homme qui n’existe pas - le rien à l’œuvre, mais tout de même le happy end - c’est ici que la vie se démarque du cinéma - il n’y a aucune larme - la magie ne fonctionne plus
y aura-t-il de la neige à Athènes
une femme ne se suicide pas parce que la neige tombe à Noël
- en décembre il faisait doux, j’ai pris un bain dans la mer, les corps étaient tièdes -
la nuit tombe plus vite à Athènes je rentre à l’hôtel au milieu des hommes qui passent
j’apprends une langue je n'ai peur que de mon errance - mais les hommes - nous détruisons tous deux avec la peur enfantine - au Pirée je n’ai rien trouvé -
je répète les mots de ta langue je prononce avec le revers de la passion
au Pirée j'ai traversé un tunnel de béton tagué de frais et j’ai vu les banlieues solitaires
je ne t'ai rencontré nulle part
j’ai marché sur les décombres expulsés de mes rêves
enfin la plage - une piscine très bleue où des gens nagent dans la lumière de mars, des voiliers minuscules, des baigneurs isolés, enfin la plage -
je ne vois pas la mer au Pirée mais des policiers traversent un square à moto tandis qu’une mendiante mendie
une île petite et sûre, tombée par hasard dans la baie, muette et scandaleuse de beauté
you are not even a relative
à l’arrivée, aéroport sombre, Syntagma et Omonia plus sombres encore - il a plu -
tu m’apprends le retournement de la figure humaine - un chien paralysé des deux pattes arrières, la réalité d’Athènes est laide, ta voix agressive comme les villes -
l’hiver n’a pas la tiédeur de l'automne plus amoureux que notre histoire
les roadmovies s’achèvent souvent dans la mort, j’aurais dû savoir - Thelma and Louise, Easy Rider, Zabrisky Point, Badlands - je te parle encore - Pandore a encore oublié l’espoir
en refermant la boîte - tu as basculé au bord de la haine - il n’est guère que l’happy end de Sailor and Lula mais c’est un conte - je tombe - je ne puis que
te tuer de mots - je n'ai pas levé l’âme du Pirée, je n’irai pas dans les îles - you
destroy et l’hiver marche vers le printemps - deux fois je suis allée au Pirée, j’espérais un salut de la mer - rien ne nous a sauvés - au retour les jacinthes ne m'avaient pas attendue -
le monde continue en dehors de moi - je suis monstrueuse d ‘amour - tu es le monstre
aux sentiments tranchés - maybe we are two difficult persons - peut-être le monde
est-il plus difficile que la mer

Poème 4
et pourtant
en haut de Philoppapou un violoniste jouait en regardant l’image calculée de l’Acropole blonde
au bout d’avenues rectilignes brillait la mer du Pirée sans parler
la prison de Socrate n’est pas la prison de Socrate
je ne savais pas où était le violoniste
juste vu un clochard, plus bas, installé dans son campement sur la colline, un Diogène avec une tente, un chien, des bâches fixées sur bancs et tables de pique-nique, des sacs plastique, de l’ordre, il lit son journal, le violoniste joue - c’est ainsi
que se juxtaposent les objets et les hommes du monde
le violoniste tâche d’enclore l’Acropole dans sa musique, en haut, appelé par le ciel
j’aurais aimé aller au cinéma mais tu es fatigué
les désaccords ont le chemin de croix du Christ de Socrate de Diogène
et pourtant il joue
les passants ne pourront voir son visage, tourné vers les temples, absorbé par les dieux et la musique possibles - il ne faut pas le déranger, un seul intrus peut détruire les paradis
misérables - il joue - le violon face à l’Acropole, mon amertume qui regarde l’après-neige
ceux qui marchent dans la poussière des rues ne voient plus l’idée des temples
ceux qui mendient sont au ras de la terre ceux qui vendent sont engloutis de
l’humanité dérisoire qui rampe parmi les objets des supermarchés
les rues grouillent de médiocrité
mais ceux qui manifestent - le cordon de jeunes hommes beaux et bruns - peut-être ne
suis-je plus amoureuse - mais comment renoncer à la précision des corps - jouer
du violon tout en haut du monde - les vestiges des dieux dans la modernité pure - aller
manger avec toi au bord de la mer et des deux îles - ou jouer du violon face à l’Acropole -
la mer ou les dieux - les hommes ont trop de peines - les hommes mendient l’humanité - un seul s’en va avec son violon, il a les cheveux longs, il nous quitte - les dieux sourient -
les hommes de Syntagma ont les visages graves des révoltés - ils vivent encore -
sont-ils dieux modernes, ou ombres niées de dieux