Corporéité et silence dans Palpable en un baiser d’Irène Duboeuf
Irène Duboeuf est une poétesse française née à Saint-Etienne. Elle a écrit une dizaine de recueils, parmi lesquels nous pouvons citer Le pas de l’ombre, Un rivage qui embrase le jour, La trace silencieuse et Palpable en un baiser qui constitue l’objet de notre article.
Le recueil Palpable en un baiser comporte trois sections et compte une cinquantaine de poèmes, tous titrés, dont les sources d’inspiration sont diverses : la musique, les photographies et la lecture. En effet, Irène a écrit son recueil en écoutant Alkan (La Vision), Dvorak (Silent Woods), en regardant des photographies, celles d’August Colombo, de Thierry Duboeuf et de Claudio Scandelli, ou encore après avoir lu Bobin, Aragon, Yourcenar.
Mais malgré la diversité des sources d’inspiration, une voix unique et claire domine l’ensemble : celle de l’ineffable qui émane du « visage des choses », du silence. Le poème est parcouru par une question centrale : celle des rapports entre les mots et les choses. Son souci premier est d’écrire ce qui « unit l’invisible au réel »1.
Notre présent travail repose essentiellement sur la dichotomie visible et invisible, monde palpable, tangible et monde immatériel et imaginaire. Nous allons traiter ce rapport entre langage et corps suivant une approche à la fois sémiologique et phénoménologique, en dépassant la dualité : abstrait et concret, invisible et visible - car toute abstraction nait du concret et le concret s’organise par l’abstraction – ainsi qu’en nous référant aux travaux de Roland Barthes, ceux de Maurice Blanchot sur le langage et ceux de Maurice Merleau-Ponty sur la phénoménologie.
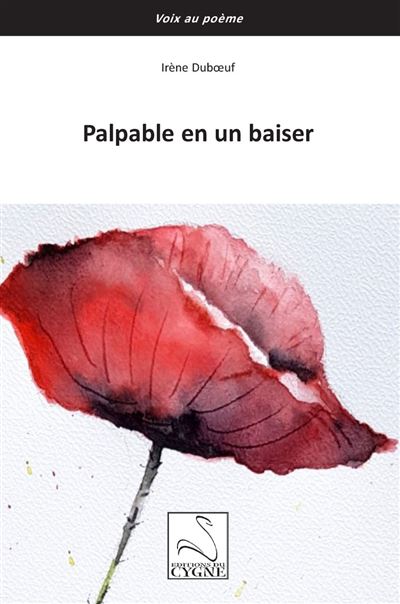
Irène Dubœuf, Palpable en un baiser, Editions du Cygne, 2023, 60 pages, 10 €.
Notre analyse vise à montrer que la trame voire le socle, le soubassement du recueil d’Irène Duboeuf n’est autre que l’Amour, cet invisible qui est palpable. Il va sans dire que le poème est un lieu par excellence où s’incarne l’invisible. Notre intérêt porte en premier lieu sur la matérialité des mots et en second lieu sur le silence des mots : l’ineffable.
1/La concrétude :
Écrire un poème, pour Irène Duboeuf, ne consiste pas à s’abstraire du concret. La poésie n’est pas une abstraction qui nous éloigne de la réalité. L’enjeu de la poésie d’Irène est la concrétude de tout ce qui intelligible, impalpable, invisible. Il convient de définir brièvement la notion du concret et celle de l’abstrait afin de dégager le socle primordial du recueil.
Étymologiquement, concret vient du latin concretus qui signifie ce qui a une existence réelle, matérielle, ce qui est concret immédiat, ce qui peut être appréhendé, sans méditation, via les sens. L’amour, cet invisible qui n’a pas de corps, devient palpable en un baiser. Ainsi la mise en exergue de Marc Alyn met l’accent sur la palpabilité de l’invisible, entre autres l’amour : « Tout l’invisible est là/palpable en un baiser »2
Le sensible est toujours concret. On pourrait définir le concret : ce qui est donné. Le concret, c’est l’immédiat, au sens étymologique du mot : sans médiation. Certes l’amour tel qu’il est défini dans le dictionnaire est une abstraction, mais tant qu’il est éprouvé et vécu, il est concret. L’amour est donc la concrétisation d’un penchant, d’un désir. Dans ce sens Jean-Jules Richard, dans Neuf jours de haine, affirme que « l’amour est quelque chose de palpable. Ce doit être à portée de la main. Autrement, c’est du rêve. Le rêve ne satisfait les sens »3.
Puisque est abstrait tout ce qui n’est pas perçu par les sens, tout ce qui ne possède pas l’existence matérielle d’un corps, tout ce qui est impalpable, Irène, ancrée dans le monde scripturaire, poétique, par son corps, refuse l’abstraction en optant pour la concrétude.
Sa poésie est traversée par le palpable, par ce qui est perceptible par les sens. Ainsi le socle de sa création poétique émerge bel et bien de sa sensibilité. La poésie n’est-elle pas le langage des émotions ? La perception de sa poésie se décline sur le mode de la sensation, du ressenti.
Elle découvre le monde par ses sens. Elle écrit ce qu’elle sent. Si elle évoque une idée c’est pour lui donner une vie palpable, donner corps à une idée, à un mot : « Sais-tu que la peau des mots/frissonne sous mes doigts ? »4. Il convient de dire qu’on écrit corps à corps : le corps des mots effleure, étreint celui de la poétesse. Le poème tire éloquence « Dans l’oratoire secret/du poème/l’air brûle en silence/pas à pas /j’écris »5 p.11. La chair des mots nous renvoie à la conception barthésienne du langage. En effet, dans Fragments d’un discours amoureux, Roland Barthes affirme « Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre. C’est comme si j’avais des mots en guise de doigts, ou des doigts au bout de mes mots »6.
C’est sa main aussi qui court sur le papier afin de capter quelques impressions. Irène Duboeuf a une prédilection pour le toucher car il n’y de vrai que le toucher. La poétesse perçoit bien l’écriture poétique comme œuvre du corps. Par conséquent la limite entre le corps et le corpus, le recueil, devient insaisissable. Écrire un poème, c’est tendre la main aux autres, s’ouvrir au monde, s’y incorporer « Tout poème est une main ouverte/ où la ligne de vie croise celle du cœur/ et je vais traversant les non-dits/des aubes musicales »7. La poésie, salvatrice, généreuse, vient au secours de la poétesse, lui permettant de s’aventurer dans le monde inexprimable, ineffable d’une pensée libre et sauvage.
Imprégnée de phénoménologie, Irène Duboeuf, à l’instar de Maurice Merleau-Ponty, conçoit le corps non pas comme un objet tel qu’il est dans la conception cartésienne, mais comme un sujet qui perçoit et vit l’expérience poétique. Tout émane du corps et se propage dans l’écriture. Elle prend contact avec l’écriture, le monde, avec son corps, particulièrement la main « tu savais que tu touchais/au suprême baiser du poète »8. Dans son ouvrage L’œil et l’esprit, Maurice Merleau-Ponty certifie que toute pensée passe par la main « je ne pense qu’avec mes mains »9. La main effleure légèrement la page en vue de noter quelques vers qui flottent dans son esprit.
Le poème épouse la légèreté via des mots simples, brefs comme « nuage », « lumière », « ailes ». Leur choix contribue à donner une impression de légèreté, de beauté angélique au poème voire au recueil « une plume blanche/est tombée à mes pieds:/était-ce un oiseau ou la chute d’un ange ? /J’ai voulu la ramasser/mais le vent l’a emportée »10. Cette plume qui tombe ne réfère-t-elle pas à l’écriture poétique, au poème que la poétesse est en train d’écrire mais qui fuit et qui est fugace pareil à une rose ?
Omniprésente dans le recueil Palpable en un baiser, la rose symbolise la fugacité de l’amour et de la vie. Rouge, elle évoque la passion et la brièveté du poème et de la vie « une rose est tombée dans l’eau d’une fontaine. /Le vent l’a-t-il poussée jusqu’à toi ? /Tu lui as tendu la main »11 p.9. Cette plume blanche, comme la rose, ne cesse d’être une source inépuisable d’inspiration parce qu’elle émane d’une réserve vide, mais prometteuse de plénitude : le silence qui est dense, qui pèse sur la poétesse. Il est aussi un corps concret « la densité charnelle du silence »12.
2/L’ineffable :
Irène Duboeuf poétise avec brio l’amour et le rend palpable. Il faut peu de mots ou le sans mot pour échapper à l’abstraction et aboutir à la concrétisation. C’est pourquoi Irène Duboeuf raccourcit le vers, le réduit au maximum « Le jour s’éteint/J’attends »13. Ne disant rien, la poète écoute en dedans, refusant toute logorrhée verbale, préférant ainsi le minimum de mots qui renferme beaucoup de sens.
Elle le bride au point d’opter pour une esthétique du dépouillement pour saisir la chose dans son immédiateté, sans pensée, ni langage, ou plutôt avec le minimum de mots voir aussi l’absence de mots, rivalisant ainsi l’art qui dit d’une seule traite. La photo, la musique, ce langage muet qui ne pose pas un sens, mais le propose, un langage qui dit sans dire, qui dit en se taisant.
Force est de souligner qu’une poésie sans mot est une poésie qui met en question l’essence même de la création poétique, qui transgresse les conventions de l’art poétique classique. Si l’espace vide de la page blanche domine la trace écrite c’est parce que le travail poétique est le fruit d’une méditation. Ainsi il s’avère que le sens n’émerge pas des mots, d’une énonciation verbale, mais d’une énonciation sans énoncé, de la contemplation. Car en contemplant, en pensant sans mot on rate la chose, à cet égard Maurice Blanchot postule «la chose devient image, où l’image, d’allusion à une figure, devient allusion à ce qui est sans figure et, de forme dessinée sur l’absence, devient l’informe présence de cette absence, l’ouverture opaque et vide sur ce qui est quand il n’y a plus de monde, quand il n’y a pas encore de monde »14.
Il en découle que dans l’espace poétique il n’y a de prédicat que l’absence. La poésie d’Irène Duboeuf est le lieu par excellence de l’inexprimable et l’écho muet de la contemplation. Irène Duboeuf, plus elle contemple, plus les mots lui échappent, car à mesure qu’elle se plonge dans l’infini cosmique, elle découvre les failles du langage et de son être. Dans son poème intitulé « Contemplation », la nature est sereine : « Assis dans la sérénité des pierres »15. La poétesse, ébaubie de soleil et de lumière se heurte au silence : « tu sais que les mots se taisent/à la hauteur du cœur »16. Parfois ce qu’on écrit ne dit rien de ce qu’on sent « les mots se taisent à la hauteur du cœur » car les mots tendent à abstraire. Alors il faut donner un corps aux mots, objectiver, pour exprimer cet essentiel qui échappe aux mots abstraits.
Il va de soi que l’ineffable occupe une place importante dans la poésie d’Irène Duboeuf : ce qu’elle sent au moment de la contemplation ne franchit pas le bout des lèvres. « Cette nuit j’aurais aimé écrire…/j’ai noté quelques vers/l’air froid gelait les mots…/Cette nuit, je ne t’ai pas écrit »17. La poétesse évoque dans son poème « je ne t’ai pas écrit » une page blanche où elle se heurte à l’ineffable qui n’est pas un tarissement poétique, mais une promesse de plénitude.
Au cœur de l’expérience poétique, la contemplation ne se limite pas à un regard superficiel sur l’espace physique, elle est une immersion sensorielle méditative profonde. Ainsi elle désigne indubitablement le regard émerveillé que la poétesse porte sur l’amour, le poème, son être en vue d’en saisir l’essence au-delà des apparences immédiates. Observant le monde intérieur et extérieur via ses diverses sensations visuelles et tactiles, Irène Duboeuf vise à rendre l’expérience concrète et immersive, à traduire son émotion et son émerveillement et à mettre en valeur cette fusion entre le contemplateur et l’objet contemplé. Elle réussit avec brio à vaincre ce hiatus entre la contemplatrice « contempleuse » et l’objet de la contemplation. Il en découle que la frontière entre le « je » contemplateur et l’objet contemplé (l’amour, le poème, la vie…) s’estompe.
Certes, la contemplation est un moment de vide par excellence, qui est dû à quelques moments difficiles de sa vie, comme la perte de sa mère. En effet, en dépit du deuil, la poétesse ne s’empêtre pas dans le dolorisme, dans le poème « sans toi », dédié à sa mère : « Dans la déflagration du silence/je n’ai pas pleuré/mes larmes étaient épuisées/depuis que j’imaginais/la vie sans toi »18. L’absence de la mère pèse beaucoup sur Irène, fille et poète dont l’absence de larmes signifie qu’elle hurle en silence à cause du vide. Mais ce vide implique dans le recueil une connivence, une certaine complicité avec soi voire un silence intérieur. C’est via le blanc typographique, l’économie du langage poétique, l’esthétique du dépouillement que nous avons mentionnée précédemment que la contemplatrice Irène se retrouve. Par conséquent la contemplation implique un recueillement avec beaucoup d’espoir. Irène plonge dans la rêverie, peint un monde de sensations pour exalter et recueillir « le premier soleil », « l’or du soleil ».
Le « je » contemplateur veut se détacher du monde. Apparemment il est à l’extérieur du monde, mais en réalité il est à l’intérieur du monde ou plutôt le monde est à l’intérieur de lui. Le monde est dans ou sur la langue, dans l’œil qui contemple, dans la main, le cœur et dans le corps car dans une perspective phénoménologique, notamment celle de Maurice Merleau-Ponty, le monde ne peut pas être distingué du corps « visible et mobile, mon corps est aux nombres des choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde »19.
Il va sans dire que le recueil est une cueillette de beauté, de roses (poème) si bien qu’il apparait comme un bouquet de vers, de poèmes qui se hument, se palpent, qui après s’être répandus autour d’elle, laissent leur sillage auprès du lecteur. Ce lecteur anonyme qui butine chaque rose sans se poser sur aucune.
Le recueil sert à afficher une présence concrète du poème, des mots que la poétesse sent, matérialise en leur donnant un corps palpable, en atténuant l’expression, jusqu’au silence. Même le deuil s’allège au contact de vers légers, concis. Irène Duboeuf écrit pour dire ce qui ne se dit pas. Le pari d’unir l’invisible au réel a pour corollaire l’ineffable car ce qui est matériel se montre, ne se dit pas. C’est pourquoi, c’est le blanc qui domine la trace écrite.
Écrire un poème semble alors mettre du blanc sur le noir. Ce blanc qui est un poème absent, s’explique par le fait que la poésie provient de l’expérience sensorielle, elle ne se nourrit pas du logos mais des informations que les poètes reçoivent du monde extérieur via les cinq sens, particulièrement le toucher, dans ce recueil.
Tout passe par le corps que ce se soit pour l’écrivain ou le lecteur. Irène Duboeuf, la source du recueil à nos yeux n’est pas une écrivaine, mais plutôt une « écriveine ». Le lecteur lit tout ce qui coule de « l’écriveine » par ses cinq sens traditionnels. Nous nous interrogeons sur la possibilité d’un pacte de lecture sensorielle. La lecture, comme l’écriture poétique pourrait être une expérience sensorielle. Dans ce contexte Christian Bobin croit en une lecture tactile : « On lit avec les mains autant qu’avec les yeux. Le toucher d’une main calme sur la page d’un livre, c’est la plus belle image que je connaisse, l’image la plus apaisante qui soit : une main tendre sur une épaule d’encre ». Irène ne trempe pas sa plume dans un encrier, mais dans ses veines.
3/Conclusion :
En premier lieu notre analyse nous a permis de montrer, selon une optique sémiologique, que ce recueil est une osmose entre la matérialité et l’immatérialité. Une fusion du sensible et du mental, du visible et de l’invisible, jalonne les poèmes d’Irène. Le sens nait de cette fusion entre langage et corps. L’arrière-plan de la conception d’Irène Duboeuf est certainement la théorie barthésienne sur le rapport entre langage et mot : selon la poétesse, les mots ne sont pas des signes abstraits ; ils ont une matérialité. Ils sont palpables. On rejoint ainsi la réflexion de Roland Barthes qui a permis d’enrichir les études contemporaines sur la corporéité.
En second lieu, selon une perspective phénoménologique nous avons mis l’accent sur la corporéité. Il s’avère que l’écriture poétique est conçue comme un acte corporel qui engage notamment la main. On écrit ce qui nous touche littéralement. Nos sensations, sentiments, pensées et même le monde sont dans nos mains.
Par l’écriture, ce geste du corps, Irène Duboeuf visualise le sentiment amoureux étant donné qu’elle est enracinée dans le monde scripturaire ainsi que dans le monde physique par son corps. C’est le corps ancré dans le monde qui perçoit et concrétise tout ce qui est abstrait. À cet égard Maurice Merleau-Ponty affirme : « Percevoir c‘est se rendre présent quelque chose à l’aide du corps »20.
Il s’avère que dans le recueil, il est une appréhension sensible plus importante qu’une vision intellectualisée. La poétesse a une prédilection pour l’expérience sensible et non pas l’élaboration abstraite de l’esprit. Elle écrit ce qu’elle sent.
Depuis Babel, il faut chercher la signification du langage dans son rapport au monde et non plus dans les mots eux-mêmes. Irène perçoit et poétise l’amour, la vie avec son corps. La chose, le langage et le monde lui sont donnés avec les sens.
La poésie, cette quête de sens et d’expression a une affinité avec l’art, particulièrement la musique et la photographie. C’est une poésie muette où le silence est plus important que les vers, les mots car en écoutant son corps que les poèmes ont pu être notés sur la page blanche brièvement. Irène Duboeuf dit sans dire des poèmes succincts qui touchent les profondeurs de l’expérience humaine en matérialisant ce qui est impalpable et en prenant conscience du monde via le corps car l’ineffable peut être concret, palpable en un baiser.
Notes
1. Irène Duboeuf, Palpable en un baiser, Editions du Cygne, Paris, 2023, p.19
2. Op.cit, p.5
3. Jean-Jules Richard, Neufs jours de haine, Editions de l’Arbre, Montréal, 1984, p.71.
4. Irène Duboeuf, Palpable en un baiser, op.cit, p.11
5. Ibid., p11
6. Roland-Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Editions de Seuil, Paris, 1985, p. 64.
7. Irène Duboeuf, op.cit., p16.
8. Ibid., p.9
9. Maurice Merleau-Ponty, L’œil est l’esprit, Gallimard, 1960, p25.
10. Ibid., p.23.
11. Op.cit., p9.
12. Ibid., p30.
13. Op.cit., p44.
14. Maurice Blanchot, L’espace littéraire, Gallimard, Paris, 2009, p.23.
15. Irène Duboeuf, Op.cit., p8.
16. Ibid., p.8.
17. Ibid., p56
18. Op.cit., p.29.
19. Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Gallimard, 1964, p.19.
20. Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde, Gallimard, 1969, p.104.
