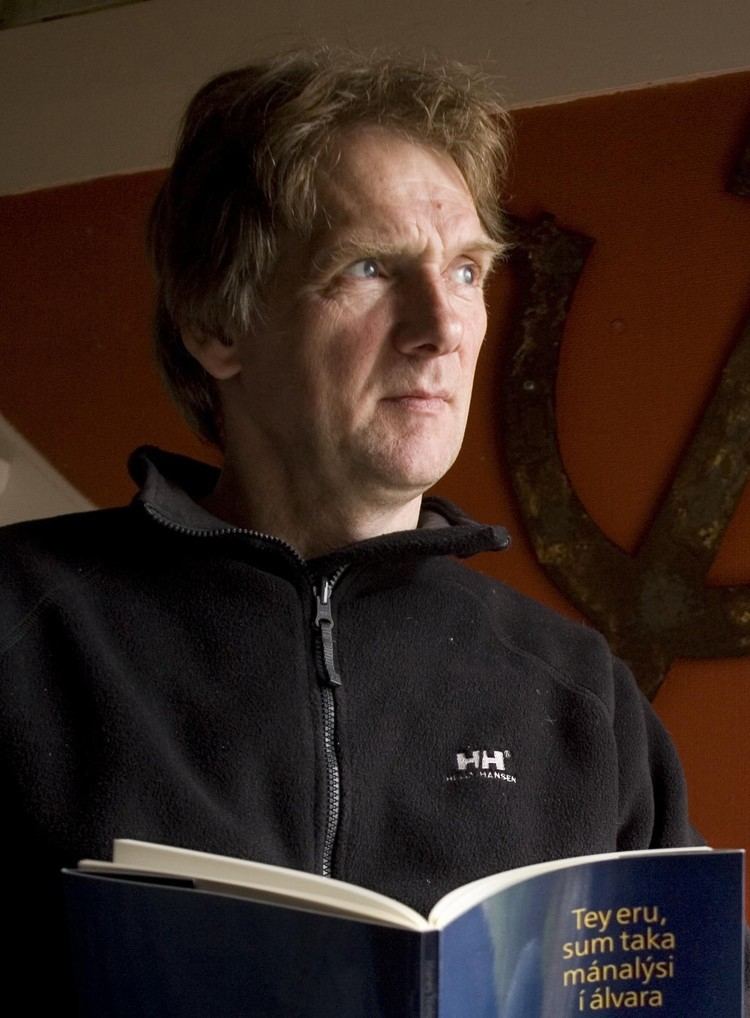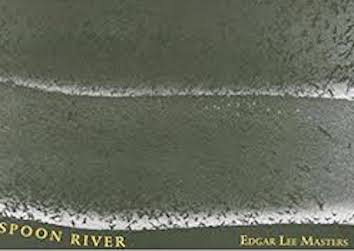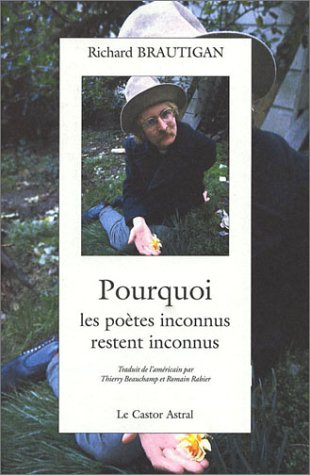Alda Merini, La Terra Santa, préface de Flaviano Pisaneli, traduction Patricia Dao
En 1993, Alda Merini a reçu le prix Librex Montale pour La Terra Santa. Le titre plonge d’emblée le lecteur dans un « espace » précis à la fois mythique et mystique qui renvoie à la promesse d’une demeure sacrée dans lequel l’homme peut se régénérer écrit Flaviano Pisaneli (lui-même poète) dans sa préface. Cet espace est celui de la poésie, corps-matière où flamboie une énergie devenue parole de tous les possibles.
La Terra Santa est un chant halluciné où l’enfermement et le silence sont dévorés. Merini fait exploser la souffrance où son corps se disloque et butent ses mots. Mais elle est mordue par une abeille venimeuse, seule capable de marquer sa chair malade du sceau de la poésie, de lui donner densité et mouvement : Peut-être faut-il être mordus/par une abeille venimeuse/pour envoyer des messages/et prier les pierres/de t’envoyer la lumière//. Oui, Alda Merini a perdu les sens, l’enfer de l’hôpital psychiatrique (violemment dénoncé) anéantit tout pouvoir de sublimation. Il est matière pestilentielle, lieu où les hantises sont au paroxysme et la perte de soi irrémissible : Affori, pays lointain/ immergé dans les immondices// à nous personne ne parlait/ sinon à coups de pieds et de poings//Affori où les cris étaient étouffés par de sanguinaires coussins.// Il est lieu clôt par excellence : les corps n’ont d’autres assises que le vide, les bouches s’absentent, les électrochocs sont les réponses apportées aux corps qui se rapprochent : ce précipice secret qui est le mien//tu connais l’égarement qui est le mien quand je vois un arbre solide//enserrés derrière les barreaux comme des hirondelles nues// j’ai gardé le silence enfermé dans ma gorge/comme un piège à sacrifices/. Mais La Terra Santa n’est pas seulement le recueil d’une femme qui a été internée pendant presque vingt ans, ni celui d’une femme que sa folie pousserait à faire acte de catharsis par l’écriture, elle n’exorcise pas ses souffrances mais les sacralise pour mieux les transcender et les effacer.
Alda Merini s’empare du venin de son abeille, du poison de la folie (pouvoir caché du poein?) il lui donne la liberté de s’affranchir de tous les interdits, ceux qui régissent les lois de l’hôpital psychiatrique et ceux qui polissent le langage alors langue blasphématrice. Sa terre, infiltrée par le flux salutaire, se fait « Illuminations » et « silences traversés des mondes et des anges » : /naissances ultraterrestres// mon éternité sans limites//. Les images ont jailli d’un territoire où les métaphores sont « déréglées », leur beauté est première. S’entend la voix bouleversante d’une femme qui a donné corps et parole à une terre sacrée. S’il est un être qui a franchi l’innommable et connaît le secret de la poésie c’est Alda Merini :
Je n’ai ni feuilles ni fleurs ;
et pourtant alors que je transmigre
naît profonde la lumière

Alda Merini, La Terra Santa, Oxybia éditions, 2013, 136 pages, 15 €.