Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage
Dès l’ouverture du livre nous voilà prévenus : la genèse de ce recueil est le résultat de la visite d’une exposition faite par l’auteur. Il s’agit de l’exposition photographique de l’artiste Danoise Trine Søndergaard, intitulée « Still ». Silence et calme, immobilité, c’est ce que ce mot anglais indique.
Et de fait, ce livre, fait de vers et de proses poétiques, suggère un temps arrêté, comme empêché. C’est un livre d’ambiances, un parcours dans des lieux hantés, des lieux abandonnés, désaffectés, tombant en ruines. Des lieux de solitude et de déchéance qui « racontent » en négatif, en pointillés, des histoires d’humains contrariés, maltraités, malheureux, et dont la présence fantôme pèse son poids de tristesse, de glauque, de naufrage. L’on se demande si les descriptions ne symbolisent pas un paysage humain intérieur dévasté, d’où la sensation de vide vertigineux qui prend aux tripes, comme si l’on assistait à la visite des ruines d’un soi-même prisonnier des regrets. Il règne au début du livre une ambiance sombre d’après catastrophe. Sont ressentis tantôt enfermement, tantôt chute, tantôt étouffement qui accompagnés de sons en ui, i et u, disent la souffrance, la plainte. Nous avons le lugubre dans l’oreille et le délabré sous les yeux.
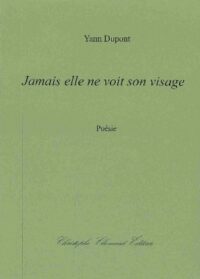
Yann Dupont, Jamais elle ne voit son visage, éditions Christophe Chomant, 67 pages, 14 euros.
« Hésiter du pire et s’en vouloir du meilleur », voilà le programme de l’entre-deux, du choix difficile, de l’insatisfaction permanente ressentie par ce « lui « qui pourrait aussi bien être cette « elle », parti-e à la rencontre de quelqu’un. Un quelqu’un qui pourrait bien être soi-même piégé dans un rêve, un cauchemar, où le-la marcheur-euse va en équilibre sur la corde de sa folie avec à la main, en guise de boîte de Pandore, « une boite de métal rouillé » qu’on n’ose pas ouvrir, parmi des revenants qui se cachent.
Plus loin, on se demande si nous ne sommes pas échoués dans un tableau de Jérôme Bausch : « les femmes loin dans le fracas de leurs nudités effacent les traces absorbent le sang des mots ruminent des carcasses. »
Et c’est alors qu’il est question de cheveux, de coiffes. De ces différents tableaux sourd la nostalgie d’une enfance insouciante et le sentiment de l’impossibilité d’atteindre la pleine connaissance de soi. Nous voilà en présence de femmes, paysannes Danoises probablement. On suppose qu’elles subissent le temps qui passe en se soumettant aux traditions. On les comprend mariées trop tôt, leur jeunesse sacrifiée et les regrets qui en découlent. Les bouts de chevelure et autres cheveux tombés à terre matérialisent le temps écoulé qui semble paraître bien long désormais. Une coiffe : « comme une main / plaquée sur ses cheveux / cinq longues griffes / puissantes acérées. » La menace plane, la réalité de la condition féminine y est esquissée en filigrane : ces femmes étaient monnaies d’échanges, instruments, proies des mâles, ils étaient les maîtres et pas toujours bienveillants. Pourtant ces femmes avaient des aspirations, « fleur-bleue » à bien des égards mais pas que. Être aimées et regardées pour ce qu’elles étaient, sans doute elles en rêvaient. Femmes et non infâmes pêcheresses, et non diablesses tentatrices devant se voiler, se réprimer, se nier, se confesser, s’effacer… femmes avec leurs désirs, leurs plaisirs, leurs velléités de vivre pleinement et l’espoir d’échapper : « Elle écrit le cri d’une mouette / […] Tracer des « L » à la place des « T » / Ne plus se taire pour s’envoler. » On ne peut alors s’empêcher de penser à la Nina de Tchekhov, à ses personnages qui se cherchent. En quête d’amour, de réussite, au dénouement tragique de la pièce ils se confrontent à leur image. Le monde entier est un théâtre selon Shakespeare, le livre de Yann Dupont à sa façon l’est aussi. D’ailleurs page 26, nous voici conviés à une danse et l’écriture suit tantôt les trois temps de la valse, tantôt les quatre temps du rock’, roll : « Un corps court […]. Un corps nu, un corps homme, un corps femme, un corps juste, un corps ferme. […] Un corps ici, un corps ailleurs. Un corps vitesse. » Toute danse est affaire de corps et d’espace, et dans le tournoiement pour finir, corps et espace ne font plus qu’un.
Femmes coiffées dont la coiffe signale la position sociale, certaines brodées au fil d’or … mais femmes mendiantes aussi, et l’on ne peut que penser aux temps actuels, à ces femmes dans les rues aujourd’hui en lisant : « Agrippées au goulot d’une bouteille en plastique / Ses mains fébriles recherchent un reste de dignité ». Car l’on ne s’y trompe pas, les femmes coiffées évoquées par Yann Dupont sont les aïeules et les semblables des femmes du 21ième siècle.
Dans un précédant recueil intitulé Fragilité(s), édité là encore par Christophe Chomant, Yann Dupont se faisait déjà le poète de la solitude, déjà il esquissait des silhouettes funambules au bord du gouffre, prêtes à basculer, et sans doute c’est ce registre qui lui convient, gageons que sa sensibilité, ou encore son empathie, lui rendent familiers ces étranges figures. Jamais elle ne voit son visage donne donc cohérence à un édifice poétique que nous aurons plaisir à voir se construire.
Béatrice Machet




