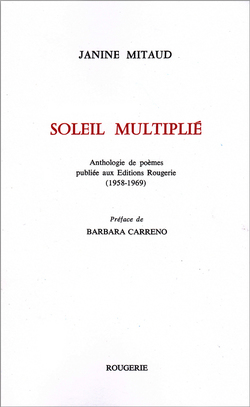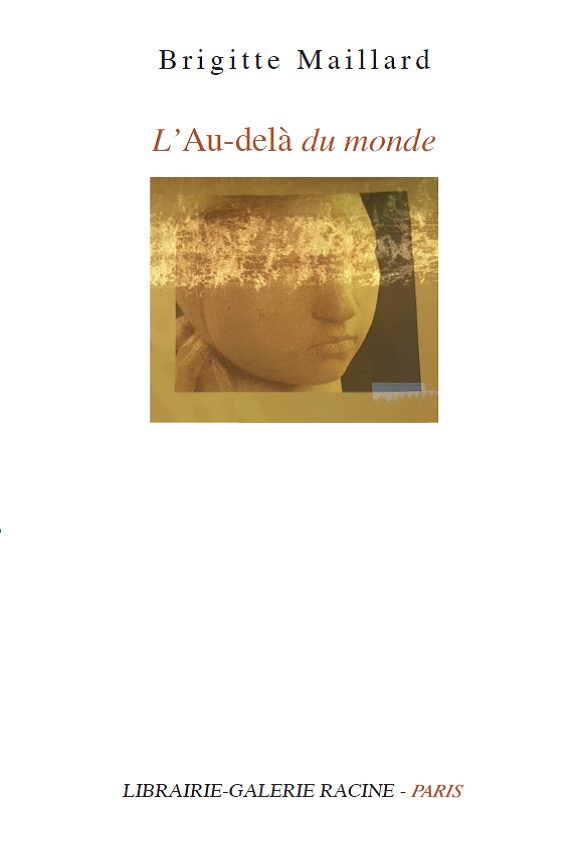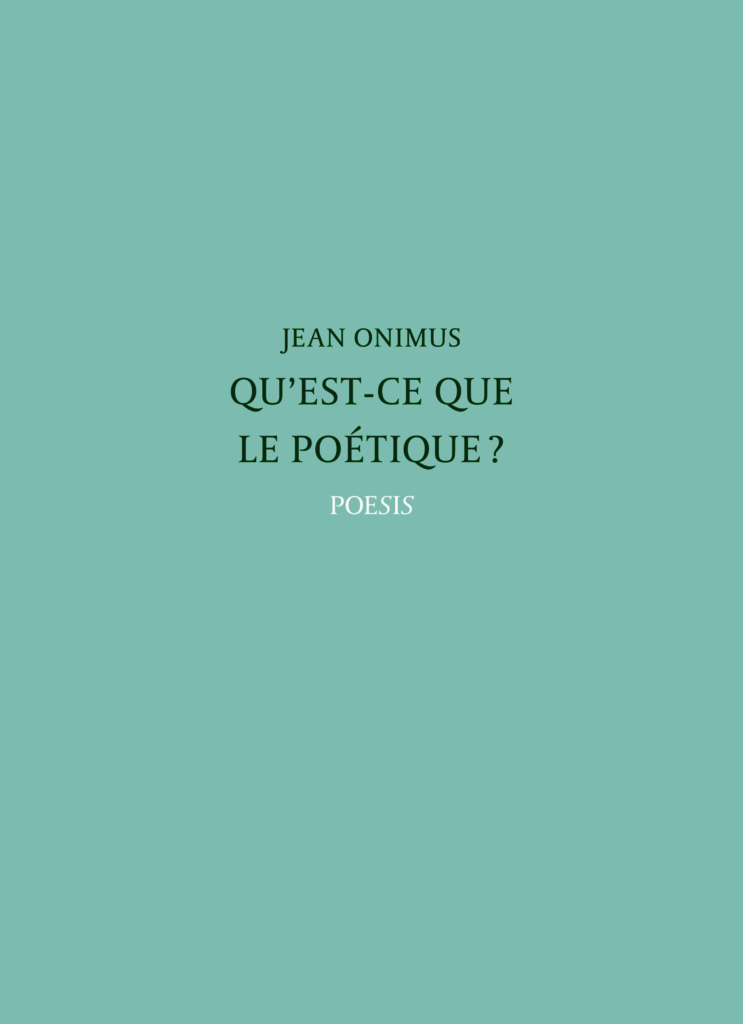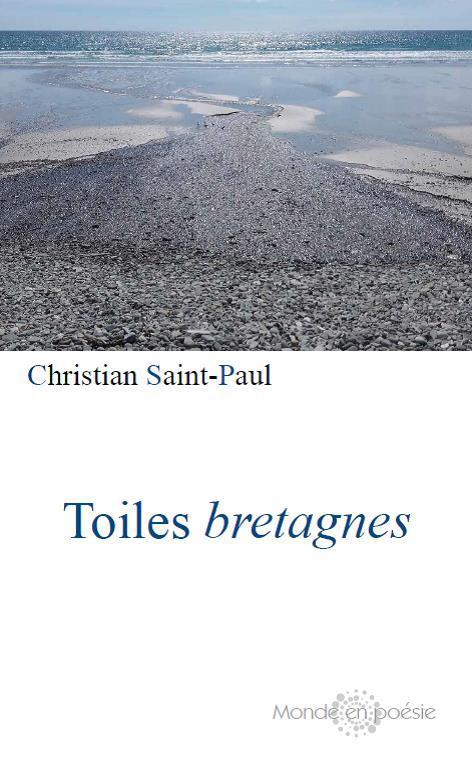Gérard Mottet, Par les chemins de vie
Dès l’ouverture du recueil, une question lui donne sa tessiture : « La poésie : quoi d’autre que cette voix qui tente éperdument d’apprivoiser l’incertitude ? ». Philosophe de formation, Gérard Mottet, porte en lui cet amour de la question qui le pousse à interroger inlassablement notre essentielle fragilité. A travers ses textes, le temps semble se diffracter en de multiples miroitements où persistent quelques scintillements de l’enfance :
Où vont nos pas dans les poussières
De ces chemins trop incertains
Où vagabondent nos regards
Qui s’usent aux éclats du monde
Retrouverons-nous jamais la mémoire
Perdue de nos contrées originaires.

Gérard Mottet, Par les chemins de vie, éditions Unicité, 2017
Si à chaque instant la mort est inséparable de la vie et que chaque pas nous en rapproche, il nous faut cependant essayer de rendre « à notre âme l’élan perdu de ses désirs ». La contemplation du monde et de la nature peut ainsi ouvrir la voie à une sorte d’apaisement et de consentement à notre éphémère destin :
Vois comme les rivières et les fleuves
Aiment aller se perdre dans la mer immense
Et tout le firmament de la nuit venir s’y refléter.
Ouvre vaste ton seuil à la nature laisse la venir.
Ainsi nous marchons en « ces chemins secrets vers cet ailleurs qui est toi-même », en quête à la fois de nous-mêmes et d’accomplissement, pour maintenir ouvert le champ des possibles, comme un écho « au deviens qui tu es » de Nietzsche : « préfère ce qui n’est pas encore advenu mais le devient. […] préfère ce qui vient à ce qui est déjà venu et ne t’arrête pas en chemin connu […] Laisse-toi devenir. » Alors parfois peut surgir un bref instant de grâce, comme une épiphanie, pour panser notre mémoire endolorie :
Connaîtras-tu comme autrefois enfant
Juste la grâce d’un instant
Le pur jaillissement d’une étincelle
Qui te fera soudain renaître
Dans la coïncidence de toi-même.
Si nous nous sentons parfois comme prisonniers d’un « ici » morne et monotone et que « lourds nous semblent nos pieds attachés à la terre », déchirés entre notre besoin d’appui, de stabilité et notre désir de nous envoler avec au cœur cette soif inextinguible d’immensité, toujours l’ailleurs nous appelle à nous dépasser nous-mêmes pour enfin « faire danser toute la terre, danser la vie et danser la lumière, toi voltigeur de l’infini. ». La parole en définitive s’avère être le seul véhicule de cette envolée furtive :
Les mots parfois
Ouvrent leurs ailes de colombe
Et s’envolent au loin
S’échappant d’entre les barreaux
Du quotidien.
Mais le désir étant sans fin, le bonheur est toujours autre part, insaisissable, nous enchaînant à une sorte de déambulation forcée car nous ne sommes faits que « de l’étoffe du temps » et seul l’instant présent est en définitive riche de notre éternité. Ceci nous détermine à être à la fois présents et absents à nous-mêmes, à la fois « ici-ailleurs » en même temps dans ce jeu de la vie où s’allient les contraires et les paradoxes. C’est pourquoi la thématique de la marche et du pas fait sans cesse retour car elle est l’essence même de la vie et de notre nomadisme existentiel :
En chacun de tes pas
Il y a un chemin impossible
Que tu n’emprunteras pas […]
Es-tu rien d’autre que ce mirage là-bas
Qui te tourmente
Que cette ligne d’horizon
Imaginaire
Que tes pas ne pourront jamais atteindre.
L’homme en sa finitude à la beauté d’une « fleur suspendue au bord de l’abîme », mais vaine est sa tentative de fixer l’instant, d’arrêter le flux et reflux du temps à travers l’écriture, seul compte le mouvement d’aller vers ce que l’on ne connaît pas encore et qui reste toujours à inventer, à définir :
Laisse Laisse courir la vie en liberté
Ne tente pas de l’arrêter car accomplie
Ne sera ton œuvre de vie
Que lorsque te sera donné d’enter
Dans ton ultime vérité.
Alors la vague que nous sommes peut enfin revenir « au flux incessant de la mer » et le vieil homme se reposer « comme s’il eût reçu sa part d’éternité. »
Ainsi en ces « Chemins de vie », Gérard Mottet nous emporte dans une profondeur sans concessions, nulle place ici pour l’artifice, il ne reste plus que l’essentiel en de fulgurantes métaphores ou paradoxes où s’allient les contraires, à l’image même de notre humaine condition. Un très beau recueil à découvrir absolument.