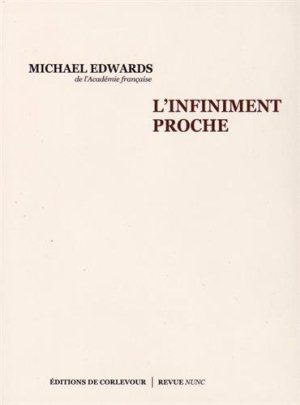Chronique du veilleur (23) – Michael Edwards, L’infiniment proche
Il y a chez Michael Edwards la volonté toujours perceptible de ne pas s’égarer hors de son sujet, dans le détail ou le superflu. Et ce sujet est d’abord le poète lui-même, « poète de l’impossible réel », qui le surprend sans cesse, dans les plus ordinaires des circonstances, dans la veille ou l’entrée dans le sommeil. Il s’interroge : « Qui parle dans ma tête sans mots ? » Une réponse parfois lui parvient de loin, d’un univers qu’il a du mal à délimiter :
J’entends, dans un autre ailleurs, mon nom
Qui, retentissant sous cette voûte,
Me met, en un tour de main, debout.
Il regarde, lui aussi, vers le ciel « miroitement d’origine et d’avenir ou bien / fenêtre aveugle », semblable à tous ces gens dans les rues de Paris, par un après-midi de juin, face à « l’infiniment proche. » Qui est-il ? Combien de moi « bizarres » s’agitent-ils en lui ?
Mais il arrive que Michael Edwards parvienne à isoler une sorte d’essence de l’homme, de ce qui constitue sa nature et sa condition. Dans le poème « Voir », les vers laconiques, la langue épurée, cernent une dimension à la fois tragique et mystique :
l’homme est si peu
seul dans l’univers
son haleine ne chauffe
aucune lune
son sang ne coule
sur nulle étoile
la mer le suffoque
la terre l’ignore
marées d’angoisses
crachins de faiblesses
L’idéal à atteindre serait « une ligne simple, droite », pour dire la nudité même ou, moins encore, le plus insaisissable, à la lisière de l’absence :
Je serai le rêve de l’ombre,
Une ignorance au cœur de l’arbre.
Un immense fond de ténèbres, de puissants nocturnes, nourrissent cette poésie qui s’élève parfois jusqu’à la vision :
La Terre, tel un grain semé
Dans le champ profond de la nuit.
L’exigence si forte, si pressante de connaissance de soi semble alors abdiquer, laisser place à une espèce de fascination du vide. Le poète s’écrie :
On a perdu le souffle et on ne pense plus.
Faut-il ne plus être pour connaître ce moi ?
Le livre se termine cependant par « Benedicite », un cantique de louanges qui semble clore tout un parcours de questions ou d’errances et dont la lumière éclate en de magnifiques images :
Sel et sol, bénissez le Seigneur,
Louez-le, exaltez-le à jamais.Dans le jardin d’hiver, les reines
Veillent sur l’étrange,
Sur les ombres bleues dans les plis
Du manteau d’étoiles de la neige.