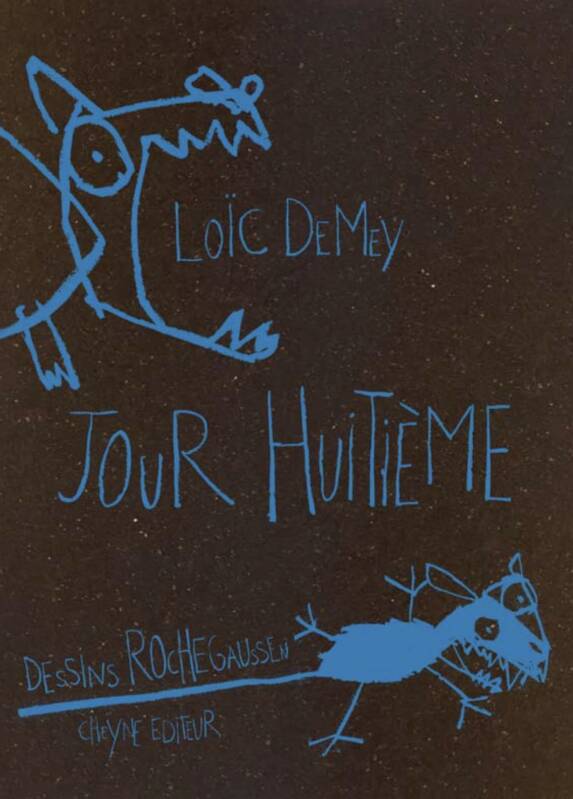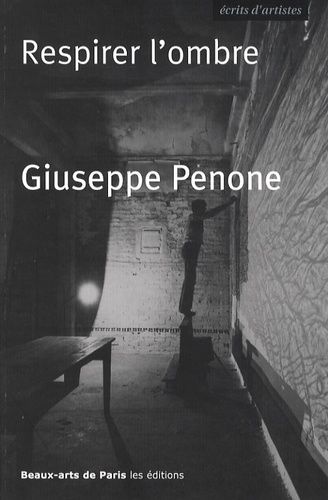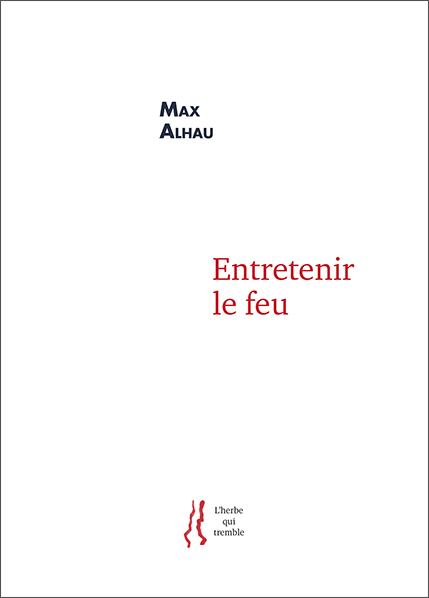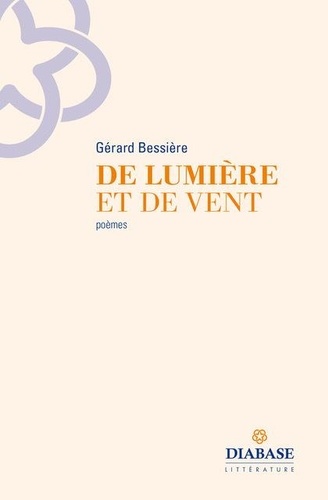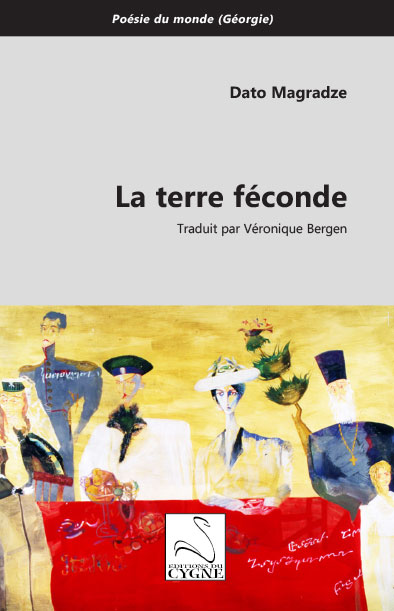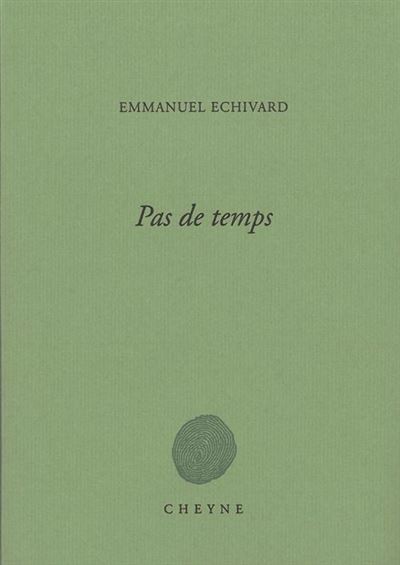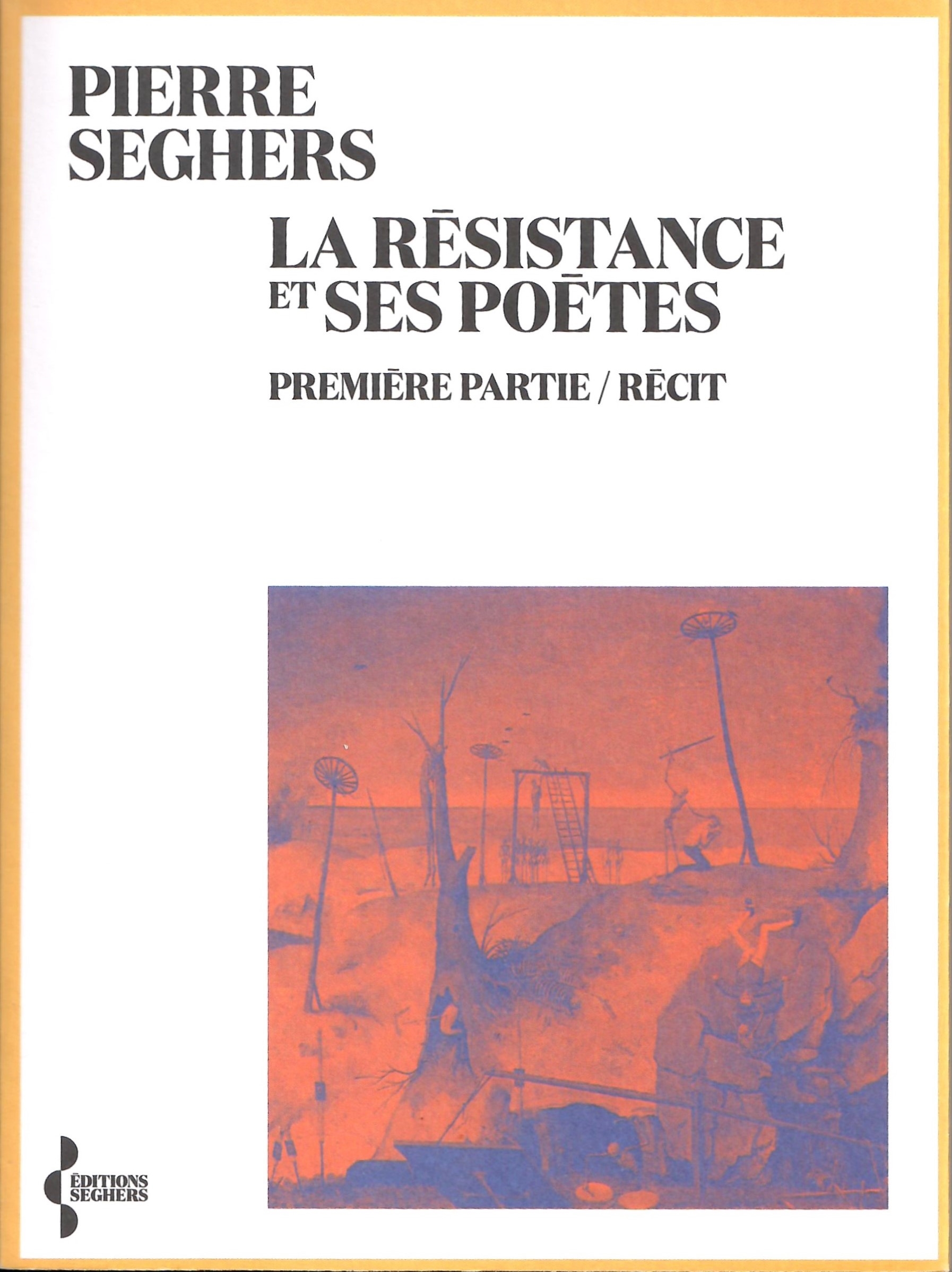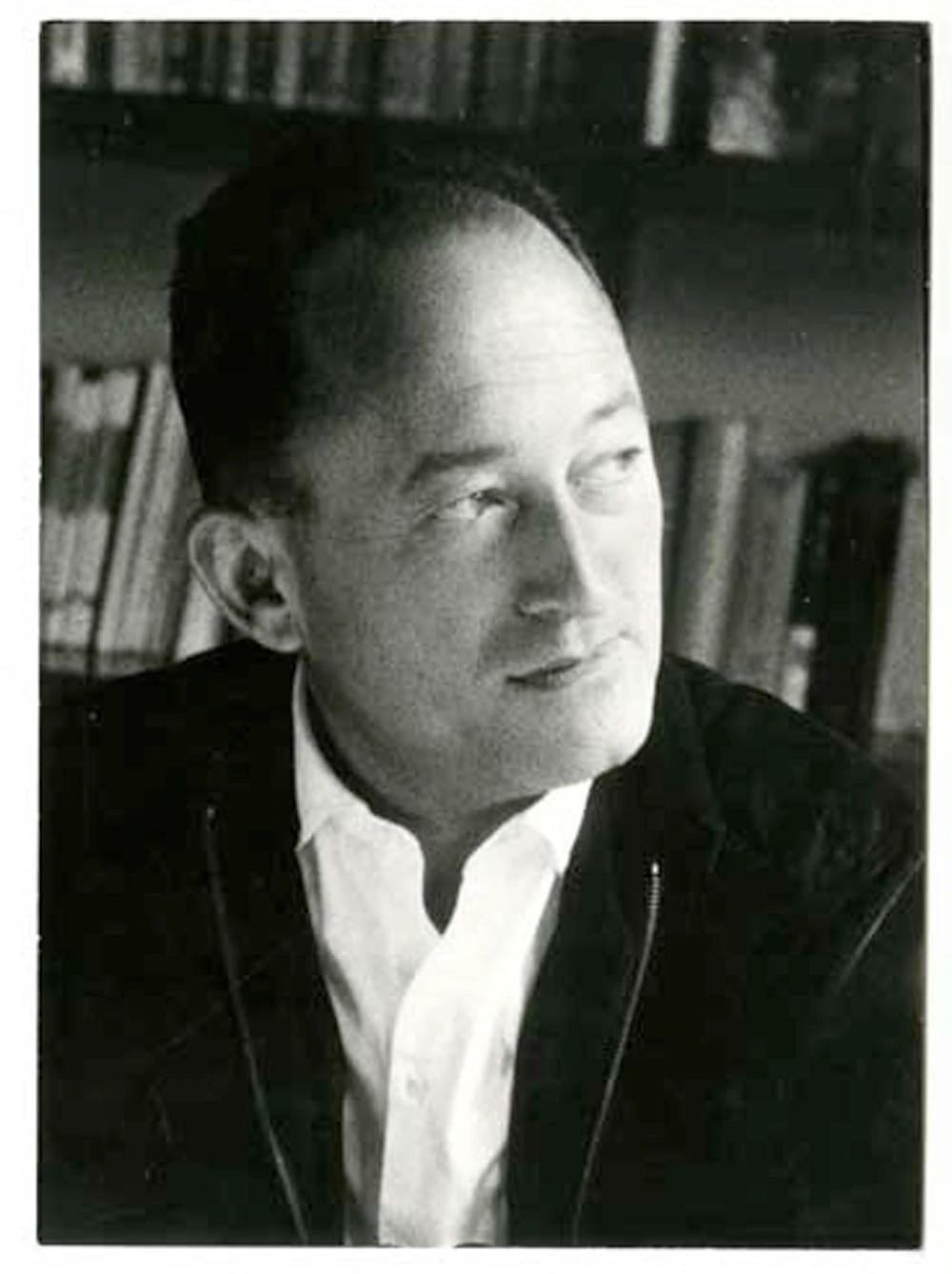Lu Ji, Wen Fu, Essai sur la littérature
Alexis Bernaut, traducteur de la version anglaise du Wen Fu de Lu Ji par Sam Hamill, poète américain proche de la Beat génération, revient dans l’avant-propos de sa version française sur des moments d’amitié qui l’ont lié à son aîné, disparu en 2018, et sur le sens initial et initiatique de l’expression chinoise « Wen Fu », inscrivant ainsi la double traduction par Sam Hamil, puis par lui-même, dans cette tradition fertile en renouveau : « Wen est l’un des plus anciens mots chinois, datant des temps chamaniques et des os oraculaires, il y a plus de trois mille ans. Il veut dire, à cette époque déjà, « art ».
Le fu, selon l’Encyclopaedia Universalis, est « un genre littéraire original dans la littérature chinoise, dont il est difficile de dire s’il se rattache, selon nos catégories occidentales, à la poésie ou à la prose ».
L’interprète français et réinventeur du texte ancien à la lumière des formules de son homologue américain revient donc aux origines de cet ars poetica asiatique comme à la source d’une tradition séculaire dont la transmission fait de chaque auteur intermédiaire un véritable écrivain, une référence dont l’autorité ou auctoritas, selon le terme latin, est ainsi recueillie dans « la transmission de l’esprit » de génération en génération, ce à quoi il ajoute : « Et l’une des fonctions de l’inscription du Mao Gong Ding est la passation – ou la translation – du souvenir d’un individu et de son lien avec l’empereur. Ainsi la traduction des textes. Et la traduction de ces traductions, une manière voire une tradition laquelle, elle non plus, ne date pas d’hier ».
Hommage en filigrane au poète américain affilié à la Beat génération en lien au poète chinois fondateur de ce petit traité sur la littérature dont la variété des conseils stylistiques se goûte à travers les âges comme des variations fragmentaires d’un même éloge à travers lequel l’ancienneté et la modernité à la fois lui confèrent une valeur intemporelle, celle-là même de l’éternité entraperçue de l’essence poétique. Emblématique de ce renouvellement perpétuel, c’est l’image de la hache taillée pour renaître sous les formes d’autres haches qui relie les trois hommes, Lu Ji, Sam Hamill et Alexis Bernaut…
Comme en témoigne sa réflexion de traducteur, ainsi se passe de témoin en témoin ce symbole d’un faire commun : « Cette métaphore est peut-être, dans l’histoire des lettres, la plus parlante quant à la manière dont la tradition informe le renouveau. Sam Hamill lui-même, qui n’oubliait jamais qu’auteur et autorité ont la même étymologie, la faisait sienne dans son long poème Triada paru en 1978, bien avant qu’il entreprenne de traduire le Wen Fu : « Et le vieux Ott avait une hachette, « Ça fait vingt ans que j’l’ai, qu’il disait, elle a eu une demi-douzaine de manches et j’ai dû changer trois fois la tête. » »
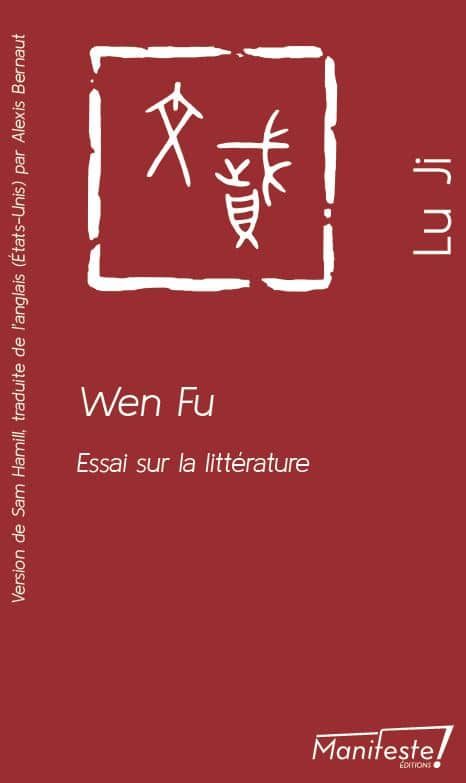
Lu Ji, Wen Fu, Essai sur la littérature, version de Sam Hamil, traduite de l’anglais (États-Unis) par Alexis Bernaut, Manifeste ! Éditions, Collection L’Envers du Temps, 56 pages, 7 euros.
Fulgurance sans cesse affûtée de la poésie au fil de l’histoire littéraire que narre Lu Ji dans son essai dont la trame des divers traités pourrait être reprise à son compte dans les rubriques d’un critique contemporain : Le premier geste, Le choix des mots, De l’harmonie, De la révision, De l’originalité, Cinq critères, Le chef d’œuvre, etc. L’une des formules de conclusion exprime paradoxalement cette vitalité toujours renaissante de la créativité antique : « L’art des lettres vient comme la pluie des nuages ; il ranime l’esprit vital. »