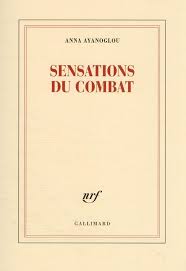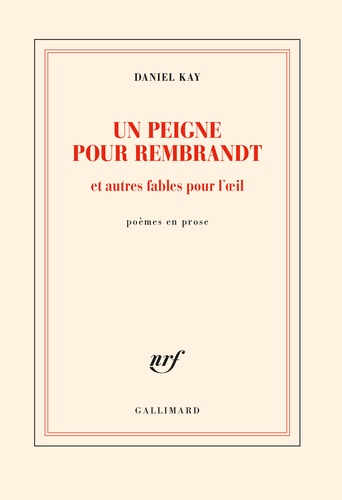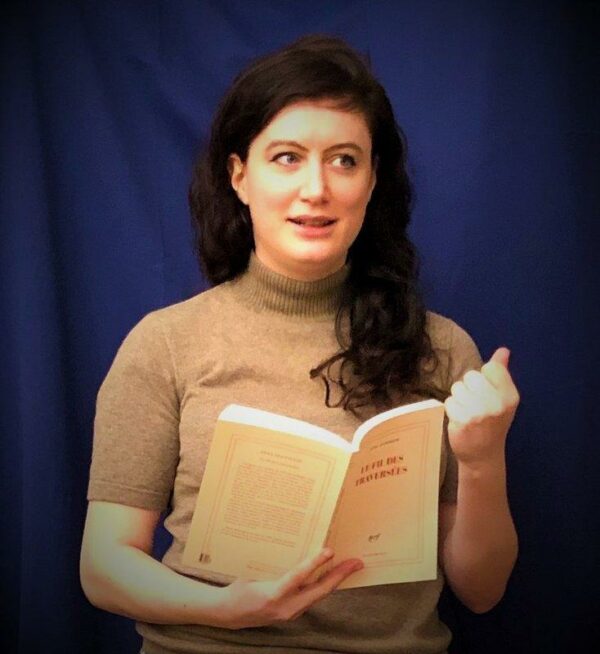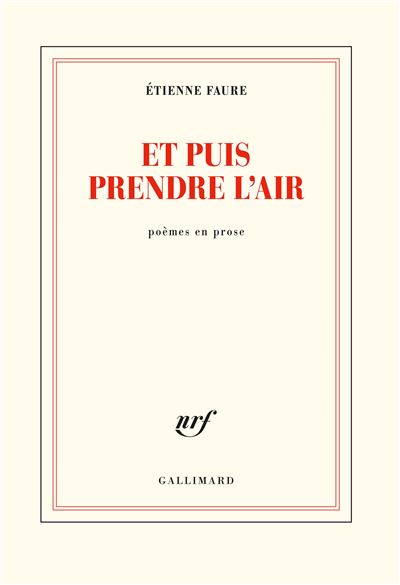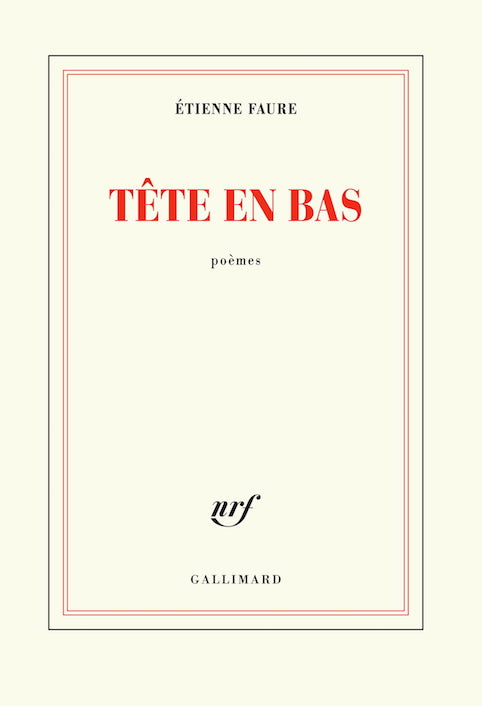Étienne Faure, Vol en V : AILES POUR E
Le livre est posé sur l’herbe du jardin. Vol en V sous les chants d’oiseaux. Il faut bien qu’il se patine… Ah, pas encore de taches de café ; ni annotations, au crayon mots soulignés ; tout au plus sur la dernière, blanche, ai-je reporté certains numéros de pages – un bon nombre.
Dix heures du matin, 30 degrés à l’ombre, Plein sud dirait Étienne Faure ; les hirondelles plongent, à vitesse grand V, happer un moustique (merci !), boire une goutte d’eau turquoise dans la piscine (il y a une piscine). Huit soleils brillent entre les pages 83 à 90 : des huitains, bien sûr, lumineux, voyageurs, le dernier « cou coupé » comme il (ne) se doit (pas).
Du monde entier, dommage, le titre est déjà pris. Mais c’est bien le cas, une attention exacte : le monde est là, devant nous, nous est donné, à prendre tel qu’il est, tel qu’il fut, compliqué, changeant, insaisissable, et pourtant le meilleur possible, n’est-ce pas. C’est peut-être ce que pensent les dieux, oui, les dieux eux-mêmes, confinés dans leur cambuse, jeunes et vieux fatigués aux premiers vers du livre,
mansardés par l’amour et le temps qui passe,
à boire un glass le soir aux fenêtres rousses
(p. 11) : l’incipit donne le ton. Les Muses existent. On les reconnaît parfois. Entre les lignes et les longitudes… latitudes…
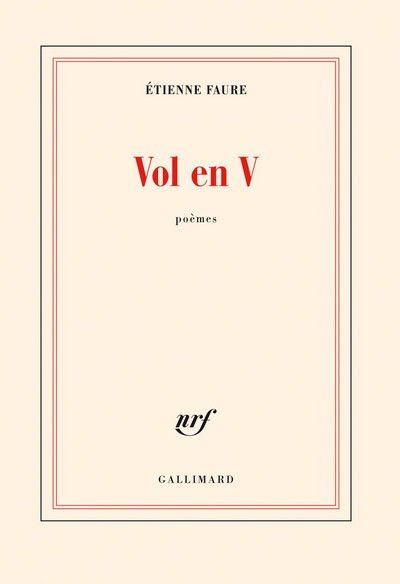
Etienne Faure, Vol en V, Gallimard, Collection Blanche, 2022, 144 pages, 16 €.
Le monde est divers, les poètes l’habitent, comme et quand ils peuvent. Celui-ci pratique de longue date un art du dépaysement qui doit moins aux pays traversés qu’à un rythme, un allant donné par la musique des mots, et qui change selon le lieu et le temps, Suisse, Irlande et Hongrie sous la pluie (pp. 52-53), Espagne, hémisphère sud, si je me souviens bien déjà abordé (ne fût-ce que par le titre) en 2018 dans Tête en bas. Oui, les mots prennent des sens étranges selon les lieux où on les entend, les prononce, et puis, peut-être, les écrit.
– et c’était la guinguette au cimetière,
les morts rajeunissaient à cette approche
(p. 125) : façon, peut-être, de concilier à la manière de Walter Benjamin la flânerie parisienne et l’Histoire, non loin du Mur des Fédérés
– il faudrait, cette vie, la revivre aux premiers bourgeons
du printemps, voir renaître la Commune,
rectifier Versailles… (p. 117)
des poires prometteuses, parfumées, fondantes
– des louises-bonnes, des comices, des williams, des conférences,
taillées en espaliers le long des murs de l’enclos
où furent ensevelis les corps sans tête en thermidor –
si juteuses. (p. 115)
L’air de rien Étienne Faure a de ces fulgurances qui vous brisent le cœur. Une aïeule perdue, le temps a passé, mais sa montre marche toujours, « je l’ai remontée ce matin » (p. 27, sur les pas de Florentina). Le pendule indique l’Est, penchant ancien, retour à l’enfance, aux souvenirs. Il se peut que le lieu de ces souvenirs, et souvenirs de souvenirs se situe, sur la carte, vieille carte qui ne cesse de changer, aux frontières de la Pologne et de l’Ukraine. Il n’y avait rien là de prémonitoire, seulement
les croix en bois dans le jardin
plantées comme s’il en poussait après la pluie
et les moineaux, wróbel, « diaspora sur les places anciennes » ferment le livre et l’ouvrent à la fois (pp. 131-134).
Toujours les titres sont à lire à la fin, c’est une manière de re-désorienter, si l’on ose dire, le lecteur dans la forêt des mots, poèmes en une seule phrase, chacun sur l’espace d’une page, pas toujours facile à suivre, et que le titre alors explicite… parfois. Dans la lignée des proses denses, mais légères de son recueil précédent, Et puis prendre l’air, Étienne Faure a voulu s’en donner, de l’air, et nous en donner en variant les formats : souvent plus brefs, et jusqu’à un (pas deux : un : il ne faut pas exagérer) haiku, dans l’ensemble Dix flaques (pp. 63-66), sobrement introspectif :
Vue des flaques, inversée la vie
sombre en profonds vertiges…
On découvrira aussi des mouvements plus amples, ainsi les deux poèmes de Traversée à pied où se fait jour une liberté nouvelle. Bien d’autres pages, m’a-t-il semblé, se ressentent de ce style direct, avec un rien d’insolence. Le premier et le plus long de ces deux textes, Rétablissement secteur nord-est (pp. 93-95) pourrait bien avoir été écrit du premier jet ! Il m’a fait penser l’espace d’un instant, un long instant, et tant mieux si c’est un contresens, à – j’y reviens – Blaise Cendrars.
Le temps n’est pas bonnard, on dirait qu’il va tomber
des cordes, des curés, des bobards du ciel antique jusqu’à
la fin du monde, puis le bleu revient, je savais bien,
c’est l’heure
de sortir.
La poésie devient danse, on s’envole avec les oiseaux sous le signe du vent et de la vie.
Qui, quoi d’autre enfin ? Des chats, vieux compagnons. Page 31, derrière la vitre, le poète metempsycosé considère (sceptique, amusé) le monde avec ces yeux-là, jaune vert, félin.