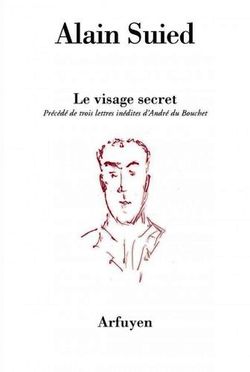Les mots cherchent l’oubli – l’oubli dont ils émergent et qu’ils voudraient ramener comme un nageur ramènerait la mer.
Bernard Noël
Jacques Lacarrière, dans sa préface à l’Anthologie de la poésie grecque contemporaine proposée par Michel Volkovitch (Poésie / Gallimard, 2000), souligne qu’« être poète en Grèce ou poète grec est presque un pléonasme ». Vérité certes immémoriale, mais n’est-ce pas en dépassant la redondance de l’expression « poète grec », qu’on peut saisir l’exigence d’une création littéraire authentique, comme celle de Stratis Pascalis, l’une des voix majeures parmi les poètes grecs vivants ?
Son cheminement poétique singulier s’effectue au fil d’une dizaine de recueils dont les titres révèlent la variété et le désir de renouvellement constant qui l’anime : Anactoria, Fouille, Une nuit d’Hermaphrodite, Cerisiers dans les ténèbres, Fleurs d’eau, Mihaïl, Comédie, En regardant les forêts, Les icones, et Saison de paradis, publié par les Éditions Al Manar et traduit par Michel Volkovitch, en janvier 2014.
À ce travail de création poétique se superpose sa vocation de traducteur. Véritable poète-passeur, Stratis Pascalis s’intéresse à nos plus grands auteurs pour les traduire en vers grecs, défi relevé avec les tragédies de Racine, Andromaque, Bérénice, Phèdre, et avec Cyrano de Bergerac de Rostand notamment. En outre, sa traduction des Illuminations de Rimbaud, des Chants de Maldoror de Lautréamont, de la poésie de Mallarmé, sans oublier celle du Passant de l’Athos de Bernard Noël, ne cesse de tisser des échos entre son écoute précautionneuse de ces prédécesseurs prestigieux et substantiels et sa propre création poétique.
Riche de toute une érudition littéraire, mythologique, philosophique, picturale, musicale, le lyrisme de Stratis Pascalis affirme ses profondeurs sismiques, ses fulgurances hermétiques mais aussi et surtout son charme incandescent symbolisé par la prédilection manifestement accordée à l’antithèse voire à l’oxymore, comme l’atteste le titre Cerisiers dans les ténèbres. Ce recueil de 1991 qui s’inscrit au cœur du parcours littéraire de Stratis Pascalis semble en effet faire signe comme les trois arbres d’Hudimesnil dans l’œuvre de Proust. Il annonce et confirme tout à la fois le goût majeur du poète pour l’alliance des contraires, sous l’ombre tutélaire et multiple de Racine et de Baudelaire, de Rimbaud et de Lautréamont.
Pour appréhender les profondeurs sismiques du recueil Saison de paradis, on peut retenir dans le poème Empreinte aveugle où se proclame « qu’il n’y a plus de voix / Rien qu’une empreinte aveugle – », une superposition de pluriels abondants :
Chroniques inachevées de l’Eden
Biographies d’innocents interrompues,
Enfers qu’éteignent des anges-pompiers
Avec des fontaines de pureté transcendante,
Des zones neutres de vie ordinaire
Bombardées par l’invisible,
Des pièces portant les tampons périmés des dieux –
(p.26)
avant que ne jaillissent à la clôture du poème des jeux d’opposition entre « la nécessaire passion violente pour le néant » et « son apothéose – trouvaille de l’ontologie / Enigme vaine d’un doigt latent / Sur un couteau tragique » où prédomine la vocation du singulier à l’abstraction. Même la lame tranchante du vers ultime avec son couteau « tragique » n’y échappe pas.
La poésie de Stratis Pascalis se caractérise par ses fulgurances hermétiques et ses éclairs verbaux qui subjuguent d’autant plus le lecteur que l’intelligibilité des poèmes lui résiste. Ainsi, dans le texte Code où s’entrelacent « sang » et « cristal », la voix lyrique annonce de façon paradoxale :
Et lorsqu’enfin viendra la vengeance
Odeurs des couleurs et chair et pot-à-eau spartiate
Je m’évaderai en hâte avec elle,
Dans une vie que j’ai tuée toujours tuée –
avant de proférer sentencieusement :
Voilà pourquoi je me convoque à nouveau
Immuable législateur d’imaginaire
Impénitent faussaire de solitude.
Ce que nous vivons est lu toujours à l’envers
Par des roses remords de paradis.
(p. 34-35)
Inversion, fulgurance, hermétisme déroutent et fascinent en profondeur le lecteur. Ils se retrouvent en apothéose dans le long poème clausulaire Le Chant perdu d’Arion qui, faisant discrètement référence à Lesbos, l’île originelle de Strastis Pascalis, incruste en son cœur des bribes de vers en graphie italique :
Vie sans idéaux
Idéale
Rien que la vie — toute simple
Mort- vivant
Aède sans langue
Aimé amèrement
Par un dauphin
Contemplant la mer de sa fuite
Du vertige désert
Impitoyable contemplateur
Traces de toi
Frissons d’une fugitive
Rafale
Clefs d’une musique en sourdine
Sur des cordes de remords
Traces de moi
Pieds humides sur la pierre
Traces de pas sur l’eau
Ce que je bâtis devient tombeau
Ce que je détruis fleurit sans scrupules
(p.70-71)
Cependant, en dépit de l’« aède sans langue », l’oxymore du « mort-vivant », enrichi de l’antithèse architecturale entre « bâtir » et « détruire » ne manque pas de faire émerger finalement un poème « tombeau » dont le chant tisse ses notes « en sourdine » mais avec un bel effet d’envoûtement.
Sous les fulgurances hermétiques se décèle en effet le charme incandescent d’une voix lyrique s’affirmant comme telle tout en luttant bien sûr contre les facilités complaisantes et « les embêtements bleuâtres du lyrisme poitrinaire » fustigés par Flaubert. Dans Idiolecte, le charme se fait explosif, émanant d’une brièveté pour le moins percutante qui exalte les effets conjugués de l’oxymore, de la polysémie et de la personnification :
Je parlerai d’une voix de silencieux
En pressant la détente
Sur la tempe du silence
(p.55)
Dans Restauration soudaine se relèvent d’autres traces d’incandescence sidérante :
(…)
Par une séisme de volupté –
Tempête dans un palmier !
Respiration de ruines !
Joie profonde et funèbre acquise dans ces maisons jaunes
Ces ruelles tortueuses brûlées par le dépeuplement –
Par une fissure est apparue toute la mort
Avec des frontons d’oiseaux des oliveraies de paradis
Et l’amour presque rien
Goutte infime
Devant cette brise qui promettait
Des mers entières d’avenir immortel
Comme un passé.
(p. 36)
Le lyrisme de Stratis Pascalis n’exerce-t-il pas son charme puissamment pictural et musical en franchissant ses limites spatiales voire insulaires pour accéder à une vibration universelle ? Oubliant d’être grecque, de n’être que grecque, de n’être que « pléonasme » originel et indubitable, sa poésie cherche l’oubli célébré par Bernard Noël, l’oubli nécessaire et vital dont elle émerge et qu’elle aspire à « ramener comme un nageur ramènerait la mer ».
Ainsi, en guise d’ « épilogue secret », entre l’élégie d’une « note en bas de page » et le « badinage » qui oppose vie et mort, entre « fragments bibliques » et « parasites métaphysiques », cette voix de poésie propose tant ses inflexions personnelles que ses modulations universelles, se dévoilant à la fois comme « balbutiement voluptueux », « blessure suprême », fanfare secrète », et « langue de cri », dans une « valse » de mots et de vers « dont seule subsiste la musique ». Telle est la fécondité prodigieuse de l’oubli : la mer s’approche grâce au poète nageur dont les mots éblouissent notre page de silence.