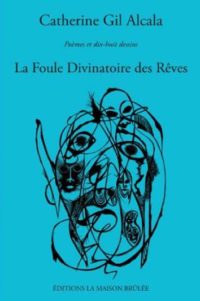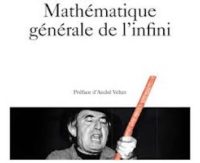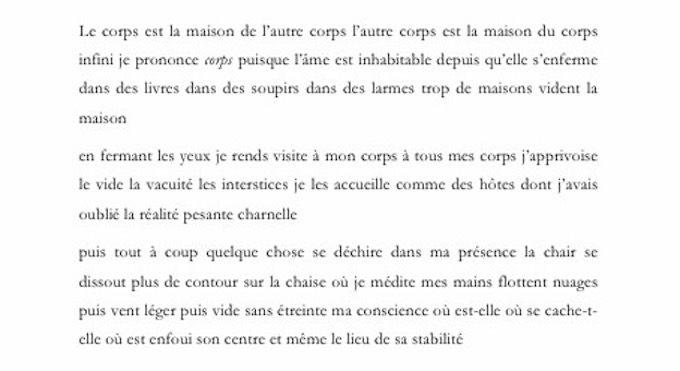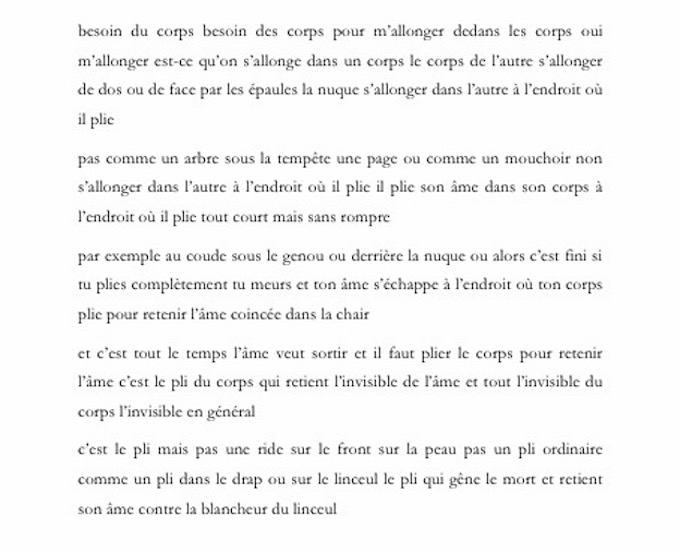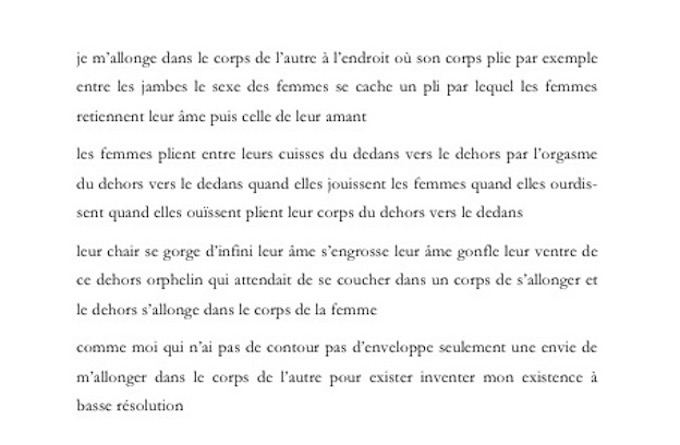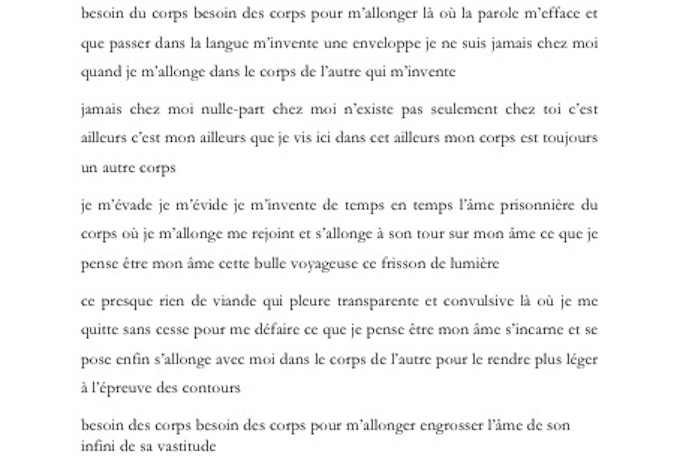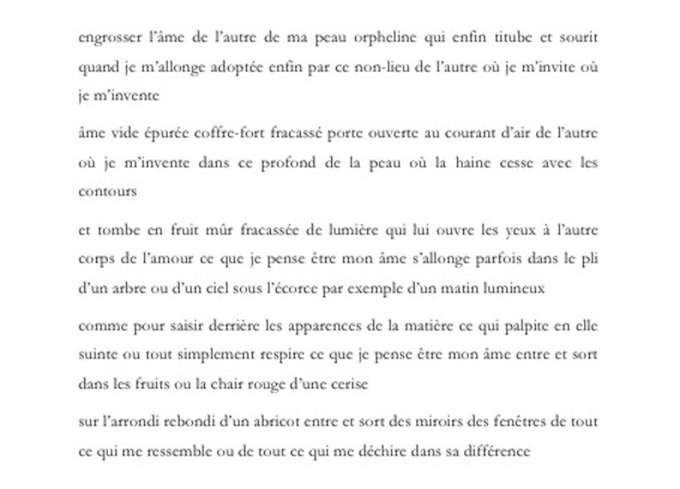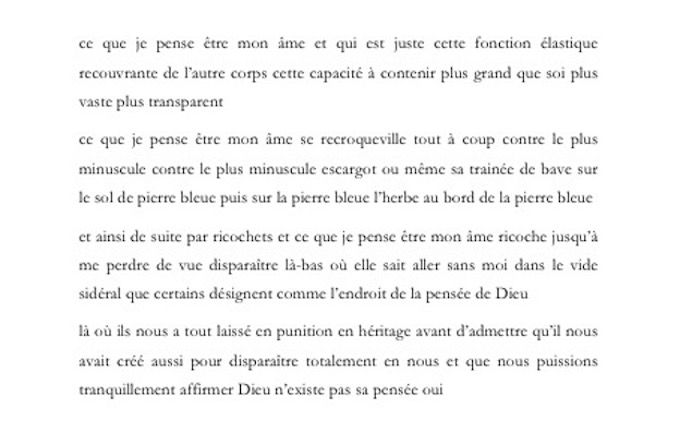À DEUX MAINS, DEMAIN
Perdre peu à peu le contrôle
Jusqu’à ce que je t’aie perdue
Avec le contrôle
Mais je me refais bien
Comme ce cri tu te souviens
Qui montait de l’estuaire
Répercuté sur l’acier rouillé des grues
Des monte-charges
Des engins de levage
Comme nous sommes confondants
Et confondus tout à la fois
Et contents
La volière a pris le large
Nous, le chagrin
Le vent est en panne sur la presqu’île
Alors il se fâche et râle
Nous rions de bon cœur
J’aimais cette odeur de ta peau
Qui demeurait longtemps
Sur la mienne
J’aurais dû alors
Le savoir
Mais en ce temps là je croyais tout savoir
Ça nous a perdus
Même pas mal
Même pas grave
Nous mourrons quand même seuls
Célébrant la vie
La beauté du monde
Au creux de tes paumes
Celle de ton visage,
De tes doigts sur mes doigts
De tes doigts dans mes doigts
De mes doigts dans les tiens
Et nos paumes confondues
Qui fleurissent
Qui bourgeonnent
Qui s’épicent
Qui papillonnent
Qui s’éclipsent
Face à la représentation
Des divinités aux mille bras
Dans un pépiement d’asphodèles.
Il y a ceux qui ploient sous le poids du destin, et ceux qui le bravent, le destin.
C’est un monde peuplé de signes.
Un monde de gestes : certains le bravent, d’autres croulent sous son empire.
Un monde de gestes, un monde de signes. Vocabulaire de la rhétorique, de la peinture, de la danse, de la scénographie bien sûr, de la musique, de plus…
Allégories, oxymores, métaphores, métonymies, la langue des signes, et celle des cygnes. L’illustratif, le démonstratif. Le soulignement, le sur-lignage. On y danse la valse-hésitation, la valse de Vienne, le sombre tango, reggae et bourrée, hip hop, tamouré et catastrophe.
On y cache sa pensée. On s’y contredit, en gants blancs dans la nuit.
C’est un monde que ce peuple-là, on y trouve tout le monde, mais on se croit contraint de devoir chercher chacun.
On entrevoit les dépendances.
On a les extrémités qu’on peut
Qu’on ait le bras long ou pas
Des doigts de toutes factures, de toutes manières, de toutes façons, bagués, manucurés, déformés, difformes ou comme des os, rongés.
Des paumes particulières, à orientation variable, et variée, pleines de courants d’air, de trésors dissimulés, moufles ou mitaines, ou l’air du large.
Maintes fois j’ai attendu, applaudissant, à tout rompre, demain, ce demain tant guetté, le tant attendu. Et bien, ce n’est pas bien malin de rompre demain, fut-ce en applaudissant, ou alors tu n’en attends plus rien, de demain. Et demain se met donc le doigt dans l’œil, et passe, sans même prévenir, sans même un signe. Et le temps est déconfit, il lui manque depuis toujours quelque chose de constitutif de son être : demain !
Qui n’écrit plus, non plus : abolie, la plume ! Qui ne sait plus comment se maintenir.
Et dans ce siècle à mains, l’écriture du corps, c’est la leur. Puisqu’elles sont bien en possession des cartes : carreau, cœur, trèfle, pic. Dans le désordre, et panachées. Poker menteur. Je passe la main, celle de dieu, celle de diable, d’Orlac. Celles de Victor Jara, coupées au ras des poignets :« Et bien joue et chante à présent… ». Et il chante à voix nue. Même à mains nues. À mains dites. À mains coupées. En dépit des doutes. En dépit des dires. Et le peuple se rassemble et se prend la main. Et toi, dorénavant, qu’as-tu maintenu donc ? Rien d’autre qu’une ligne de vie, brouillée. Qu’une ligne de chagrin ? Alors te reviennent du plus loin que l’enfance, les mains oiseaux, qui volent seules, telles les mains du manchot qui a encore mal à sa main, absentée depuis quand ? Main des contours. De l’amour. Manomètres. Blaise, sommes-nous loin de Montmartre ?
Non, je n’ai rien vu, je vous dis. Rien fait qu’entrevoir, de mon débarcadère bleu, (je n’y suis pour rien), seul toujours et sans cesse la main mise à ma solitude, ma pâte. Et la solitude renâcle.
« Je ne te crois pas, je ne vous crois pas, mon petit doigt me le dit, et mes mains aussi, qui tremblent : j’ai perdu le sens du temps, mais le temps n’a pas de sens ! Le temps est insensé »
Ayant fait lien par leurs deux pouces, ombre chinoise, elles battent des ailes et finissent par s’envoler donc,
Malgré l’horreur, malgré leur peine. De l’aigle à l’étourneau. Du busard de plomb au pigeon perdu parmi les coquelicots. Elles se sont faites oiseaux, vraiment, ne se feront plus avoir par l’appeau, Puisqu’ à présent elles sont le ciel, et que le ciel ne se rend pas, jamais. Paumes et doigts. Ciel et terre. Paradis et enfer. Mains soleil. Qui volent haut. Et signent. À voix blanche. À mains nues. À mains pleines.
Vous l’aurez compris : je me régule comme je peux.
Je ne suis pas une catapulte, juste un épieu.
Un épi ?
La main est au geste ce que l’appeau est à l’oiseau. La vitre au carreau. Quand les fils de la vierge s’enroulent sur les doigts de ciel. Il manque juste la fleur de trop. Un bruissement de feuilles. Une brusque inclinaison de la lumière tombée. Les mains qui se dérobent. Je cherchais dans le ciel quelle question ? Dont j’avais depuis longtemps la réponse. Incandescente. Qui me brûlait l’intérieur de l’âme. De la viande. Depuis si longtemps. Cherchant au loin des repos guerriers, des relâches d’âme, des larmes non retenues, absorbées par le sable. Consentant. Ma mie, te souvient-il de la marée montante, l’hiver, le sinagot éventré, par notre faute, notre imprudence. Il pleuvait. J’avais les mains en sang. Et ma caresse sur tes lèvres y a laissé du sang. La faute à mes mains. À la pluie. À l’hiver. Au vent. A la marée qui descend, au même cauchemar d’enfant, quand le bateau bleu et blanc où je suis seul fout le camp vers le large, l’horizon désert, et je n’ai pas peur, passé au-delà de la peur avec l’image de ma main gauche sur le carreau glacé poisseux de buée, c’était en 1956, ma main s’est refermée sur elle-même, je lui ai trouvé un refuge près de mon cou et n’ai plus bougé pour que personne ne puisse croire que je ne pleurais pas avec les autres. Et puis le printemps, toutes ses dents, les quatre dents du trèfle que ma main fauche à foison et je me redresse dans le soleil, ma main en visière, le cœur en bandoulière, affectant une ou deux de ces poses qu’on croit réservées aux cabots, cabotins. Mon teint est-il au mieux ? Ma vie vous fait-elle envie ? Voyez, je la partage bien volontiers. Donnez-moi la main, je vous tends la mienne, celle du cœur bien sûr, le sentez-vous, bien battant, bien à vif, bien au pic de cette émotion venue de votre main dans la mienne, qui que vous soyez, ou de la mienne dans la vôtre. Je sais quels frissons je suis capable de laisser se propager de mes mains, douces comme la crème, qui n’ont jamais travaillé, non, pensez donc, juste joui, à tout propos, toute occasion, et quand le frisson n’est pas au rendez-vous, je le convoque toujours, puisque je suis le maître, la main de mon destin. Plus besoin de rire. Tu n’avais qu’à reprendre le cours de ton cours. L’ennemi rit. La mésange pâlit. Tu sauras bien retrouver ton chemin, mais ton âme ? Alors tu abattras les cartes sur la table de bois du bistro de la dernière chance. Il y aura un nain, et il y aura une dame. Nous, nous serons autour, fous, incertains. Identités douteuses et objectifs dépareillés. La nuit aura joué. Je n’aurais pas encore perdu. L’aurore s’occupe des couplets. Le refrain est annoncé, vendu d’avance : dis, quand reviendras-tu ? Et cette plénitude de savoir au moment de comprendre que ça ne se produira jamais. J’aimais les élégantes et ignorais les parjures. La calotte du prélat est un souvenir sur la plaine quand les cavaliers d’un coup de sabre la lui ont fait voler par-delà les dunes de sable, les lunes de marbre. Comme il était déjà tôt j’ai refermé la fenêtre. Tes mains étaient ouvertes vers le ciel, mais ton cœur fermé comme celui d’une demoiselle qui calcule à tout moment ses chances d’être arrimée ou répudiée. Alors le plus souvent, elle se répudie d’elle-même. Ne te reste plus que le souvenir de l’odeur de ses mains, cette fragrance entre trois lignes, identité érotique dont elle prétend n’avoir donné qu’à toi seul le secret, beau sire, bon sire, escroc, parjure, duelliste, corrompu ! Qui es-tu ? de quel bois te chauffes-tu ? Il y en a qui ne restent qu’indécis et il fait froid par là-bas…
Un excès de main peut faire taire le silence
Le parapluie de ta main
Sur la pure faconde du jour
Elles ont fait le tour
Elles ont fait le jour
Elles ont fait l’amour
Mes filles fleurs
Mes filles femmes
Elles ont tout donné
Sans rien garder dans les paumes
Elles ont cousu les bouches
Des menteurs des errants des malheureux
Le bâillon pour les traîtres
Recueilli le sang et les larmes
Apaisé l’enfant
Le vieillard
Et l’aveugle
D’une simple imposition
Non rémunérée
Mes mains ne sont pas dans l’annuaire
Ton visage non plus
Et pourtant ton visage sans mes mains…
Et pourtant mes mains sans ton visage…
Main veux-tu, main crois-tu ? Main menteuse, ébouriffée dans tes cheveux défaits. Main songe, main conte, maintes fois repris au début, au commencement, il était une fois, bien avant les mots était la main. Ou plutôt les mains. Depuis elles se sont défaites, séparées, chacune toute à sa liberté revendiquée… qui n’est que de chercher une autre main ailleurs, à serrer, à caresser, à implorer, pleurant et sanglotant et revenant sans cesse à la même chanson : « donne-moi ta main et prends la mienne… » Et pourtant, nos mains le savent bien, il n’est jamais fini le temps de l’école… Quand l’intelligence vient aux mains, les maîtres du monde ont du souci à se faire. Je ne sais pas si la terre est ronde mais je sais que ta main est blonde et mon désir comme une mappemonde où ta main pointe un à un tous les points de convergence, tous ceux de la divergence, terrible engeance. Les mains visières et les mains parasols, avec un grand mouchoir à carreaux ou pas. Les mains qui te sonnent, celles qui te somment. Celles qui passent en courant d’air et celles qui s’attardent, derrière la porte de derrière. Les mains de l’antichambre et celles de la chambre, les mains qui trient, qui plient, qui creusent, qui reviennent pour mieux repartir et puis s’en revenir sur la pointe des pieds, sur les galets rompus par nos pas répétés. Où est-elle cette main de Dieu, et cette colombe qui un beau jour, un beau matin a fui sa paume ? je me demande ce qu’il restera de ce ballet des mains, tous doigts confondus, toutes paumes tour à tour ouvertes en grand ou fermées en petit, tout petit. Les mains sont une vue de l’esprit, une métaphore de ses ébauches de phrases contrites, ou bien la jouissance pure de son envol par-delà les terres arides et les contrées du vide. Nous sommes les lieutenants des mains, nous en sommes les domestiques, elles qui ont pris à deux mains tout le cœur qui restait, à la fin du banquet, et qui serrent, qui serrent…
Mains baladeuses, un monde de signes qui se dessinent dans l’espace en trois dimensions, voire quatre, abscisses, ordonnées, temps, espace, éternité fugace de l’instant qui se dit sans un mot, à toute main.
Bénédiction, couper le pain, charia, couper la main, couper la tête, rentrer les foins, caresse de la main qui caresse la caresse de l’autre main qui se tend, accueille, se referme sur la première sans chercher à l’emprisonner pour autant, mains de l’amour, toujours séparées, à jamais, toujours néanmoins cherchant à se rejoindre, à se relier, se fondre, ne faire qu’un, qu’une, que deux du même, touchant, palpant l’éternité demain et toujours maintenir les jeux qui ne sont pas de vilains, mais du destin les signes, destin qui s’accomplit et se révèle par l’ingéniosité aimante des mains qui ont le choix sans cesse d’aimer ou de haïr, de délaisser ou d’accomplir, jeux de mains, A Morra, main tenue, basse continue… Lorsque tu te réveilles lourd de sens, décalqué dans une sorte d’image éternelle de ce que tu aurais pu être, et que tu ne sais pas à qui donner cette chance.
Monde des signes, qui soulignent le propos, même s’il est hors de propos, à cet instant, ils le montrent, désignent, ou bien en tiennent lieu quand l’oreille est sourde et la bouche muette. On s’en remet alors aux mains, aux signes, aux poignets, aux paumes, aux doigts. Il ne s’agit plus alors de souligner, de contredire, ou d’infirmer, mais bien de se substituer.
La main se dresse et dit : « Charmée, vraiment, charmée… »
Mes mains ne sont pas dans l’annuaire
Ton visage non plus
Et pourtant ton visage sans mes mains…
Et pourtant mes mains sans ton visage…
Tu le savais pourtant :
De demain à maintenant
On remonte le temps
À mains nues
Et sans assurance, ni casque, ni corde, ni képi.
À demain.
© dominique ottavi