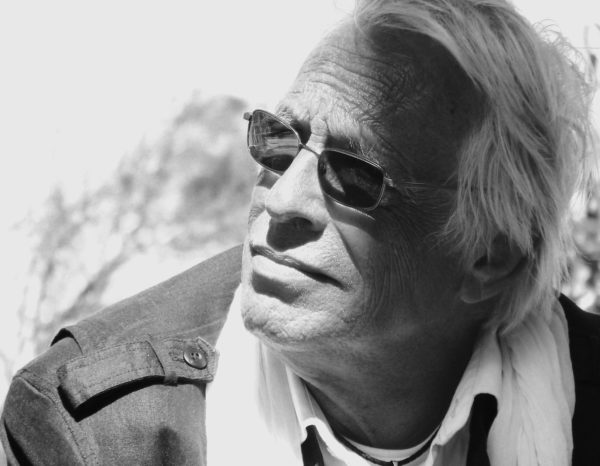Paroles de poètes, poètes sur parole de Jean-Luc Pouliquen et Philippe Tancelin
Cette critique, une des toutes premières de notre collaboratrice Ghislaine Lejard, est parue dans le numéro 74 de Recours au poème, en novembre 2013.
∗∗∗
Jean-Luc Pouliquen et Philippe Tancelin échangent, au centre de la discussion entre le poète et le philosophe-poète, la Poésie ; ce qu’elle est et ce qu’on a fait d’elle en France plus particulièrement.
Alors que sur notre territoire, elle ne représente que 1% des ventes, Jean-Luc Pouliquen rappelle qu’elle remplit des stades en Amérique Latine et en Corée du Sud, nous semblons l’avoir oublié en France, mais la poésie est populaire : « plus que tout autre expression car elle est au centre même du vivant en ce qu’il espère encore quand tout espoir l’a quitté et qu’il ne reste plus que la magie brûlante des mots ». Il semble qu’il y ait eu un certain déficit ; la poésie est devenue trop institutionnelle et depuis le festival d’Avignon dont René Char a été à l’origine avec Jean Vilar, un certain esprit a disparu. Jean-Luc Pouliquen accuse les politiques publiques d’avoir enfermé la poésie car on ne peut baliser le territoire poétique : « Elles( les maisons de la poésie) créent des sanctuaires dans lesquels rien de nouveau ne peut éclore. »( p.18). les poètes peuvent-ils s’épanouir à l’intérieur d’institutions ad hoc, maisons de la poésie, résidences, labels ?…Une phrase fait mouche et illustre son propos : « Tu imagines Rimbaud venir faire une lecture à la maison de la poésie de Charleville ou y passer quelques semaines en résidence… »
On l’aura compris, pour eux, les chemins de la poésie, les rencontres les plus marquantes, se trouvent hors des sentiers battus, la poésie ne peut être institutionnalisée ! La poésie est et doit rester libre, rebelle, hors cadre ! Mais le politique veut toujours la cadrer, la recadrer, l’encadrer car depuis toujours, il s’en méfie…
La poésie pour : « Vivre , choisir, s’engager », les interlocuteurs mettent très vite l’accent sur la notion d’engagement qui est au cœur de l’écriture poétique ; un engagement indissociable du vécu. Être poète c’est déjà être engagé, c’est affronter une économie qui envahit tout et tue le plus souvent l’esprit créatif, vouloir être un créateur, c’est donc résister :
L’engagement poétique aux côtés des sans terre et des sans droits devient l’occasion pour le poète de replacer la question de sa création au cœur de l’Histoire. Ph.Tancelin (p.32)
Engagement et émotion ne s’opposent pas, Pourquoi avoir voulu les opposer ?
Depuis quelques décennies, trop de poètes idéologues ont rejeté l’émotion que Reverdy considérait comme nécessaire à la création poétique : « L’émotion doit rester première(…) c’est elle qui va enclencher le processus de création. » J .L Pouliquen( p.33 ). C’est cet esprit- là qui anima les poètes de l’école de Rochefort.
Le poète est aussi témoin dans une dimension collective, hélas cette dimension collective de la vie poétique et artistique manque à notre époque depuis les années 80. Le collectif « Change » et sa revue fondée par Jean-Pierre Faye est sans doute l’une des dernières traces de cet esprit collectif qui animait les Décades de Pontigny ou les colloques de Cerisy.
Il faut descendre la poésie dans la rue, partager autour de l’œuvre sans finalité sociale. C’est ce que Marc Delouze et Danièle Fournier ont tenté avec les Parvis poétiques.
Le poète est témoin, mais il est aussi médiateur, à partir de son expérience intime, singulière il rejoint l’autre dans son humaine condition. La voix ou voie poétique est un moyen d’appréhender le monde, de se réapproprier son expérience par les mots ; c’est ce que tentent de faire les ateliers de poésie ; mais « les chemins actuels de la parole poétique » se sont comme la société française complexifiés. Le face à face direct et spontané avec la poésie se fait dans des espaces délimités et par l’intermédiaire de structures, or la poésie est une parole nomade, d’où : « Le risque que représente pour le poème l’atelier sédentaire d’écriture… », n’oublions pas qu’une institutionnalisation du poétique tue le poème !
« Plus de poètes-paysans ou de poètes ouvriers mais des poètes-animateurs d’ateliers d’écriture dans un réseau de médiathèques qui recouvre l’ensemble du territoire. » Mais attention : « Il n’y a pas de formation poétique ni d’enseignement de la transgression,car l’état poétique est transgressif. » Ph. Tancelin ( p.75 )
Gardons ce qui était de règle, la séparation des genres : « C’est ainsi que cela fonctionnait auparavant, les poètes avaient une activité professionnelle et à côté la poésie dont ils pouvaient s’occuper en toute liberté et indépendance. J’ai l’impression qu’elle ne s’en est pas trop mal portée. » J.L Pouliquen (p.76). Il faut vivre en poésie et non vivre de poésie. Elle ne sera jamais marchandise car elle n’est pas objet comme la peinture ou la sculpture. Elle est comme le disait la revue Fontaine (N° mars-avril 1942) « un exercice spirituel ».
On demande de plus en plus souvent au poète un partage à voix haute, renouant avec la tradition. Mais on demande dans des lectures publiques, ce que l’on demandait au comédien, c’est un exercice difficile pour le poète qui a souvent l’impression de se livrer à un exercice d’impudeur, d’exhibitionnisme voire de narcissisme. Et pourtant, pour s’accomplir la poésie a besoin du couple écriture – oralité :
Écouter un poème, « un vrai poème », c’est faire l’expérience du caractère sacré du langage qui a enfermé dans ses mots les vibrations les plus secrètes et les plus profondes du cosmos et de l’être. » J.L Pouliquen (p.97)
Le poème pour dire le réel, c’est aussi une tendance actuelle, mais de quelle réalité s’agit-il ? Le poète certes ressent cet appel à dire UN réel, mais non pas LE réel ; car comme le dit si poétiquement Jean-Luc Pouliquen, pour atteindre ce réel, « il faudra traverser le miroir » et il rappelle ce que lui disait Hélène Cadou, le réel entrevu n’est que l’envers d’une tapisserie, pour la découvrir, il faudra atteindre l’autre rive… Le moteur de la création poétique, naît de cet écart entre :
ce que le poète entrevoit et ce qui lui est permis de vivre véritablement. J.L Pouliquen (p. 101 )
Qui mieux que le poète est en mesure de parler de la poésie, les poètes ne doivent pas se laisser déposséder, ils ne doivent pas oublier qu’ils ont aussi charge de faire vivre la poésie des autres. « Le poète est celui qui n’oublie ni les vivants ni les morts. » R G Cadou. Qui mieux qu’un poète peut écrire sur un autre poète, rédiger des préfaces, commentaires, notes qui ouvrent les chemins de la poésie. Pour exister, elle a aussi besoin d’autres vecteurs , et d’être relayée par les médias, pas seulement les revues spécialisées , elle devrait être plus présente dans les journaux comme c’est le cas dans les pays de l’Est ou les pays d’Orient, présente aussi dans de grandes manifestations populaires comme en Amérique Latine…
Alors, pour que vive la parole poétique, les auteurs de cet ouvrage, souhaitent qu’il y ait une « suite à cette parole », Philippe Tancelin à la fin de l’ouvrage appelle les lectrices et les lecteurs à prolonger le dialogue commencé par lui et Jean-Luc Pouliquen, il faut faire connaître cet échange. Le lire, c’est s’interroger sur la place de la poésie et des poètes en France, en ce début du XXIe siècle ; c’est découvrir que l’artiste, le philosophe, le poète sont au service d’une vérité qui les dépasse. Un riche dialogue qui illustre bien cette pensée de René Char :
Qui vient au monde pour ne rien troubler, ne mérite ni égard, ni patience.
Philippe Tancelin et Jean-Luc Pouliquen troubleront certains poètes, certaines instances car ils interpellent, secouent pour réveiller la belle endormie qu’est parfois la poésie française contemporaine qui se contente beaucoup trop de survivre grâce à des structures institutionnelles.
Souhaitons que l’échange se prolonge et que beaucoup répondent à l’appel de Phippe Tancelin :
par les moyens techniques modernes (internet en particulier), selon les modalités à inventer dans l’esprit d’une conversation internationale, transculturelle sur les thèmes de prédilection du peuple-poème dans l’histoire contemporaine. (p.117)