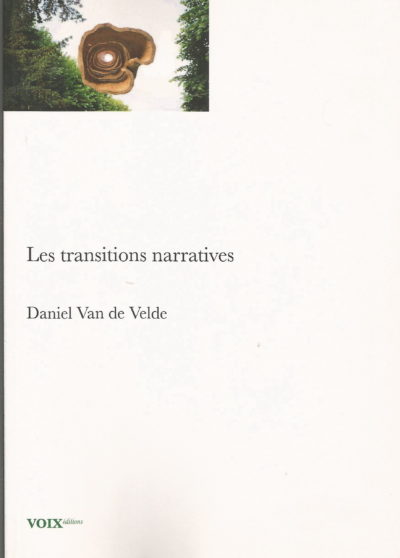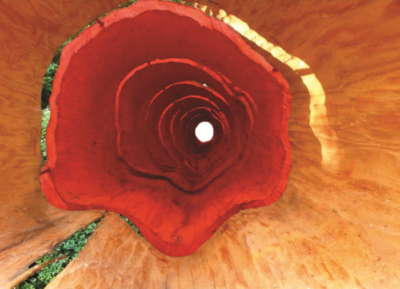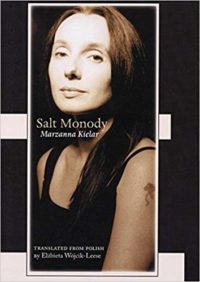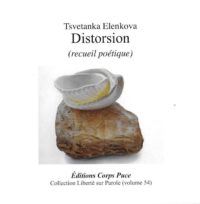La Part féminine des arbres (extraits)
A travers ce dialogue, extrait d'un ouvrage commun inédit confié à Recours au Poème, c'est un double portrait amoureux, aux infinies résonances cosmiques, que nous offrent Alice Passy et Daniel Van de Velde - en miroir l'un de l'autre. Voici ce qu'en disait l'artiste :
Ce recueil, rebonds d'un texte à l'autre, Répons (au sens que Pierre Boulez donne à ce terme) transfigure l'amour (pour faire simple de Pétrarque à André Breton) pour lui donner une orientation anthropocénique. C'est-à-dire s'aimer malgré le tout d'une totalité terrestre et humaine en détresse. Apprendre et goûter la vie malgré les délabrements de nos existences en mal de redéfinition et donner une teneur cosmique à chacune de nos pulsations quand nous nous donnons l'un à l'autre.

Vaertigo , Daniel Van de Velde
1
Les cernes des arbres s’estompent
Dans une valse lente
Je cèderai à la fascination
Derrière mes vitres étanches
Je croyais résister à la puissance de la vague
Mais tout vole en éclats
En reddition devant l’indigo
Noyée dans la gravité de ta voix,
Je succombe à l’attraction de ta forêt profonde.
Un sentiment de blancheur.
Brumes, écumes et volupté.
Quelque chose en lui n’est définitivement plus de l’ordre de la nuit.
2
Tu es le nombre d’or du désir
La résurgence jaillie de mon rocher
Le chêne sous lequel j’aimerais méditer
La voix profonde de la montagne
Tu es ma gravité
Mes premiers souvenirs
S’inscrivent dans l’argile
Je les pétris longuement
Et modèle une histoire à venir
J’inspire à déployer mes ailes
Aveugle au vide
Sourde aux réticences
Absente au visage sublime
Dans le brouillard qui m’envahit
Je fais le pari de la vie.
De retour du lac de Sainte-Croix,
La route bordée d’arbres plus élégants les uns que les autres
Je transborde continuellement ton élégance, ta beauté d’être,
En moi et hors de moi,
Comme une promesse de jouissance…
7
Tu m’apparais comme évidence
A évider les arbres
Comme si toutes les trajectoires tendaient vers toi …
J'aime les terres qui se superposent en nous, les villes, les lieux de rencontre. Mais aussi des lieux sans noms véritables pour que nous ne soyons pas réductibles aux noms que nous portons. Nous faisons alors, tous les deux, partie d'un tout. Tu as tant et tant de fois été face à des matières insécables que je les absorbe, émanant de toi. Je le fais en parlant avec toi, en marchant avec toi. En faisant l'amour avec toi. En laissant une forme particulière de silence nous traverser. Un silence fait de plusieurs expériences, la tienne, la mienne et celle de la terre. Le ciel ici ce soir, n'est pas homogène, c'est un voile. L'univers est vaste, tu es vaste. Je redeviens vaste.
10
Tu me révèles le féminin sacré des arbres
Nouveauté, mon regard sur eux
J’écarquille mes yeux dans la nuit
Pour mieux les discerner
A la lumière faible du croissant de lune
Inouïe ma vie depuis toi.
Elle devient inédite.
L’inconnu comme lien.
13
Je recueille les mots que tu sèmes
Ils germent en moi comme fractales infinies
Et font circuler une sève nouvelle dans tout mon être.
Comme une féminité retrouvée.
Par la force de tous les arbres que nous avons croisés ensemble depuis que nous nous connaissons, je redeviens homme pour toi. Un souffle androgyne opère qui me rend ultrasensible à toutes les formes de particules qui émanent de toi. Je me suis laissé dissoudre par la simplicité primordiale de ton existence. La part féminine des arbres que porte chacune de tes apparitions quand je me retrouve face à toi.
37
Nous avançons à tâtons, explorateurs de bonheur
Je scrute ton visage et ses marques profondes
J’y décèle la lumière, reflet de galaxies lointaines
Une caresse subtile sous la lune éclipsée
Bouleverse le rythme des particules de ma peau
Tu me vois immanence et me rends transcendance
Quand je t’offre un élan de vitalité venu des étoiles
Ensemble, nous devenons les médiateurs du cosmos
Ta présence me révèle ce que ma vie a d’unique.
Tu m'enrichis de tout ce que j'avais oublié de vivre.
Ce que j'aime en toi, je ne l'ai jamais aimé en personne d'autre.