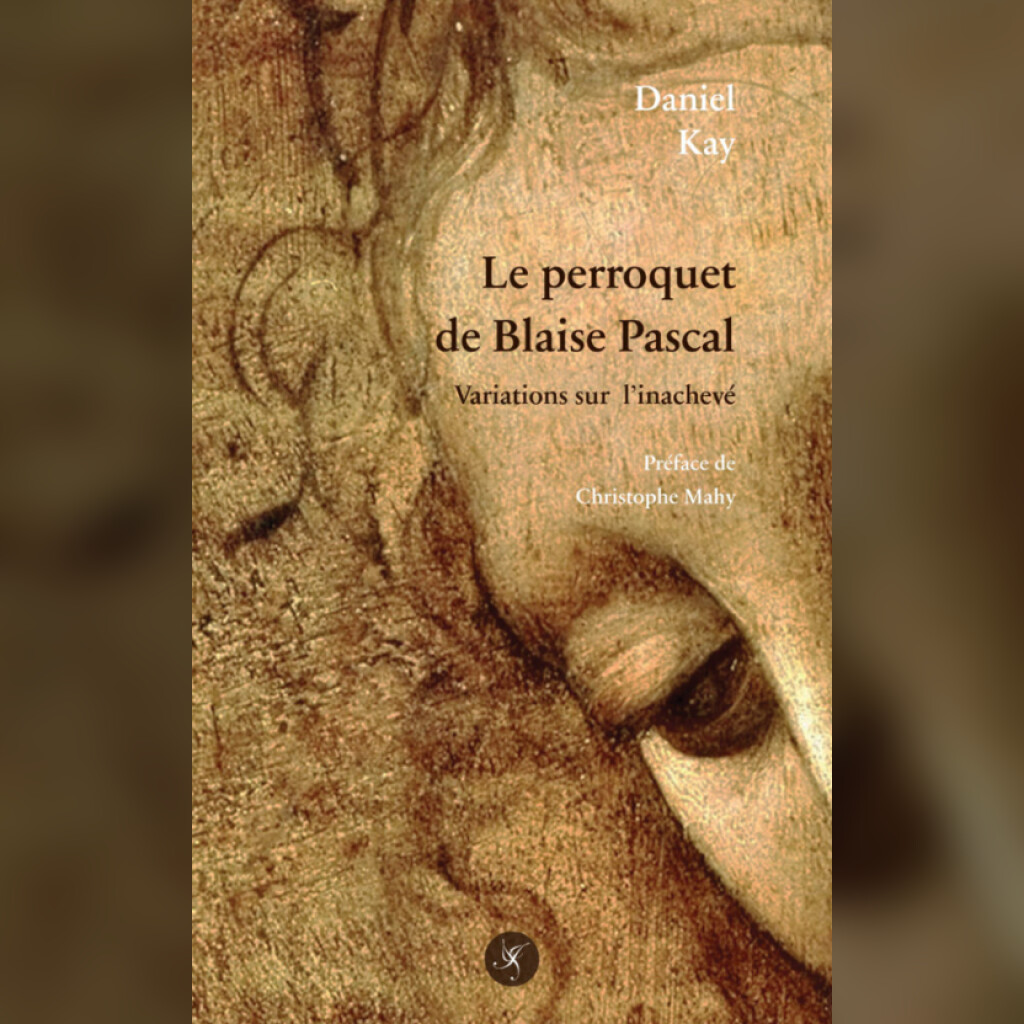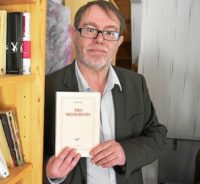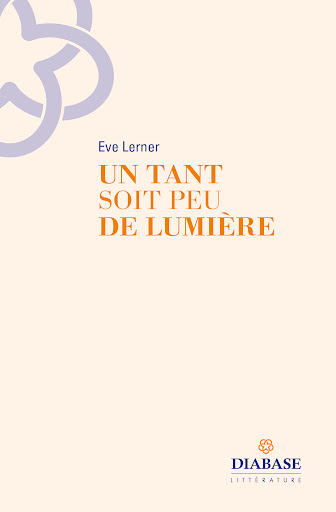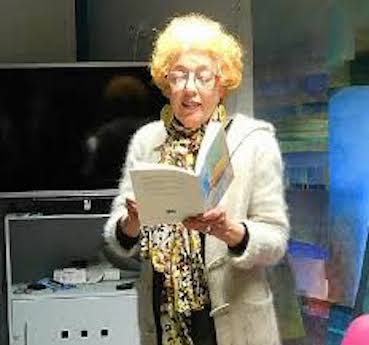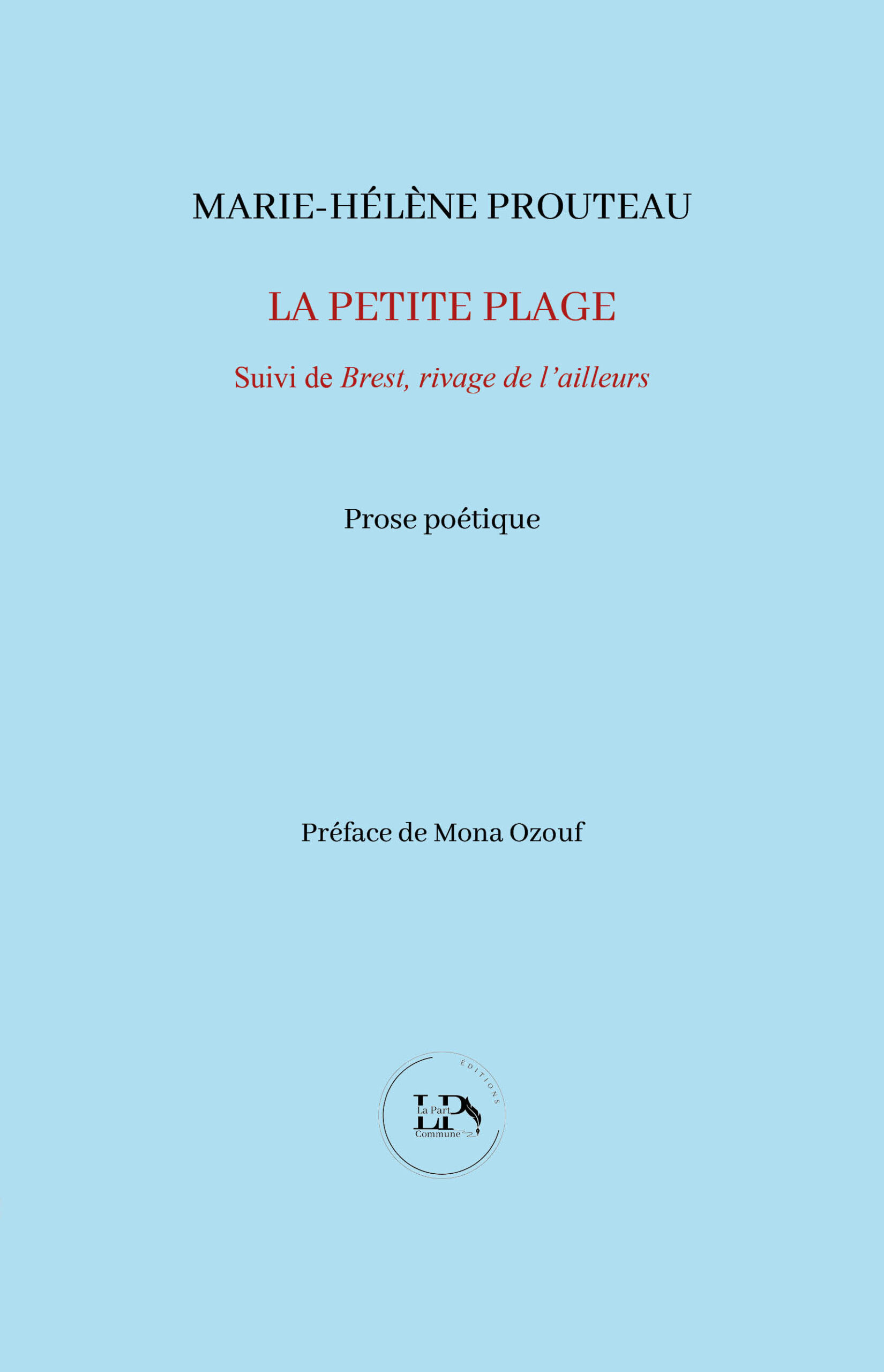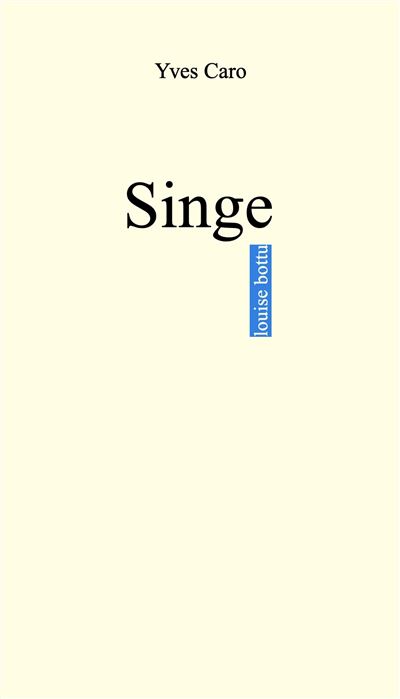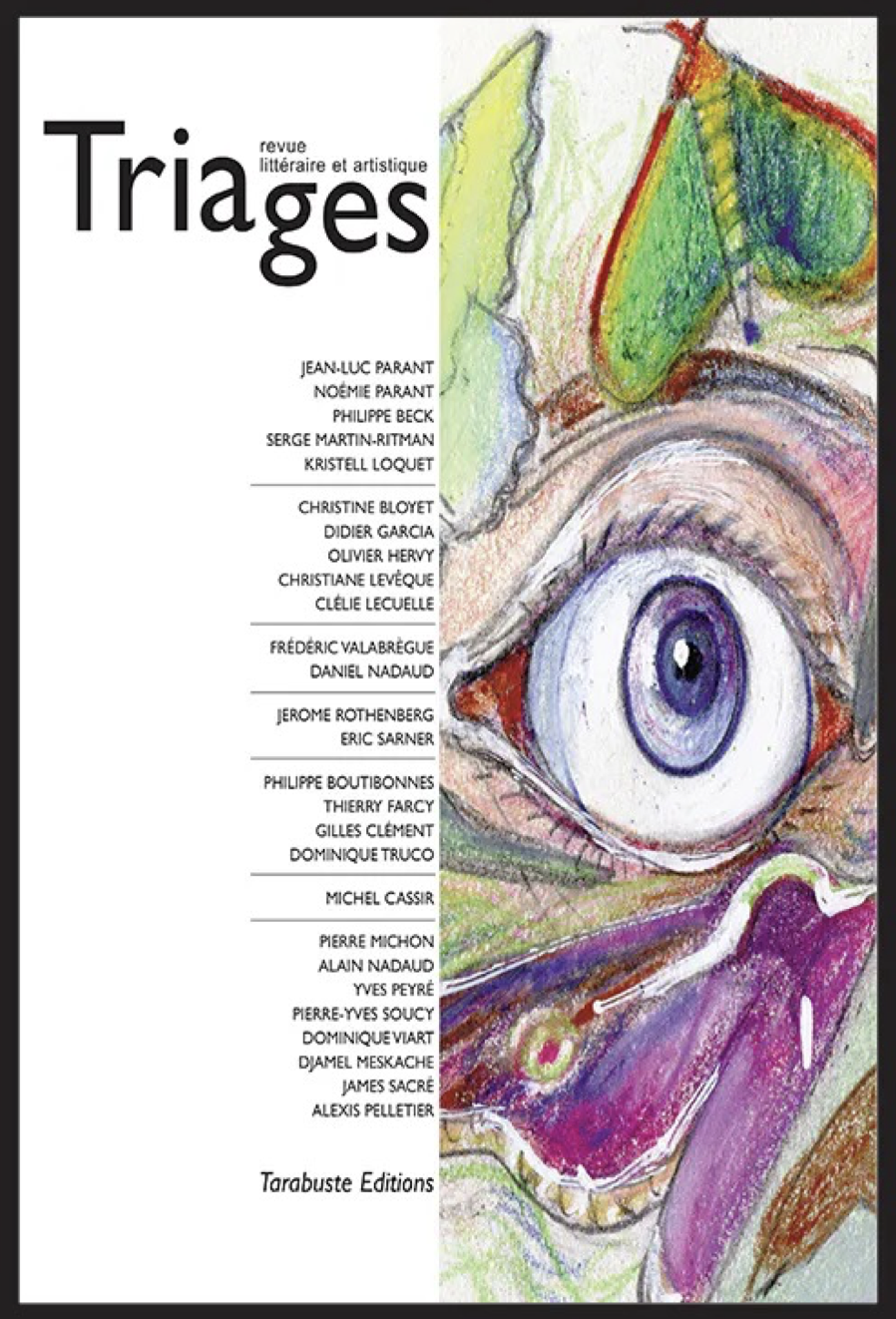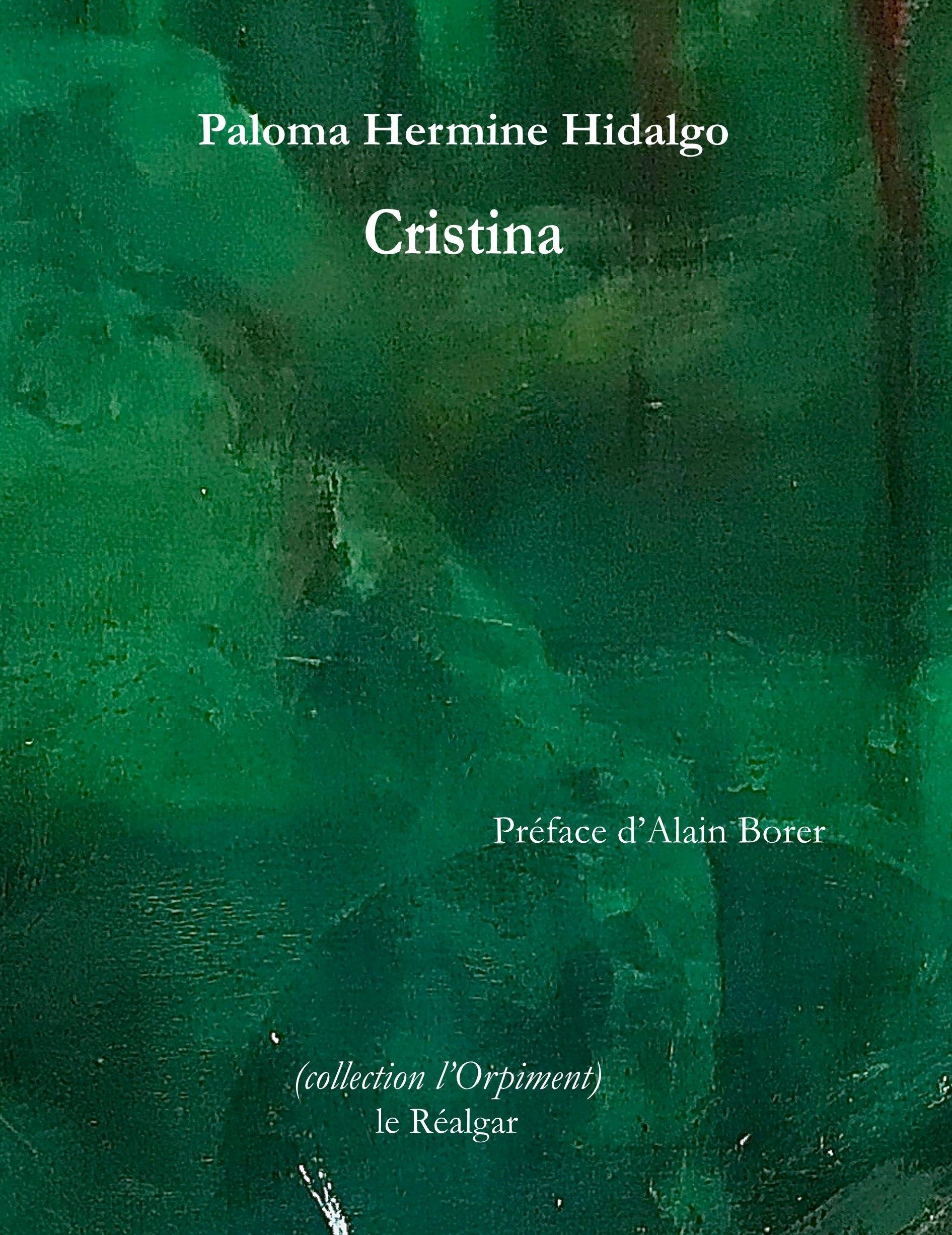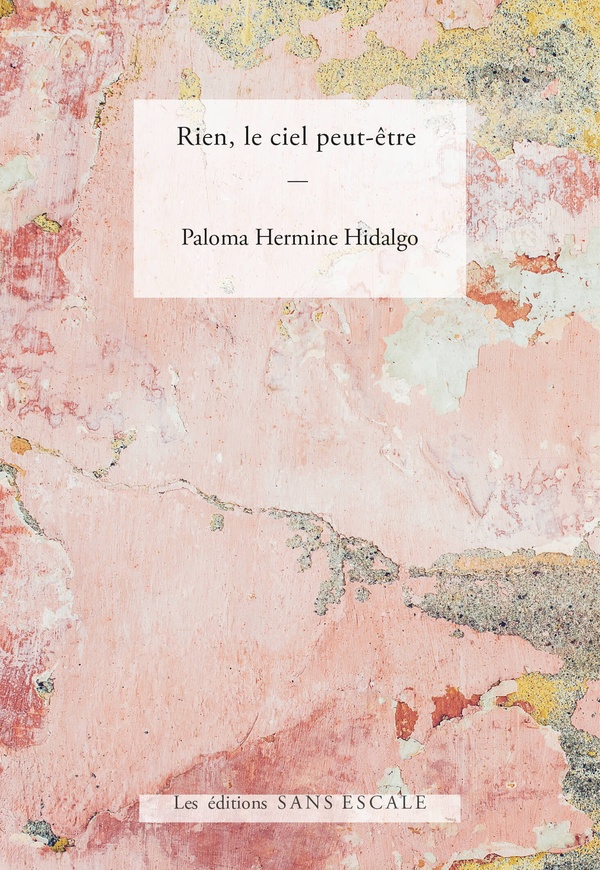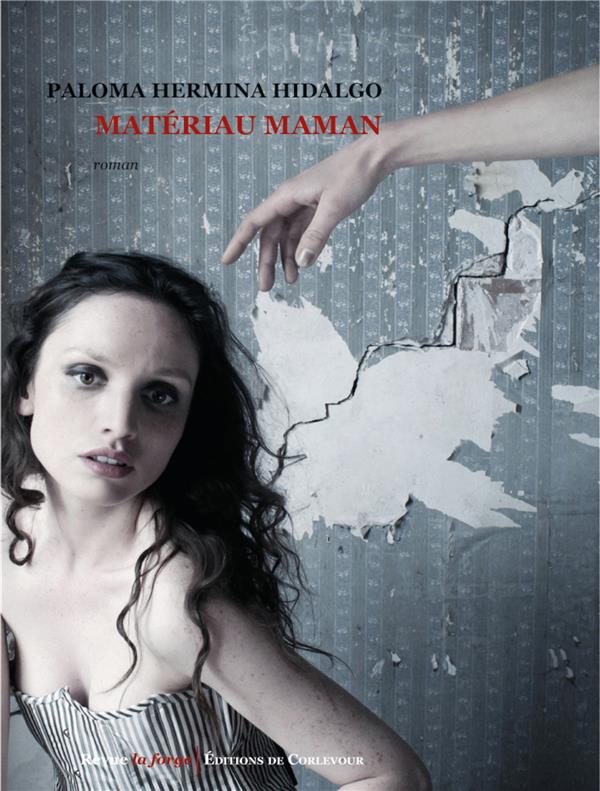Marie Murski, Ailleurs jusqu’à l’aube
Les éditions Les Hommes sans épaules publient l’ensemble des poésies de Marie Murski, poétesse singulière d’origine polonaise qui vit actuellement en Bretagne, et dont l’œuvre d’une grande sensibilité est ici réunie, depuis Pour changer de Clarté, paru en 1977, sous le nom de plume de Marie-José Hamy, suivi par Le Bleu des rois (1983), Si tu rencontres un précipice (1988), La Baigneuse, et enfin Le Grand Imperméable.
Marie Murski a rejoint le comité de rédaction des HSE en 1989, avant de disparaître pendant quatorze ans de la scène littéraire. Elle réapparaît en 2007, reprend son nom de jeune fille, et publiera notamment un récit, Cris dans un jardin. Nous ne reviendrons pas ici sur la violence conjugale subie par Marie Murski, qui est rappelée par Christophe Dauphin dans sa préface. Mais l’enfance traumatisée, « l’enfance à la mine de plomb » est déjà présente dans les recueils qui précèdent chronologiquement la fatale rencontre.
Car la poésie de Marie Murski est un jardin, c’est-à-dire un lieu changeant ou s’expriment toutes les saisons de poésie, un lieu de vie, et un lieu de mort. Je pense en la lisant aux roseraies d’Apollinaire d’Automne malade, où le vent souffle, aux vergers vénéneux, où il a neigé ; chez Marie Murski,
L’automne est en sursis
Lèvres fendues en leur milieu
puis ouvertes en vol d’hirondelles
se parjurent d’onguents cireux
nommés rouge sang dans les couloirs de la mort.
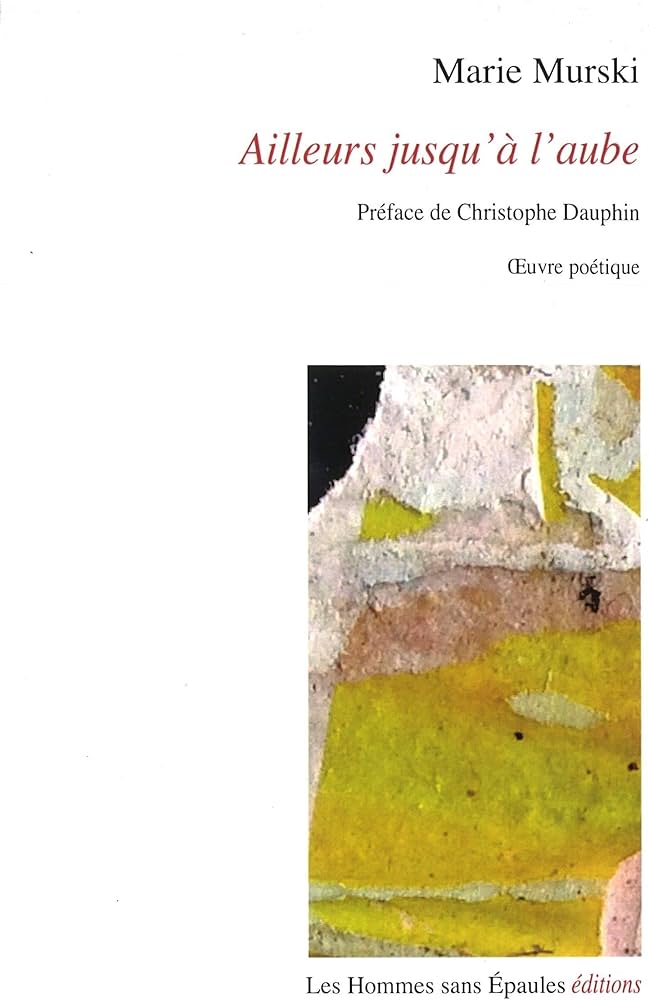
Marie Murski, Ailleurs jusqu’à l’aube, Les hommes sans épaules, 2019, 20 euros.
Le jardin de Marie Marie Murski est un jardin intime où s’épanouissent - et avortent parfois - d’étranges images qui rappellent celles d’André Breton ou de Philippe Soupault. C’est un jardin où se rejoue, se recompose en permanence, un drame personnel. La poète rebat les cartes et remodèle son territoire.
Ce jardin est aussi le lieu où se pressent l’intrusion, où la violence n’est jamais très loin :
Décisive cette main qui déshabille
qui se taille la part du lion
et crachote dans mes crocus
Mais on y trouvera aussi un érotisme floral qui prend le temps de s’épanouir, notamment dans le recueil La Baigneuse :
laisser la légèreté
dans son plaisir
la lenteur du fruit
autour du noyau
La poète nous livre une anatomie intime, à travers les images d’un corps-jardin, qui devient parfois un corps-paysage, et aussi un corps-mémoire :
Certains nuages restent
sous la peau
Mais le jardin de Marie Murski est aussi un laboratoire, un lieu de renaissance et de re-création, dont l’enchantement procède d’une animation virevoltante, parfois éperdue, d’abord parce que c’est un lieu habité de présences, un bestiaire dont la poète entend l’appel ambivalent :
Le rêve a ses raisons
des raisons de loup dans une forêt verteEt si je cours sans cesse
c’est pour passer sans regarder
les petites têtes hilares
qui partout
jaillissent des troncs d’arbres
Des voix tantôt harcelantes, tantôt consolantes.
Inlassablement la poète est
Dragueuse d’infini
porteuse d’eau dans le combat des heures
on ne compte plus ses incarnations, « toupie » (rêve d’un mouvement perpétuel ?), ou lutteuse qui ne souhaite pas « mourir gentiment », et qui oppose à la fixité glaçante de la mort la virtuosité du verbe. Déjà, enfant, elle « tournait à l’envers ». N’est-ce pas la vocation du poète d’aller contre la rotation habituelle du monde ?
Le jardin est juste en-dessous du ciel, comme chez Verlaine le ciel est par-dessus les toits. On lira aussi des poèmes plus contemplatifs comme celui qui est dédié à Hubert Reeves, où la poète « chavire en boule de vertige ». Sage-femme de son métier, Marie Murski accouche aussi les étoiles :
Au-dessus il y a les étoiles
qui sont mes sœurs on le dit et c’est vrai
nous avons le même ventre dur
fécond dans l’éternité
Nous l’avons dit, le jardin de Marie Murski est un jardin violenté, un jardin saccagé, et pourtant, par la puissance du langage, elle fait entendre, dans des poèmes parfois difficiles, une voix dont les échos résonnent longtemps en nous, s’enracinent douloureusement dans la sensibilité du lecteur, y plongent des racines écorchées, à vif, palpitantes.
La poésie a sauvé la vie de Marie Murski, qui ne cesse de « vider ses poches », comme le petit Poucet rêveur de Rimbaud égrenant des vers. Et en effet, l’appel d’un départ se fait entendre souvent :
Partir vraiment
comme un pied qui s’écarte du continent.
Voici pour l’ailleurs.
Et pour terminer, je cite intégralement le magnifique poème qui termine le recueil Si tu rencontres un précipice, où la mort est évoquée dans un élan nuptial :
Qu’elle vienne
au galop comme dans les terres dangereuses
ou patientes comme les filets d’oiseleur,
mais
que son ombrelle ne soit pas tranchante
aux abords de mes yeux
qu’elle sache avec délicatesse
ôter la bulle d’air enroulée à mon doigt
qu’elle m’enserre doucement
dans son simple éclair
Voici pour l’aube.