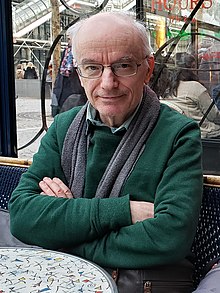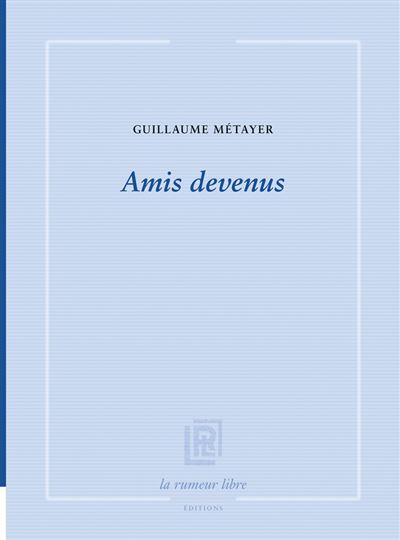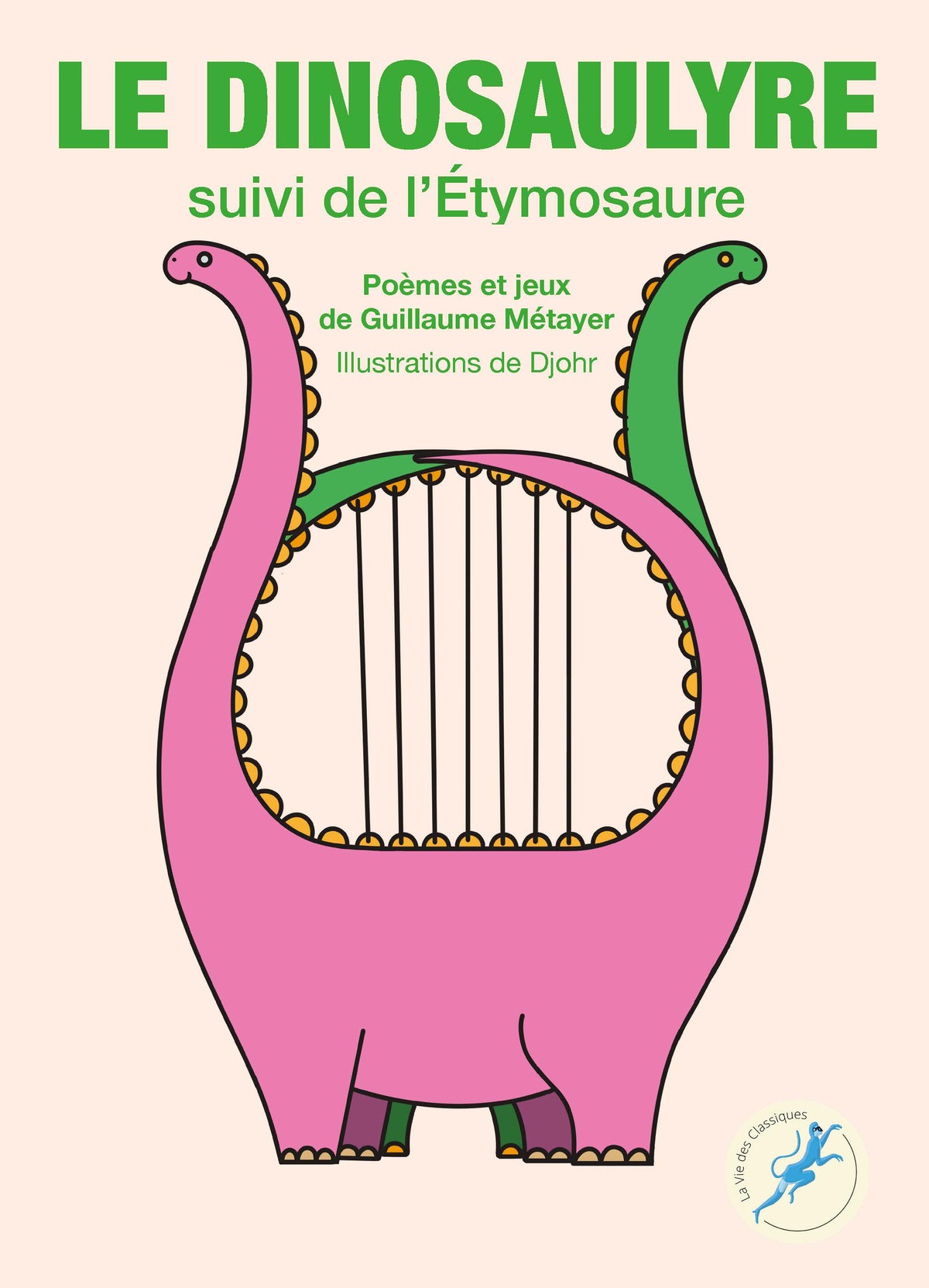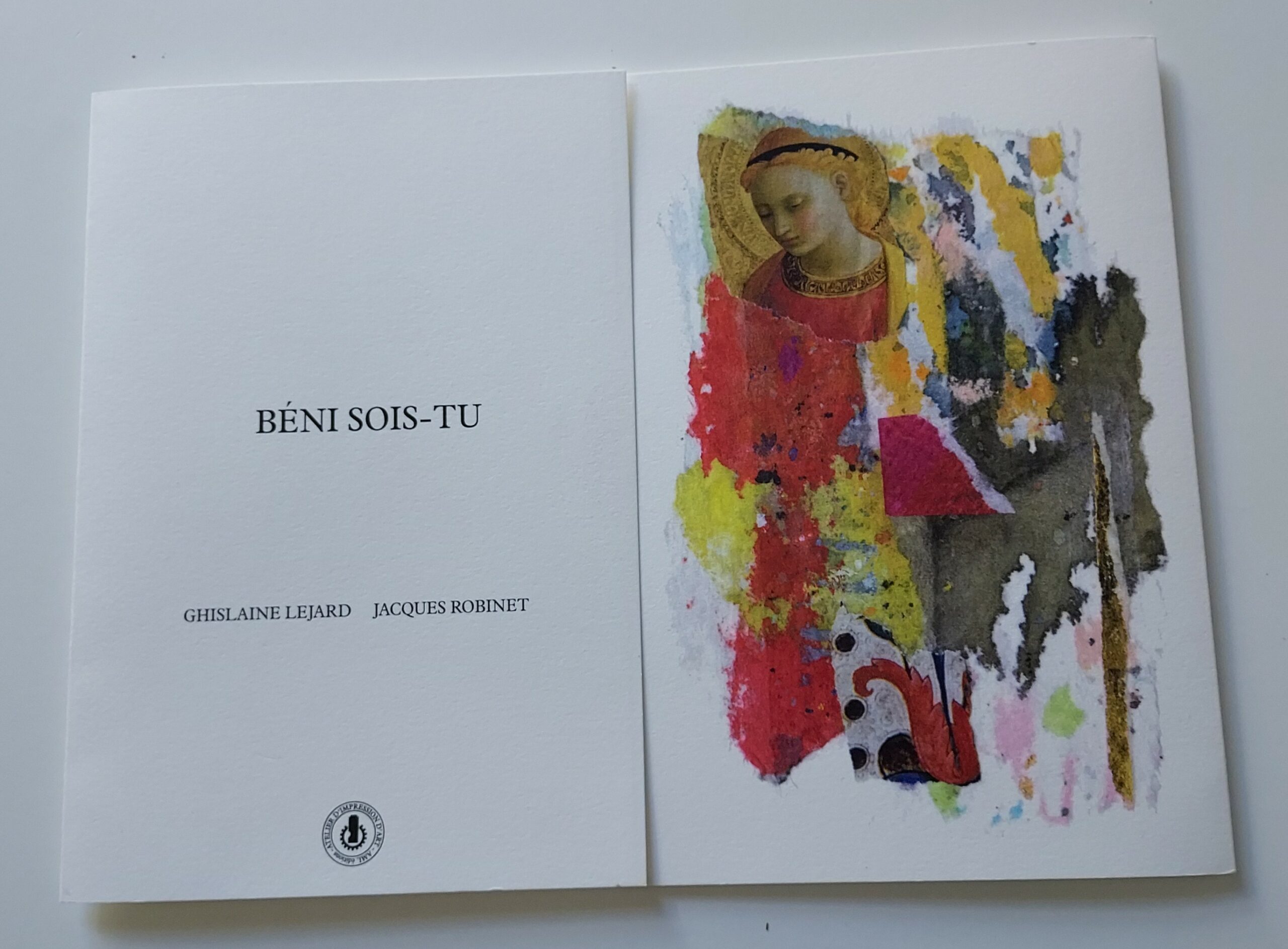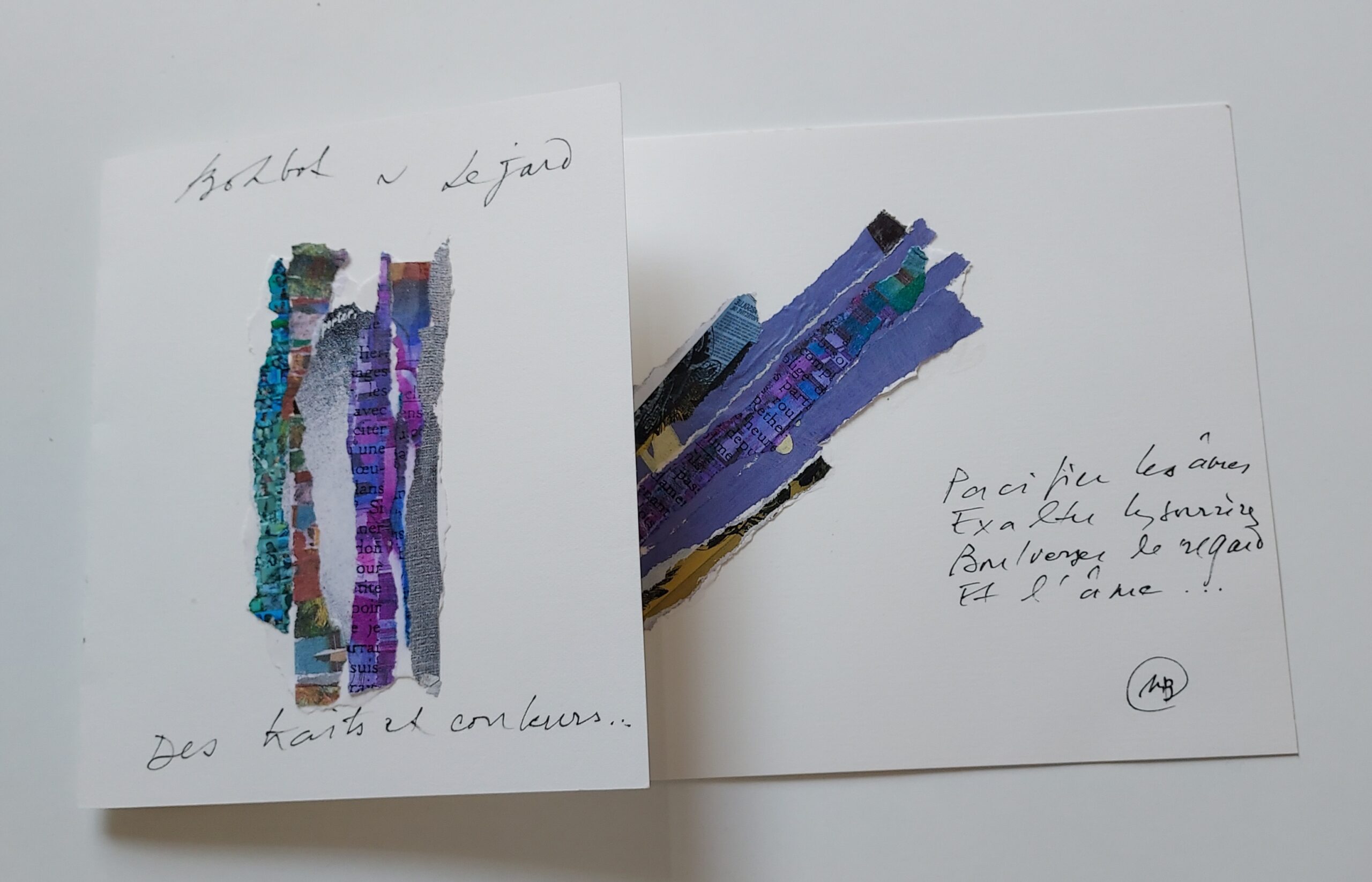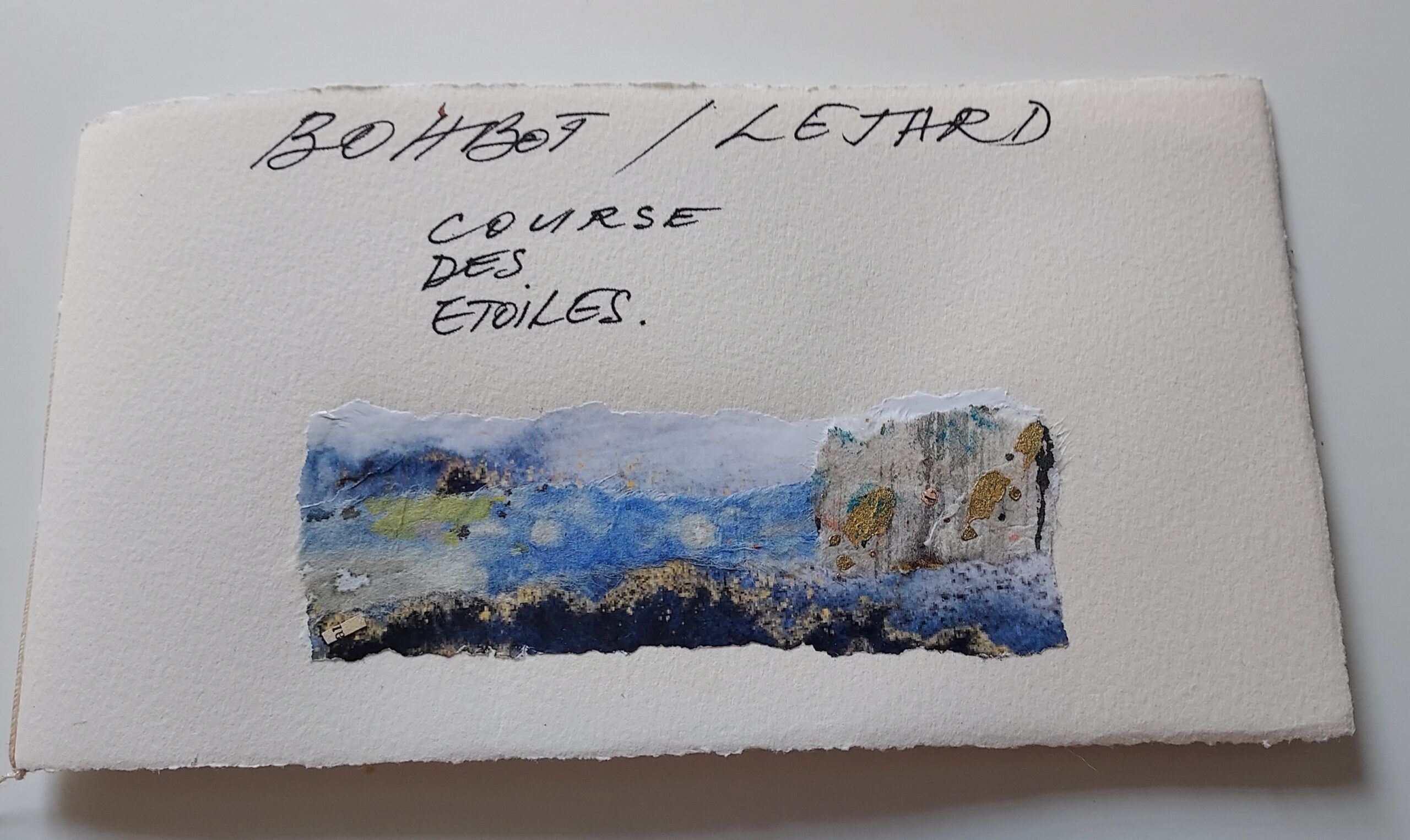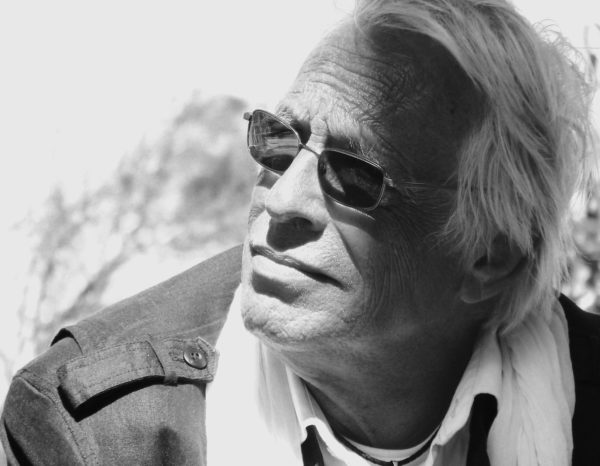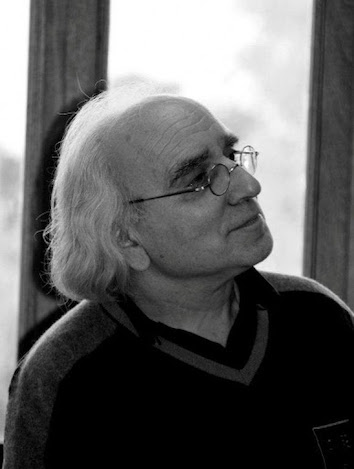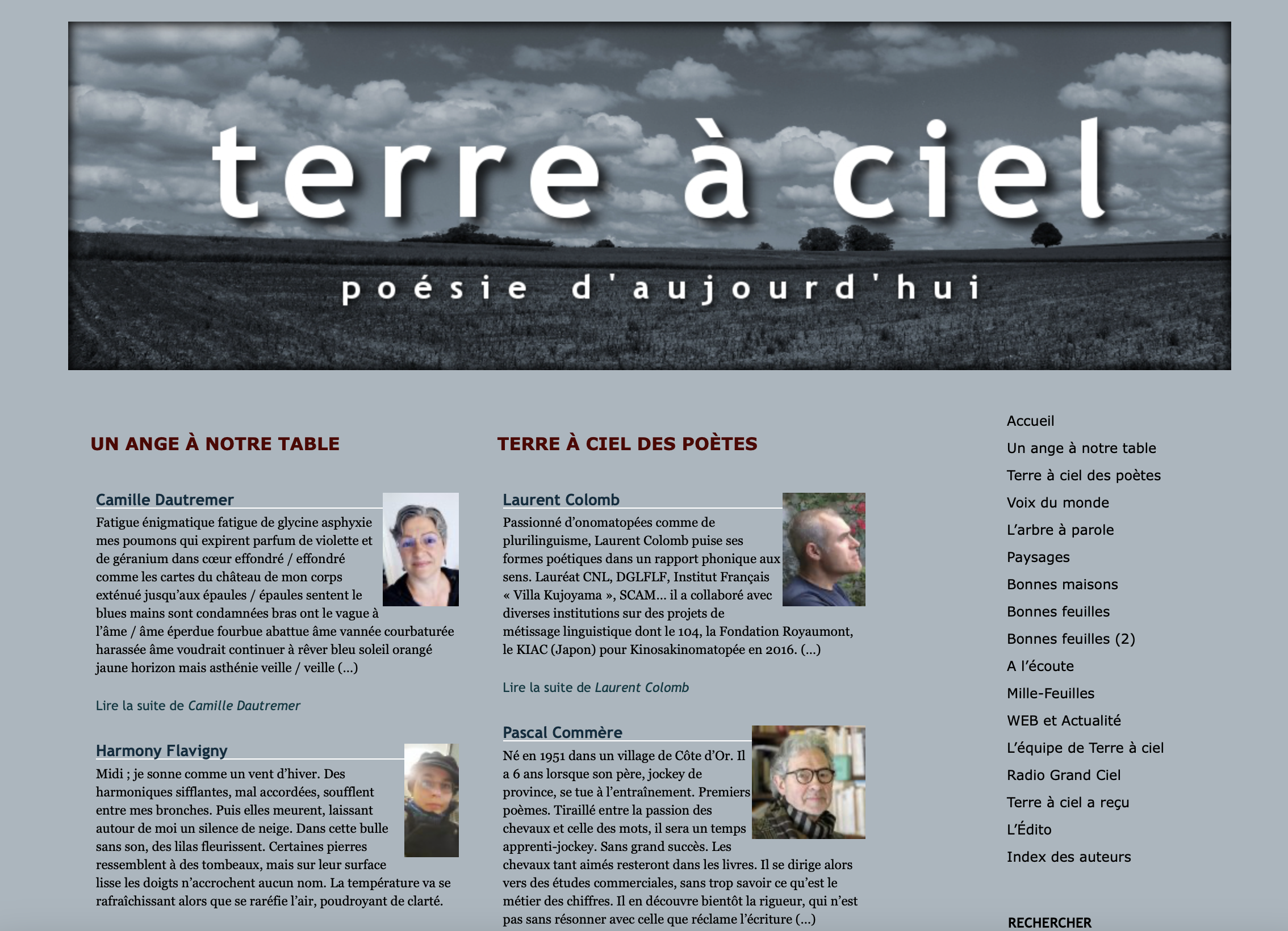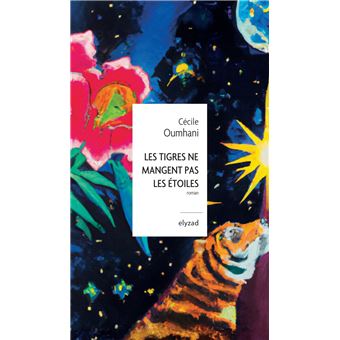Bernard Grasset , Et le vent sur la terre des hommes
Si longtemps j’avais marché
A travers la plaine des années
Quand jaillirent les flèches d’espérance
Ces vers ouvrent le recueil.
Bernard Grasset est un poète marcheur, un pèlerin des mots en quête de mystère. Comme il le disait déjà dans son recueil Brise : « partir s’arracher /… marcher ». Marcher, c’est se tenir au plus près de la nature et des lieux, c’est s’inscrire dans un espace- temps comme dans son autre recueil La Fontaine de Clairvent.
En ce nouveau recueil, troisième volet d’un triptyque de poèmes de voyage, le poète nous invite à cheminer avec lui en Italie, en Allemagne, en Ecosse, des bords de Loire à la Provence, des Vosges à la Bretagne… Ce recueil est un journal en poésie, un condensé de ce que l’on rencontre en voyage et : « Dans l’humilité du poème, le temps du voyage, ramène à l’essentiel ».
Voyager, c’est s’exiler, ne pas être touriste, mais se faire messager d’humanité : « Le poète qui voyage en quête de l’aube cachée par l’agitation du quotidien, ressemble plus à un pèlerin, messager d’humanité, qu’à un touriste, impatient de mirages. »
Comme pour Sylvain Tesson ou Arthur Rimbaud, ce marcheur éternel aux semelles de vent, la marche est source d’inspiration, de l’asphalte aux chemins de terre. La marche est un art, un art que Henry D. Thomas porta haut : « Au cours de ma vie, je n’ai rencontré qu’une ou deux personnes qui comprenaient l’art de la marche . » (Marcher), un art que vit et comprend Bernard Grasset.
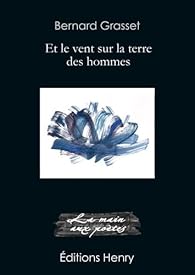
Si la marche est une constance dans l’œuvre de Bernard Grasset, le vent l’est aussi comme l’indique le titre de ce dernier recueil : Et le vent sur la terre des hommes, titre qui fait écho au titre d’un autre de ses recueils : Brise. Le vent souffle de la poésie, de l’esprit poétique ; le vent messager poétique : « Sur le chemin des poètes sonne le vent. »
On est frappé en lisant ces poèmes par leur rythme, les phrases le plus souvent nominales correspondent parfaitement au rythme de la marche et de la pensée qui l’accompagne. Une pensée fragmentaire par petites touches impressionnistes, une pensée qu’éclaire tout ce que le regard embrasse.
Marcher, regarder, les sens en éveil sentir le temps qui passe quand la pensée se vit au présent. En refermant le recueil, nous vient cette expression de Lao Tseu : « Le bonheur c’est le chemin ».