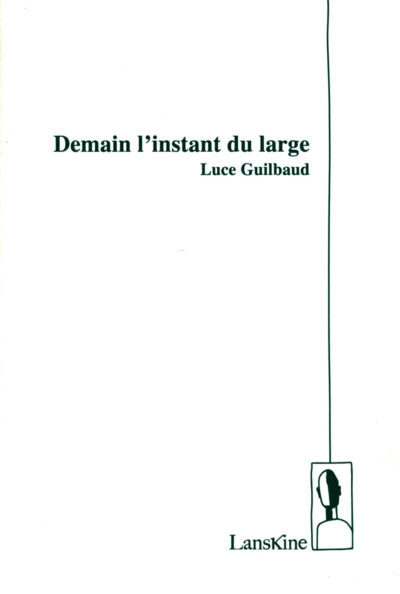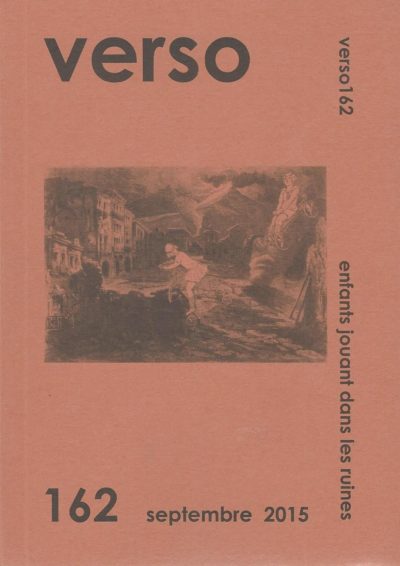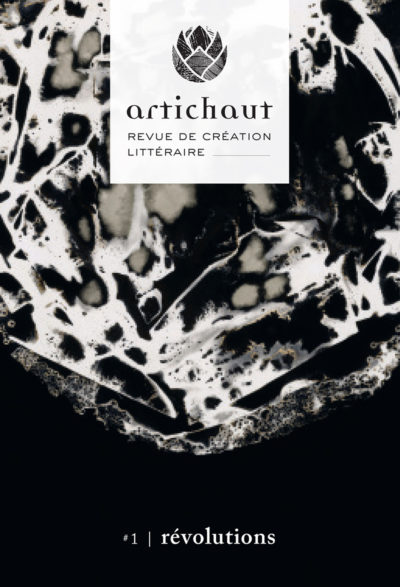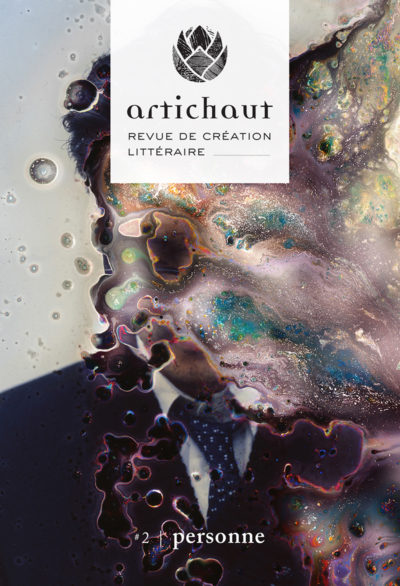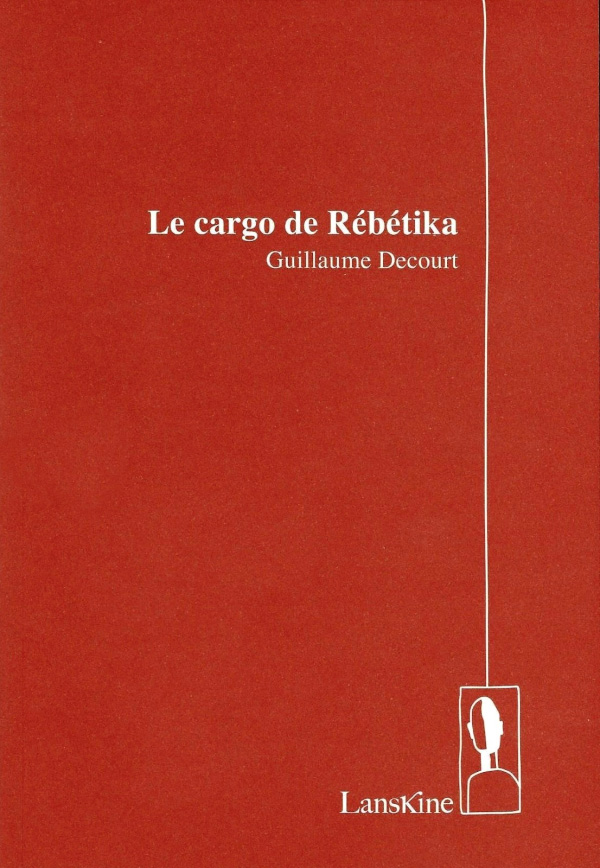Interview par mail de Justine Granjard, 28 octobre 2017
Quel a été le point de départ de votre projet ?
Artichaut est née d’une pratique personnelle. Je cherchais des revues susceptibles de me donner envie d’envoyer des textes. J’ai fait de jolies découvertes, mais qui m’ont surtout donné envie de créer ma propre revue ! Je travaillais déjà dans l’édition, j’avais envie de monter un projet toute seule, Artichaut en a été l’occasion.
Je connaissais presque tous les membres du comité auparavant : ce sont d’anciens camarades de l’école, ce sont des ami·es. Je souhaitais composer un comité de lecture avec des femmes et des hommes aux personnalités toutes très différentes, aux sensibilités parfois opposées, qui se retrouvent dans le plaisir du texte et le désir d’adopter une posture bienveillante. Je ne savais absolument pas ce qu’allaient donner les premières réunions. Mais ça a fonctionné tout de suite.
Comment vous est venue l’idée d’utiliser le concept de l'artichaut comme symbole de votre revue ?
Ce n’était pas du tout un concept. J’écrivais un texte (toujours en cours) intitulé provisoirement « Artichaut ». Les deux projets nés simultanément ont pris le même nom dans mon esprit. Et j’aimais la réaction perplexe des personnes à qui j’ai dit le nom pour la première fois. Cet objet du quotidien, humble et pourtant sophistiqué, rond et piquant, accessible et complexe… tout ce qu’évoque ce mot me plaît, et fonctionne de manière très cohérente sans que cela ait été forcément pensé au préalable. Maintenant, tout le monde vient me voir avec des histoires autour de l’artichaut, tout le monde m’envoie des photos d’artichauts : cet objet banal s’est trouvé soudain investi de sens, et de sens très variés.
Comment ont été élaborés les principes graphiques de la revue (le travail sur la typographie, le rabat, les pages de couleur...) ? Sont-ils concomitants ou consécutifs de votre projet littéraire ? Et, question subsidiaire : quel est le profil des membres de l'équipe (au vu de la beauté plastique de votre revue) ?
Je suis éditrice et je viens du monde de ce qu’on appelle les « beaux livres » : livres d’art, livres illustrés qui nécessitent un traitement graphique et de fabrication particuliers. Dans ce monde-là, nous adorons toutes les petites originalités de fabrication ! J’ai pensé à ce rabat couvrant immédiatement, en référence à une maison indépendante appelée Les éditions du Chemin de Fer qui a publié un magnifique inédit de Claude Simon il y a quelques années. Ensuite, j’ai travaillé avec une talentueuse jeune graphiste, Mélissandre Pyot, pour la conception de la maquette et du principe de couverture. Elle a conçu le logo à partir d’un dessin qu’avait réalisé une artiste tatoueuse, Maïssa Bénallègue, qui est aussi membre du comité de lecture. Je tenais à ces jeux typographiques que l’on retrouve en ouverture et en fermeture de la revue : le jeu typographique et la typographie en elle-même sont les lieux où l’écrit et l’art graphique se rejoignent. Et, comme j’ai longtemps fait des bibliographies universitaires dans les règles de l’art (je suis issue d’une formation littéraire), je trouvais amusant de déconstruire la bibliographie à travers ces jeux typos, pour réintroduire de la vie et du mouvement dans ces formes figées. Mélissandre a donc signé la maquette du #1, qui a été reprise et légèrement modifiée par un autre graphiste, Noël Pinsard, pour le #2. Je touche moi-même de plus en plus à la question graphique, par intérêt bien sûr, mais aussi pour des questions de budget !
Les membres du comité, qui font partie de l’équipe permanente d’Artichaut, ont des profils très variés : j’ai mentionné Maïssa Bénallègue qui est tatoueuse, mais il y a aussi Cyril Barde, professeur en CPGE et doctorant en littérature, Elara Bertho, chercheuse au CNRS et spécialiste des littératures africaines ; Eléonore Devevey, doctorante et éditrice qui s’intéresse aux liens entre anthropologie et littérature ; Vladimir Hugot, danseur à l’opéra et acteur ; et Laurent Barucq, traducteur littéraire qui a une connaissance impressionnante de l’édition indépendante.
Comment décidez-vous du thème des numéros ? Avez-vous élaboré un plan sur plusieurs numéros en prévoyant les appels futurs ? Je me pose ces questions du fait même de la cohérence des textes publiés et des thèmes des numéros.
Je travaille de manière assez intuitive, en fonction des envies, des intérêts (ou lubies) du moment. Je soumets mes propositions de thèmes au comité, qui les valide ou non. J’ai déjà les trois prochains thèmes en tête oui, ainsi que les artistes invité·es qui ont déjà été, pour la plupart, contacté·es.
Combien avez-vous reçu de textes pour chacun des 2 numéros ? Quand un nouvel appel à textes sera-t-il proposé ? J'ai l'impression que vous concevez chaque numéro comme une méta-œuvre, collective.
Pour le #1, nous n’avions reçu qu’une trentaine de textes, et nous avions été impressionné·es par la qualité des propositions. Nous n’en avions que trente, mais nous avons eu le luxe de choisir, et même de nous confronter à quelques dilemmes dans ces choix. Pour le #2, nous en avons reçu une centaine, donc le travail a tout de suite été plus important, notamment pour répondre à tout le monde individuellement (chose que je souhaite continuer de faire le plus longtemps possible). Le nouvel appel à textes sera communiqué dans les semaines à venir, avant le Salon de la Revue.
Oui, j’aime cette idée d’une oeuvre collective, où les individualités s’expriment pourtant dans leurs différences. Chaque feuille d’un artichaut présente des teintes, des tailles, des formes diverses. Pourtant, tout se tient, autour du cœur.
L'auteur invité ne participe pas à l'appel à textes ? Vous le connaissez déjà et lui proposez de participer ? L'artiste invité également ? Comment concevez-vous leur rôle de pivot dans le numéro ? Une sorte de fil rouge, de tamis orientant notre vision du thème ?
Les autrices invitées (car, pour l’instant, il n’y a eu que des femmes) ont eu carte blanche sur le thème. Elles n’ont pas participé à l’appel, puisque la publication de leur texte est assurée. Nous les invitons car nous les savons susceptibles de proposer des éclairages singuliers sur le thème, ou adoptant des formes, représentant des courants d’écriture qui font sens pour nous, toujours en lien avec ledit thème. Je ne conçois pas vraiment les oeuvres reproduites au centre du volume comme un pivot. Plutôt un coeur ! Je crois que l’idée du fil rouge est bonne, mais j’ai souvent eu l’impression à la lecture des numéros finis que ce fil rouge reliait les textes de manière très naturelle, très organique, et assez imprévisible. Il y a par exemple des effets d’échos entre des textes sélectionnés à l’issue de l’appel, que nous ne remarquons qu’au moment d’éditer les textes après sélection. Je pense que cela s’est produit pour les deux numéros existants, et j’espère que ça va continuer de se produire sur les prochains. Nous ne forçons pas la cohérence de cet ensemble si hétérogène : elle se dessine naturellement, et c’est très bien ainsi !
Les références mentionnées après la biographie des contributeurs sont-elles proposées par l'équipe et/ou par l'auteur ? Quel rôle joue pour vous la bibliographie en fin de volume ? Et l’édito ?
Les accompagnements sont proposés et choisis par les autrices et auteurs, en accord avec l’équipe éditoriale. La bibliographie permet de définir l’univers qui a accompagné les membres du comité tout au long de la conception du numéro. L’édito est le seul endroit où je m’exprime en mon nom (mais toujours « pour Artichaut ») sur le projet : je ne le voulais pas forcément si personnel au départ, mais c’est ainsi qu’il est né et lorsque j’essayais de l’écrire de manière moins intime, ça ne collait pas. Alors je me suis faite à l’idée d’y écrire « je ».
Parlez-moi de la rencontre prévue pour le salon de la revue.
C’est une grande chance pour nous, et je remercie encore André Chabin et Yannick Keravek d’Ent'revues qui nous ont proposé cette tribune pour présenter la revue. Nous pensons dire quelques mots du projet, répondre à quelques questions sur le fonctionnement, sur l’avenir de la revue et les développements que nous envisageons, et, surtout, laisser à deux auteurs que nous avons publiés (Raphaël Sarlin-Joly et Vanya Chokrollahi) l’occasion de lire leurs textes. Souvent je dois faire face à des réactions mitigées lorsque je parle de "jeunes auteurs et autrices » : les gens ne s’attendent pas à lire des textes aussi bons. J’aimerais que notre intervention lors du Salon de la Revue soit l’occasion de déconstruire ces a priori !