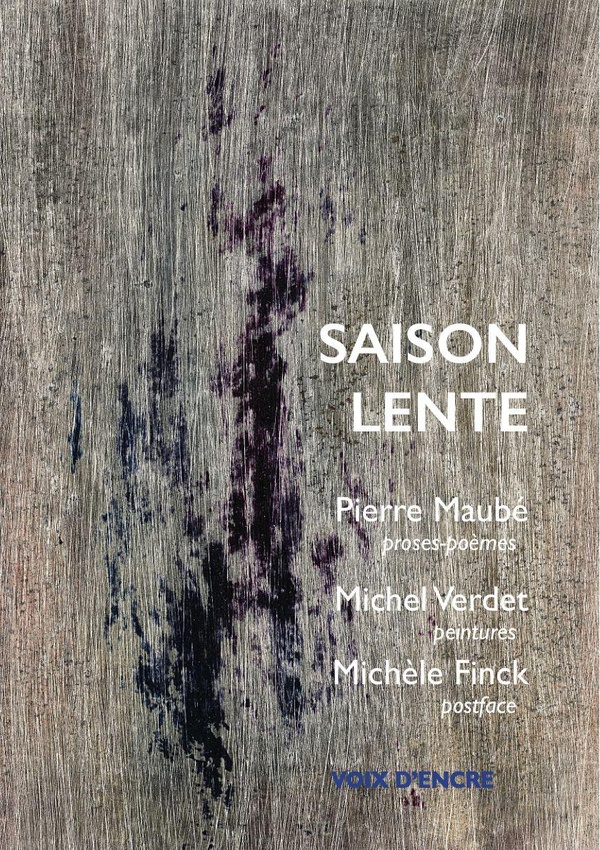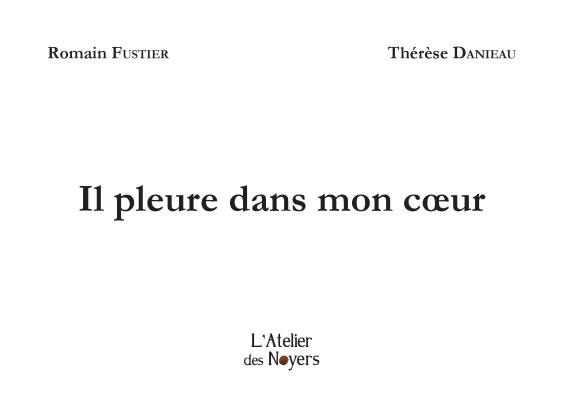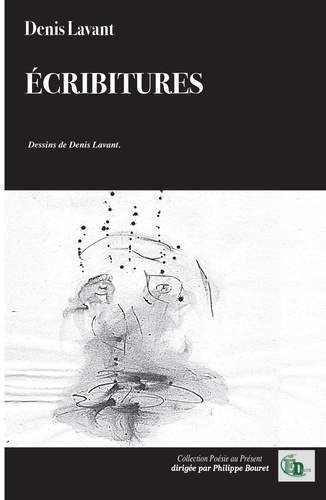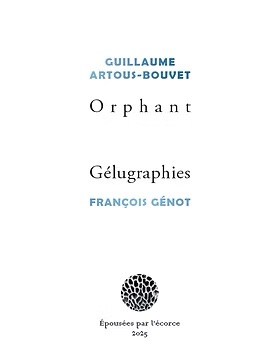Quelle qu’en soit l’occasion, fût-elle dissimulée en amour platonique de l’idée la plus haute (Leopardi, Aspasie), l’expression de l’éros, c’est-à-dire de la vie, est peut-être la seule constante de la poésie, son universel pourrait-on dire, et à coup sûr la matrice de ses glissements progressifs appelés à la fin images ou figures ou tropes.
Par-dessus, donc, toutes les différences linguistiques et culturelles : les rapprochements entre Ibn ’Arabi et Dante, pour ne prendre qu’un exemple, ont été faits depuis longtemps ; et il est assez banal de découvrir la volupté de certaines statues sulpiciennes, y compris funéraires, ou de voir une parenté entre l’érotisme ardent de Jean de la Croix et celui – plus terrien – de Francis Ponge. Notre millénaire a apprivoisé, cela dit, des formes bien diverses de ces jeux innocents ou cruels autrefois attribués à l’un des avatars d’Éros, Cupidon, sous l’égide finalement rassurante de sa mère Vénus – même si les flèches du galopin ailé frappaient parfois des êtres inattendus, voire de trop proche ou infiniment éloignée espèce (et groupe et genre) : de ce point de vue non plus, nil novi sub sole. Ce qui marque peut-être une entrée dans la modernité des sentiments, c’est le déplacement, de l’objet désiré à la force du désir elle-même, quand Augustin (vers le Ve siècle) se demande s’il n’aime pas surtout “aimer” (amare amabam), en une poursuite infinie qui porte en elle sa propre déception. Mais, reconnaissant l’énergie inhérente à cette quête, l’amour courtois (arabo-andalou, puis provençal, puis sicilien et toscan) allait poser pour longtemps les coordonnées essentielles de ce qui nous anime encore aujourd’hui, du moins si l’on croit encore – avec ou sans implication de foi religieuse – que l’amour « meut le soleil et les autres étoiles ».
Sonnet
Qui veut connaître, dames, mon seigneur,
voie un homme d’aimable et doux aspect,
jeune d’années, ancien par l’intellect,
figure de la gloire et de valeur ;
le poil blond, le teint de vive couleur,
grand de sa personne, vaste poitrine,
et en un mot parfait en chaque ligne,
hormis (hélas) qu’un peu traître en amour.
Et qui veut me connaître, moi, contemple
une femme en l’effet et l’apparence
image de la mort et des souffrances,
une auberge de foi ferme et constante,
une qui n’a, brûlant et soupirant,
nulle pitié, de son cruel amant.
Gaspara Stampa, Rime (1554)
* * *
L’amour les mots
(Sonnet)
Vous avez pu voir, quand je vous ai croisée,
paraître cet effrayant esprit d’amour,
lequel n’apparaît que lorsque l’homme meurt
et ne se laisse voir autrement jamais.
Il était venu si près que j’ai pensé
qu’il allait occire mon cœur douloureux :
alors s’est vêtue de la morte couleur
pour fort se lamenter mon âme affligée ;
mais elle cessa, dès qu’elle vit sortir
de vos yeux une lumière de pitié
qui porta au cœur une douceur nouvelle ;
et l’esprit subtil, par où la vue se fait,
secourut les autres, qui croyaient mourir,
affaiblis d’angoisse à nulle autre pareille.
(Guido Cavalcanti, Rime 22)
* * *
Belle esclave
Noire, oui, mais tu es belle, ô de nature
gracieux monstre d’amour entre les belles ;
près de toi l’aube est terne, pourpre et ivoire
vers ton ébène paraissent obscurs.
Quand donc et où le monde antique ou le nôtre
virent si vive, sentirent si pure
soit lueur jaillir d’une encre de ténèbres
soit d’un charbon éteint naître brûlure ?
Servant de ma servante, vois qu’alentour
je porte un cœur pris dans un noir lacet,
que blanche main jamais ne pourra défaire.
Où tu es plus vif, Soleil, pour t’abaisser
un soleil est né : qui, dans sa face fière,
porte la nuit, et dans ses yeux le jour.
G. B. Marino, Lira (1614)
* * *
Un souvenir
Je ne dors pas. Je vois une route, un bosquet,
qui sur mon cœur pèse comme une angoisse :
on y allait, pour rester seuls et ensemble,
moi avec un autre petit garçon.
C’était la Pâque ; les rites longs, étranges
des vieux. Et s’il ne m’aimait pas
— pensais-je -, ne venait plus demain ?
Et le lendemain il ne vint pas. Une douleur,
des affres ce fut lorsque approcha le soir :
car amitié (je le sus ensuite) ce n’était pas,
c’était là de l’amour ;
le premier ; et quel vrai grand bonheur
j’en eus, entre collines et mer de Trieste.
Mais pourquoi ne pas dormir, aujourd’hui, avec
ces histoires d’il y a bien quinze ans, je crois ?
Umberto Saba (1913–14), Canzoniere
* * *
Envoi
J’ai mis un verre de violettes à ma fenêtre ;
de ton jardin tu dois les voir :
pourquoi tu ne veux plus me regarder ?
On voit poindre deux pousses nouvelles
sous ta blouse je les vois respirer.
C’est pour ça que tu ne veux plus me regarder ?
Si tu ne te tournes plus
si tu ne veux plus rien savoir,
moi en revanche je peux t’atteindre :
c’est moi qui ai donné l’ordre au pommier
que toutes ses fleurs sur ta petite tête
il doit les secouer.
Piero Jahier, Ragazzo, 1919
* * *
[langue minorée de Vénétie]
Parole scrite d’amor zogàe, vendùe,
Gavèsse ’vùo ’na dona un solo zorno
Che ve gavèsse par amor capìe,
No’ ’varìave, no’, scrite nè ditàe
Mie parole d’amor.
Donàe, donàe ve gavarìa
E perse volentiera.
[1933]
Mots d’amour écrits joués, vendus,
Eussé-je eu une femme un seul jour
Qui vous eût compris par amour,
Je ne vous aurais jamais écrits ni dictés
Mes mots d’amour.
Donnés, donnés je vous aurais
Et perdus volontiers.
Giacomo Noventa, Versi e poesie di Emilio Sarpi,
Milan 1963 (posthume)
La rose blanche
Je cueillerai pour toi
la dernière rose du jardin,
la rose blanche qui fleurit
dans les premières brumes.
Les abeilles avides l’ont visitée
jusqu’à hier,
mais elle est encore si douce
qu’elle fait trembler.
C’est un portrait de toi à trente ans.
Un peu oublieuse, comme tu seras alors.
Attilio Bertolucci, Fuochi in novembre, 1934
* * *
Voici le signe ; il s’innerve
sur la paroi qui se dore :
un découpage de palme
brûlé par les lumières de l’aurore.
Les bruits de pas qui proviennent
de la serre si légers,
non feutrés par la neige, sont encore
ta vie, ton sang, un sang tien dans mes veines.
Eugenio Montale, Mottetti (1938)
* * *
Dès que tu es venue,
qu’avec un pas de danse tu es entrée
dans ma vie
comme un souffle de vent dans une pièce close –
pour te faire fête, bien tant attendu,
les mots font défaut et ma voix,
et rester en silence près de toi me suffit.
Le pépiement de même assourdit le bois
au point de l’aube et se tait
quand sur l’horizon bondit le soleil.
Mais c’est toi que cherchait mon impatience
lorsque jeune homme
dans la nuit je me mettais
à la fenêtre comme suffocant :
je ne savais quoi, m’étreignait le cœur.
Et sont tout à toi les paroles
qui, telle une eau sur le point de déborder,
venaient d’elles-mêmes à ma bouche,
dans les heures désertes, quand se tendaient
puérilement mes lèvres d’homme
toutes seules, par désir de baiser…
Camillo Sbarbaro, Versi a Dina, 1955
Sans points d’exclamation
und das Sommerland
Comme est haute la douleur.
L’amour, comme il est bestial.
Quelle vacuité des mots
qui creusent dans le vide de vides
monuments de vide. Vide du
blé qui atteignit une fois
(au soleil) la hauteur du cœur.
Giorgio Caproni, Il muro della terra, 1975
(sonnet)
Femme infante mais aux trop forts désirs
ou femme de douleurs et de tourmentes,
toujours prise par tripailles et ventre,
je ne sais si au jour je dois sortir,
du vide creux de ma nuit de goudron,
entre dures gelées et coups de chaud,
bondir avec pauvres envies, et go !
en feignant calme et petits trucs bonbons,
pour les jours de guerre et bouillonnement
et pour piéger les proies pleines et vaines,
et voir comment sans èche ou boniment
tient peu lié l’amoureux ligament…
Oh mon cœur las ! Quelle chose qui tienne ?
Un néant nul. Et j’ai même la dent.
Patrizia Valduga, Altri medicamenta, 1982
Der Wind
La vie douce, Maria
Passe, Maria-la-Vie
Maria-la-Mort. Der Wind.
Quand je serai guérie
J’aurai 60 ans. Maria
La vie passe. La Vie
Est passée comme le vent
Passe sur le feuillage sec
Avec des cris stridents.
Nella Nobili, [posthume] dans Autres Passages,
“Gli italiani all’estero” 1990
L’illusion amoureuse
(Loin des yeux…)
Hélas, ces yeux dont je suis si loin !
hélas, mémoire du temps passé !
hélas, douce foi de cette main !
hélas, grand vertu de sa valeur !
hélas, ma mort n’est pas arrivée !
hélas, y pensant, quelle douleur !
Hélas, pleurez, ô mes yeux dolents,
puisque ne la voyez pas mourant !
Cecco d’Ascoli, Acerba etas, IV, 4
La pensée dominante
Très douce, très puissante
maîtresse des profondeurs de mon esprit ;
effrayante, mais chère
faveur du ciel ; compagne
de mes lugubres jours,
pensée, qui si souvent devant moi reviens.
De ta nature obscure
qui ne raisonne ? Son pouvoir parmi nous
qui ne l’a senti ? Bien
qu’à dire ses effets
le sentiment pousse toute langue humaine,
ce qu’elle conte semble neuf à entendre.
Qu’il se trouve esseulé,
mon esprit d’autrefois,
du moment où tu en as fait ta demeure !
Aussitôt, tel l’éclair, mes autres pensées
partout autour de moi
se dispersèrent. Comme une tour dressée
sur un champ solitaire,
toi seule, géante, tu te tiens au centre.
Que sont devenues, en dehors de toi seule,
toutes choses terrestres,
toute la vie entière à mon point de vue !
Quel assommant ennui
loisirs et relations,
et la vaine espérance d’un vain plaisir,
au regard de la joie,
cette céleste joie qui de toi me vient !
Comme, des rochers nus
du scabreux Apennin,
sur des champs verdoyants qui au loin sourient
tourne ses yeux plein d’envie le pèlerin,
ainsi, du sec et âpre
bavardage mondain, moi, impatiemment,
je me réfugie dans ton jardin heureux
dont le séjour est presque un baume à mes sens.
Il est presque incroyable
que la vie malheureuse et le monde idiot
je les aie supportés
aussi longtemps sans toi ;
je ne sais plus comprendre
que pour d’autres désirs,
hormis à toi semblables, d’autres soupirent.
Jamais, depuis que pour la première fois
l’expérience m’apprit ce qu’est cette vie,
la crainte de la mort ne serra mon cœur.
Elle me semble un jeu
cette nécessité
que le monde inepte, la louant parfois,
redoute et hait toujours ;
et si un danger surgit, en souriant,
j’affronte sans me détourner ses menaces.
Toujours couards et cœurs
non généreux, abjects,
je les ai méprisés. Or tout acte ignoble
blesse aussitôt mes sens ;
sitôt mon cœur s’indigne
des exemples de l’humaine vileté.
Cet âge altier, stupide,
qui de vaines espérances se nourrit,
d’un rien épris, de la vertu ennemi,
qui réclamant l’utile
ne voit pas que la vie
devient toujours de plus en plus inutile,
je me sens plus grand que lui. Des jugements
des gens, je ricane ; le peuple inconstant,
hostile au beau penser,
et ton digne contempteur, je le piétine.
Quelle passion ne cède
à celle d’où tu nais ?
quelle autre passion même,
hormis celle-là, siège parmi les hommes ?
Avarice, orgueil, haine, dédain, désir
d’honneurs et de pouvoir,
sont-ils autres qu’envies
auprès de celle-ci ? Une passion seule
règne parmi nous : elle,
souveraine absolue,
fut donnée aux cœurs par des lois éternelles.
La vie n’a pas de valeur, n’a pas de sens
en dehors d’elle, qui est tout pour les hommes ;
seule excuse au destin
qui nous pousse, mortels,
à tant souffrir, sur cette terre, sans fruit ;
parfois, par elle seule,
non pour les sots, mais pour les cœurs non vulgaires,
la vie est plus agréable que la mort.
Pour cueillir les joies tiennes, douce pensée,
souffrir comme tout homme
et endurer longtemps
cette vie mortelle ne fut pas stérile ;
en être qui a traversé tous nos maux,
me mettre en chemin pour atteindre un tel but :
je ne fus pas si las
par ce désert mortel,
quand je venais à toi, pour que nos souffrances,
ne me semblât point les vaincre un bien si grand.
Quel monde, quelle neuve
immensité, quel paradis que celui
où souvent ta magie extraordinaire
semble m’emporter ! où,
errant sous une lumière autre, inconnue,
j’abandonne à l’oubli
ma condition terrestre et tout le réel !
Tels sont, je crois, les songes
des immortels. Ah finalement un songe
qui embellit le réel en plus d’un point,
c’est toi, douce pensée,
songe, erreur évidente. Mais de nature,
sous les douces errances,
tu es divine ; et elle est si vive et forte,
qu’au réel elle résiste obstinément,
souvent s’égale à lui
et ne se perd que dans le sein de la mort.
Et toi, c’est certain, ô ma pensée, toi seule
donnant vie à mes jours,
origine adorée d’infinis tourments,
en même temps que moi, t’éteindra la mort :
car des signes clairs disent dedans mon âme
qu’à jamais tu m’as été donnée en reine.
Face à l’aspect du vrai
d’autres charmes aimables
se ternissaient à mes yeux. Plus je reviens
voir encore la seule
par laquelle, parlant avec toi, je vis,
plus grandit ce délice,
plus grandit ce délire, où je prends mon souffle.
Angélique beauté !
Où que je regarde, chaque beau visage
telle une image feinte
semble le tien imiter. Toi seule, source
de toutes autres grâces,
sembles à mes yeux la seule vraie beauté.
Du jour où je t’ai vue,
de quel sérieux souci ne devins-tu pas
l’ultime objet ? quelle heure du jour passa
sans une pensée tienne en moi ? dans mes rêves
ta souveraine image
manqua-t-elle jamais ? Belle comme un rêve,
angélique semblance,
dans le séjour terrestre,
dans les hautes voies de l’univers entier,
que chercher, qu’espérer
de plus désirable que de voir tes yeux ?
de plus doux présent que la pensée de toi ?
G. Leopardi, Canti, tr. CIRCE — Paris3 Sorbonne Nouvelle
L’absence
Un baiser. Et, loin. Disparaît
là-bas tout au fond, où se perd
la route du bois, qui paraît
un très long couloir dans le vert.
Je remonte ici, où avant
elle avait ses beaux habits gris :
je vois le crochet, les romans
et chaque vestige petit…
Je vais au balcon. J’abandonne
ma joue dessus la balustrade.
Et sans tristesse. Je claironne
mon calme : elle revient ce soir.
Alentour décline l’été.
Et sur une fleur vermillon,
vibrant de ses ailes caudées
atterrit un gros Papilio…
L’azur infini de ce jour
est comme une soie bien tendue ;
mais sur la sereine étendue
la lune pense à son retour.
L’étang étincelle. Se taisent
les grenouilles. Cette lueur
de claire émeraude, de braise
azurée : le martin pêcheur…
Je ne suis pas triste. Je suis
surpris en voyant le jardin…
surpris de quoi ? je ne me suis
jamais senti autant bambin…
Étonné de quoi ? Mais des choses.
Les fleurs me paraissent étranges :
c’est là pourtant toujours les roses,
c’est là les mêmes alkékenges…
Guido Gozzano, I colloqui, 1911
Beautés
Le champ de blé n’est si beau
que parce qu’il y a dedans
ces fleurs de coquelicot et de vesce ;
et ton pâle visage
parce qu’il est un peu tiré en arrière
par le poids de ta longue tresse.
Corrado Govoni, Il Quaderno dei sogni e delle stelle, 1924
Au jardin de Suzanne
5.
Mais quand tu me rendais heureux je chantais
pour un rien : comme feuille de peuplier
le moindre souffle m’incitait au chant.
À présent qu’avec toi même la vie
me déchire, et doucement me laisse
à la musique rauque de la douleur intime,
je m’habitue à compter les paroles
depuis que déjà au-dedans je croupis
et goutte après goutte distille mon dire.
Betocchi, Un passo, un altro passo, 1967
* * *
[lucanien ancien]
Mbàreche mi vó’
Mbàreche mi vó’
e già mi sònnese, ’a notte.
Ié pure,
accumminze a trimè nd’ ’a site,
e mi mpàure.
Mi iunnére dasupr’a tti,
e tutte quante t’i suchére, u sagne,
nda na vìppeta schitte e senza fiète,
com’a chi mbrièche ci s’ammùssete
a na vutte iacchète
e uèreta natè nd’u vine russe,
cchi ci murì.
Tu me cherchais ?
Tu me cherchais,
et déjà tu rêves de moi la nuit ?
Moi aussi,
je commence à trembler de soif,
et j’ai peur.
Je me jetterais sur toi,
et je te sucerais tout ton sang,
d’une seule gorgée sans reprendre souffle,
comme un ivrogne s’attache
à un fût crevé
et voudrait nager dans le vin rouge,
à y mourir.
Albino Pierro, Nu belle fatte, 1976
Jouer, enfin
Il touche l’Aimée de son ombre
Alors que d’elle, mon soleil adoré,
idolâtre je contemple le beau corps,
et que la méchante et désintéressée
de toutes ses beautés cache le trésor,
de ma personne, presque mourante au loin,
je vois par la grâce du grand astre errant
l’ombre heureuse, de l’arrogante au-devant,
usurper mon plaisir et mon repos plein.
Aussi suis-je obligé d’envier ce vain
simulacre de moi qui l’espace encombre,
alors que je vis en vrai, brûlant lointain.
Oh combien, Amour, de tes illusions montre
mon malheureux état ; que l’on voie donc bien
que toute joie d’amour consiste en une ombre !
Tommaso Gaudiosi, L’arpa poetica, VI (éd. 1671)
* * *
reviens ma lune en alternatives de plénitude et d’exiguïté
ma lune au carrefour et langue de lune
chronomètre enfoui et Sinus Roris et psalmodie litanie ombre
fer à cheval et marguerite et mamelle malade et nausée
(je vois mes poissons mourir sur les rochers de tes cils)
et mésaventure et obstacle paso doble épidémie chorus et mois d’avril
apposition ventilée appel d’air d’inhibition et queue et instrument
exposition de tout ou même insecte ou rapprochement de jaune et de noir
donc feuille en champ
toi chauve-souris en poisson-lune toi tache en expansion lunae
(donc en champ jaune et noir) pinceau du songe parfois lieu commun
vor der Mondbrücke vor den Mondbrüchen
en un horizon hystérique de paille cochon empaillé avec des ailes de papillon
cryptographie masque poudre da sparo foie indemoniato rien
Edoardo Sanguineti, Laborintus, 1956
Présentation de l’auteur
- Amont dévers — une anthologie poétique : Dans la poésie italienne, transductions (1) - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Une espèce de quotidien - 6 mai 2021
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Amelia Rosselli, Corrado Govoni - 6 septembre 2020
- Questionnements politiques et poétiques 6 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni - 6 mai 2020
- Questionnements politiques et poétiques 5 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Patrizia Valduga - 6 mars 2020
- Questionnements politiques et poétiques 4 : Quelques poètes italiens à Paris (2009), Jolanda Insana - 5 janvier 2020
- Lucien Wasselin, Mémoire oublieuse et vigilante - 1 septembre 2019
- Eugenio De Signoribus : Petite élégie (à Yves Bonnefoy) - 6 juillet 2019
- Amont Dévers, treizième livraison - 4 juin 2019
- Amont dévers, douzième livraison - 1 avril 2019
- Philippe Denis, Pierres d’attente - 3 février 2019
- Amont dévers, onzième livraison - 3 février 2019
- Eugenio de Signoribus : Air du Dernier appel - 3 décembre 2018
- Amont Devers : dixième livraison - 5 novembre 2018
- Amont dévers, neuvième livraison - 4 septembre 2018
- Amont dévers 8 - 3 juin 2018
- Giovanni Pascoli, une traduction inédite : Le 10 Août (élégie) - 6 avril 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (7) - 1 mars 2018
- Pour un poète italo-iraquien disparu : Hasan A. Al Nassar - 26 janvier 2018
- Amont dévers — une anthologie poétique (6) - 19 novembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (5) - 2 septembre 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (4) : La poésie, le disparaissant… - 31 mai 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (3) - 31 mars 2017
- Quelques “paroles d’Afrique” - 28 mars 2017
- Amont dévers — une anthologie poétique (2) - 20 janvier 2017
- Giovanni Pascoli, Gog et Magog - 4 avril 2016
- Questionnements politiques et poétiques 3 : Giovanni Pascoli et la “fin d’un monde” - 4 avril 2016
- Avec une autre poésie italienne : L’élégie de Pascoli - 5 mai 2014
- Avec une autre poésie italienne : Une « lande imprononçable » peut-être - 6 septembre 2013
- Avec une autre poésie italienne : Giovanni Raboni - 15 mars 2013
- Avec “Une autre poésie italienne” : Amelia Rosselli - 2 novembre 2012