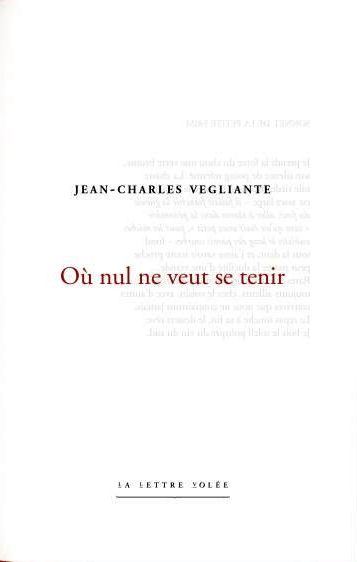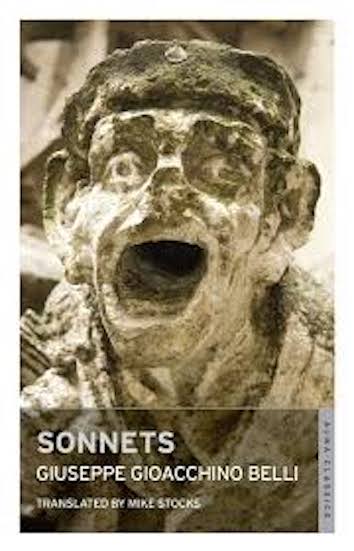Quatre recueils qui illustrent la diversité de la poésie, à travers une inquiétude commune, sur le sens d’un monde plus que jamais déchiré :
Esther Tellermann – Sous votre nom, Flammarion
On peut être davantage sensible à d’autres formes de poésie, plus immédiatement accessibles, et être dérouté par trop d’énigme (c’est un des mots qui revient dans le recueil : « Nous aurions / érigé / ensemble / les énigmes »). C’est mon cas. Pourtant, j’ai peu à peu abandonné le désir de comprendre pour m’abandonner au charme de l’étrangeté de ces textes, ou plutôt audépaysement au sens propre, puisque nous voyageons d’Est en Ouest (encore une expression fréquente, du moins dans la première partie) et jusqu’au Sud dans la troisième. C’est un univers de légende, où errent de grandes figures de princes et de princesses sans nom dans un décor de feu (partie I) ou de glace (partie II), une épopée sans héros véritable, comme le disait Jean Paulhan à propos de Saint-John Perse. Et de fait, c’est à Saint-John Perse que j’ai souvent pensé, à son hermétisme, comme à ses grands espaces et ses déserts, même si, avec Sous votre nom, nous sommes aux antipodes des grands développements du poète. Ici, c’est la brièveté qui domine, dans le vers, et dans la phrase si resserrée qu’elle est parfois privée d’articles devant les substantifs (« corps devint / écriture »). Des constantes, outre la forme : des répétitions qui circulent d’une partie à l’autre, et surtout une quête pour appréhender la double face du noir, pour retrouver la mémoire de l’humanité, pour saisir le mot et les syllabes. On pourrait résumer le recueil par ce texte : « De légendes en / légendes et / d’incendies en / incendies / ils cherchaient : à ne pas faire mourir / la parole ». Précisément, elle ne meurt pas dans ces poèmes où elle constitue une musique, semblable à celle qui y est souvent évoquée et qui « pardonne » à la « part coupable du monde ». De ce type de musique, nous avons grand besoin.
*
Emeric de Monteynard – Écoper la lumière, L’Arbre à paroles
Autres textes lapidaires, où le vers se réduit parfois à quelques syllabes, à un mot qui suffisent à exprimer les questions essentielles, « Comment faire place / À “plus” de lumière ? », ou « Comment / Ne pas répondre à l’étoile ? » Ce vers libre, qui, à la différence de celui d’Esther Tellermann, suit les articulations de la syntaxe, est en définitive un peu monotone, parfois artificiel mais la méditation qui s’en dégage sur le temps, la mort, le sens de l’existence, l’affirmation de la force des humains ne peut manquer de toucher : « Danser / Comme un seigneur, / Un vrai, / Un grand. / Danser », d’autant qu’elle s’incarne dans des réalités quotidiennes, des paysages familiers, la mer, les étoiles. « Écoper la lumière », c’est, contre nos peurs et la mort affirmer « l’espoir du renouveau ».
*

François Perche – À quoi bon des poètes en ces temps dérisoires ?, Rougerie
Voilà un recueil où le vers libre, a tout son sens, parce qu’il suit les méandres de la pensée, joue des rejets, des différences de rythme, des contrastes, qui soulignent la force de certaines affirmations ou images, comme dans ce quatrain qui ouvre le premier poème : « Les odeurs montent, / Se ressembelnt, / Masques de fumée, / Malgré les visages hurlant leur détresse. » Sans pathos, avec simplicité et lucidité, le poète qui doute de lui-même constate que si les temps sont dérisoires, ils sont surtout cruels, parce que « L’insomnie, / La folie, l’erreur, la mort / Cognent » et que c’est dans les hommes que « […] se cache l’abîme / Grand ouvert. » Peut-être alors vaudrait-il mieux « Se taire / Se laisser gagner par / Le curieux rire des mots » et accepter que « Les points de silence / Envahissent la page. » Pourtant, la voix du poète est nécessaire, s’il accepte de ne pas céder aux blandices du langage, aux « bourrasques » et aux « métaphores », écoute « l’intime de [lui]-même » et laisse les vers se « décanter » « en leur simplicité ». C’est un art poétique qui est ici posé, des injonctions souvent à l’infinitif qui sont proposées, mais au-delà, ce qui est affirmé, c’est que même si écrire est « une défaite perpétuelle », c’est aussi un acte de résistance, aussi dérisoire sans doute que les temps où vit le poète, mais le seul moyen qu’il a de « lutter ». Et François Perche sait nous en convaincre tranquillement, profondément.
*
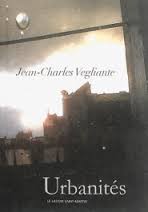
Jean-Charles Vegliante – Urbanités, Le Lavoir Saint-Martin
Le recueil que j’ai préféré.
Urbanités : ce qui concerne l’urbs, la ville, à travers laquelle nous promènent ces textes en particulier dans la partie « La forme d’une ville », et ce qui concerne la conduite que l’on doit y tenir, la politesse.
Forme d’une ville : sont déclinés les rues familières, les personnages qui y circulent, « la chinoise aux cheveux châtains », la « Mèr-rom », le fauteuil roulant, les poussettes, et il arrive que le souvenir surgisse … Parfois, les rues sont vides, c’est dimanche, ou alors on se hâte pour aller au travail. Autant de détails personnels mais que peut reconnaître chacun de nous.
Politesse : elle se manifeste d’abord dans la reconnaissance envers les aînés et les amis poètes, Baudelaire, Rimbaud, Dante, Benedetti… 22 hommages énumérés en fin de volume, autre forme de politesse, cette fois envers un lecteur qui n’est peut-être pas aussi savant que l’auteur. Sans doute, savante, cette poésie l’est bel et bien, et pas seulement dans ses allusions, mais aussi dans son jeu avec les mots, qui évoque parfois les Grands Rhétoriqueurs, et dans la référence quasi constante au sonnet. Elle est évidemment explicite dans les poèmes « Sonnet caudé » et « Autre sonnet », mais implicite dans la présence massive des poèmes de 14 vers, d’un seul bloc, parfois prolongés par un ou deux vers, ou même par des tercets bien identifiables. Mais jamais les allusions savantes ou le jeu avec les formes, que l’on peut d’ailleurs ignorer, ne sont gratuits, ne serait-ce que parce qu’ils confèrent de la légèreté à une réflexion grave, pour ne pas dire le plus souvent sombre.
C’est une poésie généreuse, qui ne se satisfait pas de parler de poésie et de mots (ces « mots qu’on retient / depuis la communale ») mais s’interroge avant tout sur un monde malade, même si « il ne faudrait pas écrire sur ces choses ». Un des derniers poèmes, « Morts de janvier », porte sur les tragiques événements de janvier 2015. Le pire est peut-être à venir, c’est ce que dit l’ensemble du recueil et, tout particulièrement, la deuxième partie « Plus méchants que vous ». L’ombre, la douleur, la mort : l’Envoi et la clôture du volume, « Tout à refaire », ne sont pourtant pas des lamentations mais au contraire l’affirmation de la dignité humaine, envers et contre tout : « Se tenir par la main dans la barque », et de l’espoir : « Dans la cour noyée un cri de joie sauvage ».
- Jeanine Baude : Soudain - 6 juillet 2023
- Charles Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes - 1 juillet 2022
- Nos aînés (1) : Roger Caillois - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Où nul ne veut se tenir - 1 mars 2018
- Henry JAMES : Carnets - 16 octobre 2016
- Jean-Charles Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes - 20 septembre 2016
- Abdellatif Laâbi, L’arbre à poèmes. Anthologie personnelle, 1992–2012 - 3 avril 2016
- Ingeborg BACHMANN : Toute personne qui tombe a des ailes - 21 février 2016
- Jacques Darras : La Transfiguration d’Anvers - 7 janvier 2016
- Fil de Lecture de Joëlle Gardes : Esther Tellermann, Emeric de Monteynard, François Perche, Jean-Charles Vegliante - 5 janvier 2016
- Philippe Leuckx : L’imparfait nous mène - 22 décembre 2015
- Jeanine Baude : Soudain - 11 novembre 2015
- Roger Gilbert-Lecomte : La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent et autres textes. - 10 octobre 2015
- Nos aînés. La modernité de Racine, par Joëlle Gardes - 6 septembre 2015
- Nos aînés (5) - 4 novembre 2014
- Nos aînés (4) - 19 mai 2014
- Nos aînés (3) - 31 décembre 2013
- Nos aînés (2) - 22 septembre 2013