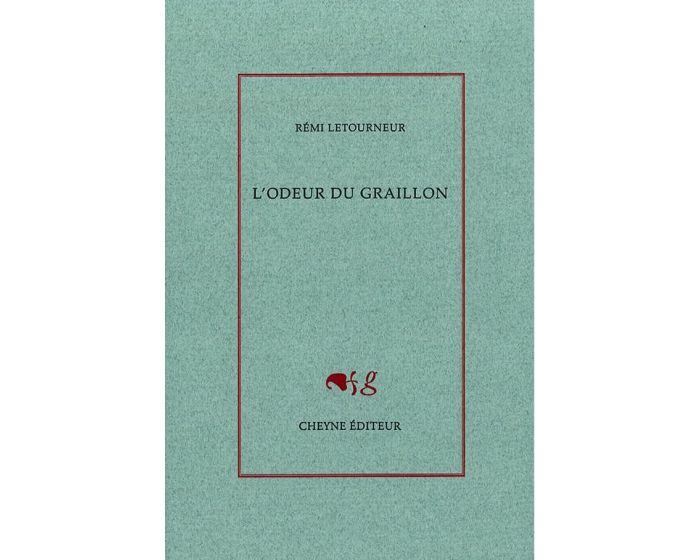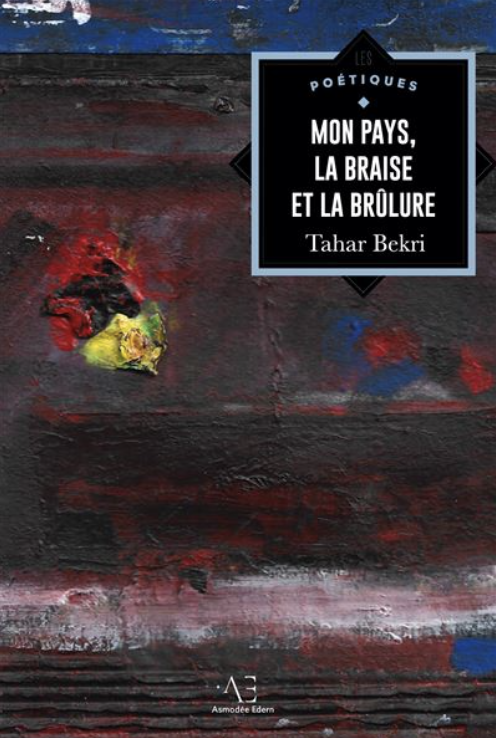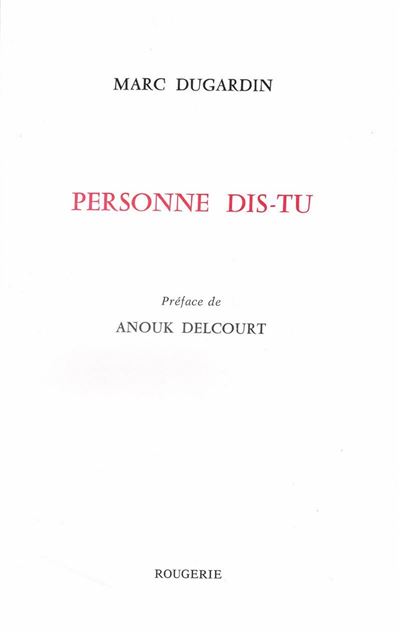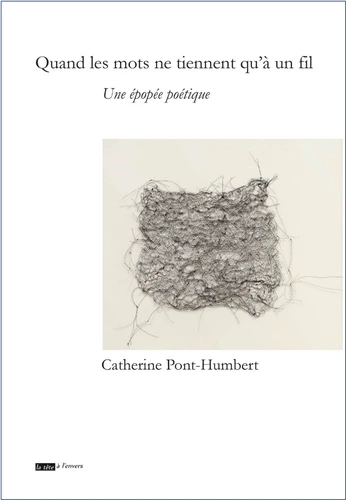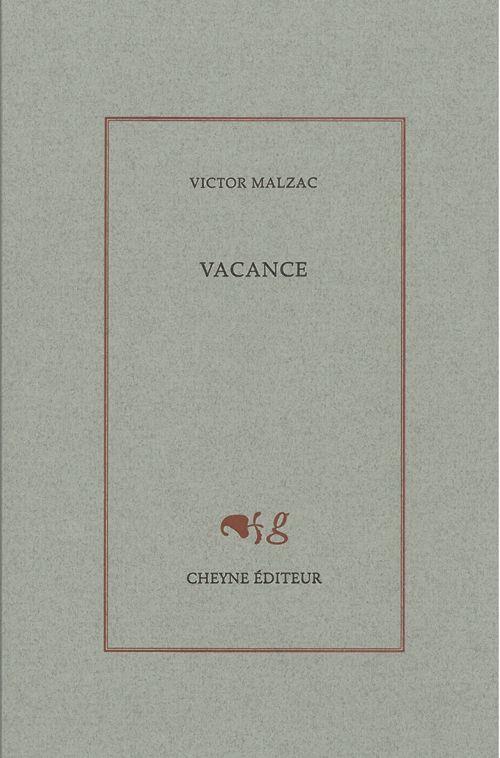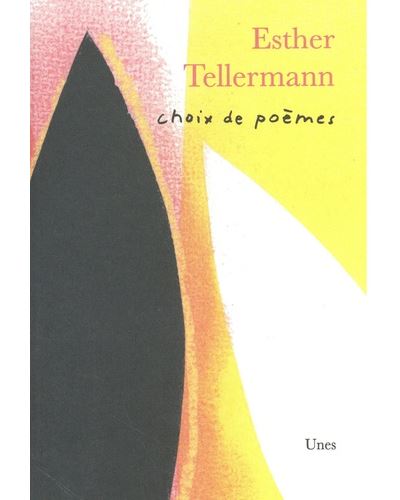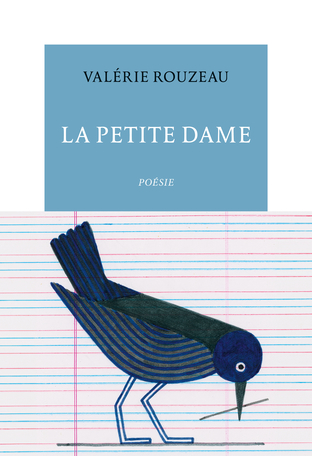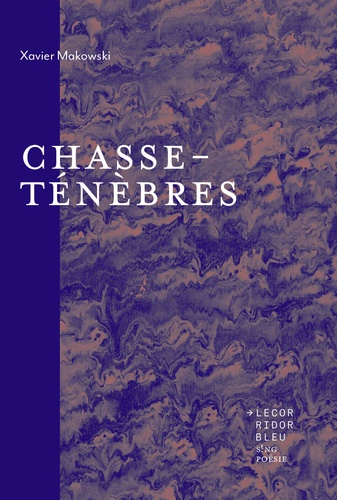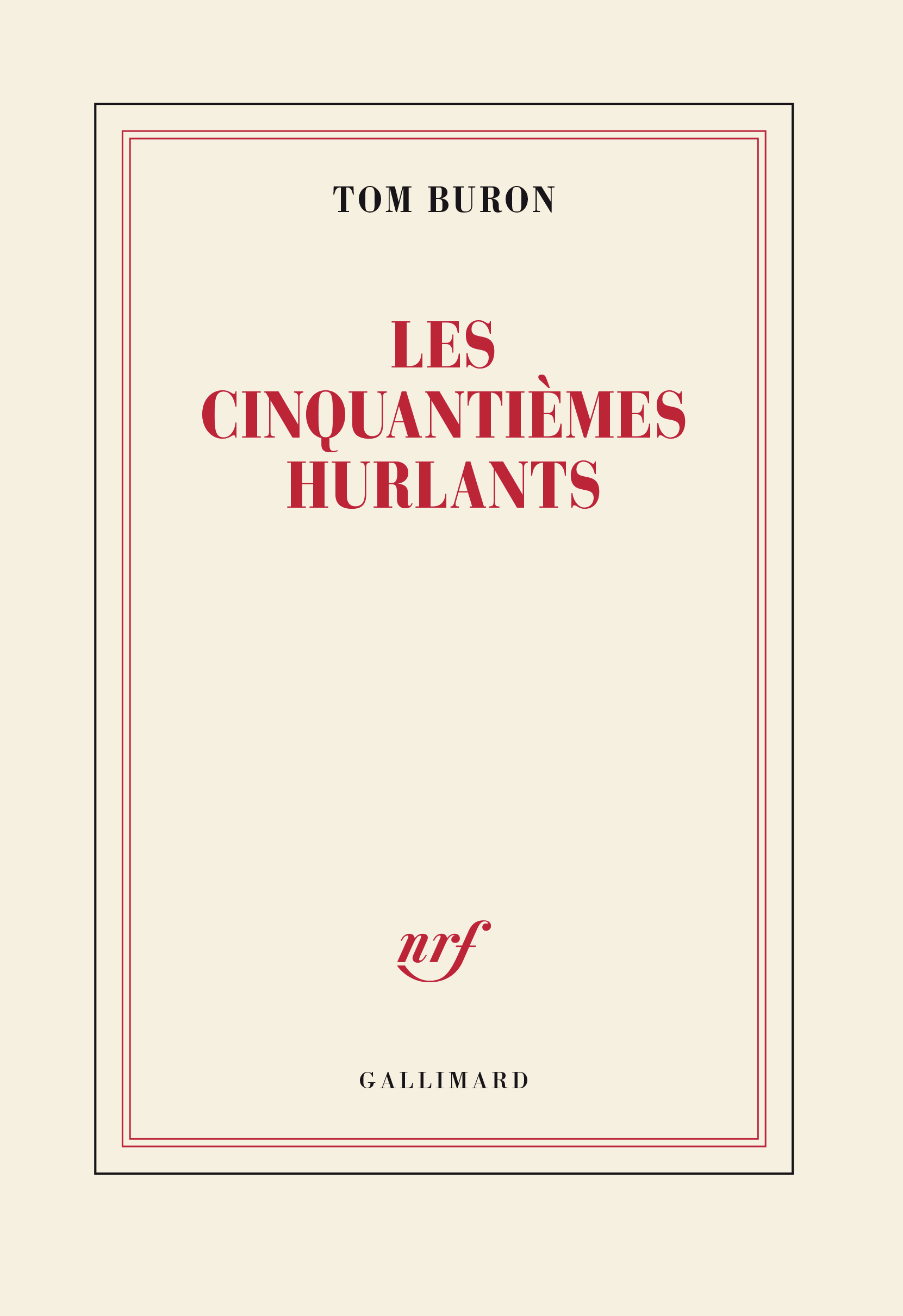Voilà une édition admirable en tout point, documentée, précise, fouillée, scrupuleuse, qui donne toutes les informations nécessaires pour aborder ces fragments d’un livre seulement « rêvé », sans se lancer dans des interprétations forcées et réductrices, telles qu’il en existe beaucoup.
Les annexes (des textes en relation avec les différentes sections du volume) puis un dossier (chronologie, notice, bibliographie, notes, index des noms, des œuvres et des lieux, index des notions et des thèmes) sont d’incomparable outils si l’on veut entrer plus profondément dans l’œuvre. Le pari d’une telle édition était pourtant difficile à tenir, s’agissant de textes qui n’existent qu’à l’état de fragments ou de notes et que l’on a trop souvent rassemblés, en leur donnant une unité factice, sous le titre de Journaux intimes, alors même qu’ils ne suivent aucun ordre chronologique et qu’ils ne présentent généralement pas de date. Les traditions éditoriales sont rappelées et expliquées, comme cette autre, due à Poulet-Malassis, qui a classé et numéroté les feuillets, installant un ordre qui n’existait pas. André Guyaux a adopté ce classement, qui est devenu inévitable, mais le commente en détails et refuse « le contresens qui fait recourir dans le commentaire à des formules telles que « “la première fusée” ou le “début de Mon cœur mis à nu” ». Si les séries Fusées et Mon cœur mis à nu sont bien distinctes, la série Hygiène, quelques feuillets aux titres fluctuants, qui présentent toutefois le mot « hygiène », est difficile à identifier si bien qu’elle a souvent été rattachée à l’une des deux autres. A. Guyaux, sur la base d’arguments solides, en fait un tout autonome et adopte comme principe qu’il faut « éviter de donner au texte le caractère achevé qu’il n’a pas ».
Le volume projeté, destiné à rassembler les trois séries est, selon l’expression de Baudelaire à sa mère, un « livre de rancunes », sous le double patronage d’Edgar Poe et de Joseph de Maistre. Les thèmes abordés sont constants de l’une à l’autre. Ils se déclinent avant tout en termes de « contre », contre le progrès en particulier : « la croyance au progrès est une doctrine de paresseux ». Baudelaire, admirateur du poète, déteste pourtant le Hugo qui le prône. Comment le progrès pourrait-il exister quand le mal est omniprésent ? Dans l’amour évidemment, ce qui explique l’intérêt pour Les Liaisons dangereuses : « La volupté unique et suprême de l’amour gît dans la certitude de faire le mal ». Mais c’est plus profondément la question du péché qui le retient, dans la ligne de Joseph de Maistre. Contre Jean-Jacques Rousseau (« Jean-Jacques – auteur sentimental et infâme », écrit-il dans De quelques préjugés contemporains, qui figurent aussi dans le volume, avec des Notes précieuses et des Notes sur Les Liaisons dangereuses), Baudelaire affirme que l’homme n’est pas bon mais d’une « indestructible, éternelle, universelle et ingénieuse férocité ». C’est là moins une réflexion morale que métaphysique ou plutôt théologique car c’est la question du péché, dont l’homme porte les « traces » si bien que nul n’est innocent, et surtout celle de la chute, dont le rire et le plaisir sont un signe, qui préoccupent Baudelaire. La chute, à ses yeux, est un mystère : « la création ne serait-elle pas la chute de Dieu ? » Il n’y a d’ailleurs « d’intéressant sur la Terre que les Religions » auxquelles ne s’oppose pas la superstition qui est, paradoxalement, « le réservoir de toutes les vérités ». Autre constante, la critique de la femme : comme le commerce, « la femme est naturelle, c’est-à-dire abominable », elle est le « le contraire du dandy ». Baudelaire n’a pas de mot assez dur pour la « femme Sand », « cette latrine ». « Le bon sens », « le cœur », dont il faut se méfier, nul plus que la femme, le peuple et le mauvais poète, qui croit à « l’inspiration », ne les incarnent. La question du Beau revient souvent : « J’ai trouvé la définition du Beau, – de mon Beau. C’est quelque chose d’ardent et de triste, quelque chose d’un peu vague, laissant carrière à la conjecture. » Et encore : « Le mystère, le regret, sont aussi des caractères du Beau », en association avec le Malheur. L’écrivain, c’est celui qui a un « coup d’œil individuel », puis une « tournure d’esprit satanique ».
Au centre de la réflexion, se situe en effet l’individu, qui seul pourrait connaître le progrès : « Il ne peut y avoir de progrès (vrai, c’est-à-dire moral) que dans l’individu et par l’individu lui-même. » Mais l’individu Baudelaire est pris entre des tendances contradictoires et lutte pour substituer à la menace de la « vaporisation » du moi la « centralisation », c’est-à-dire la concentration. La méthode, l’hygiène prônées reposent en grande partie sur le travail, malédiction inévitable et seule ressource à la proscratination et au spleen : « Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s’amuser », affirmation que Musset, que Baudelaire détestait et qu’il qualifiait de paresseux, aurait pourtant pu prononcer. Le taedium vitae, et l’acédie, ne sont pas seulement la maladie des moines.
Si la concentration est difficile à atteindre en ce qui concerne le moi qui se disperse, elle caractérise au moins le style, qui est celui de la maxime. Pas de véritable confidence sur soi, mais une suite de réflexions sous forme d’aphorismes, souvent paradoxaux et provocants, empreints d’une férocité souvent ironique : « Être un homme utile m’a toujours paru quelque chose de bien hideux », « Les nations n’ont de grands hommes que malgré elles », « Dieu est le seul être qui, pour régner, n’ait même pas besoin de régner »… On pourrait les multiplier. Toutes révèlent une profonde souffrance et un mal-être, si bien que si ces pièces qui offrent un intérêt littéraire et intellectuel essentiel et suscitent la réflexion, entraînent aussi l’émotion devant un poète torturé, en proie à la souffrance et au mal-être, à la « colère » et à la « tristesse », pour reprendre ses mots. Colère et tristesse, n’est-ce pas notre lot quotidien ?
- Jeanine Baude : Soudain - 6 juillet 2023
- Charles Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes - 1 juillet 2022
- Nos aînés (1) : Roger Caillois - 4 juillet 2021
- Jean-Charles Vegliante, Où nul ne veut se tenir - 1 mars 2018
- Henry JAMES : Carnets - 16 octobre 2016
- Jean-Charles Baudelaire, Fusées, Mon cœur mis à nu et autres fragments posthumes - 20 septembre 2016
- Abdellatif Laâbi, L’arbre à poèmes. Anthologie personnelle, 1992–2012 - 3 avril 2016
- Ingeborg BACHMANN : Toute personne qui tombe a des ailes - 21 février 2016
- Jacques Darras : La Transfiguration d’Anvers - 7 janvier 2016
- Fil de Lecture de Joëlle Gardes : Esther Tellermann, Emeric de Monteynard, François Perche, Jean-Charles Vegliante - 5 janvier 2016
- Philippe Leuckx : L’imparfait nous mène - 22 décembre 2015
- Jeanine Baude : Soudain - 11 novembre 2015
- Roger Gilbert-Lecomte : La Vie l’Amour la Mort le Vide et le Vent et autres textes. - 10 octobre 2015
- Nos aînés. La modernité de Racine, par Joëlle Gardes - 6 septembre 2015
- Nos aînés (5) - 4 novembre 2014
- Nos aînés (4) - 19 mai 2014
- Nos aînés (3) - 31 décembre 2013
- Nos aînés (2) - 22 septembre 2013