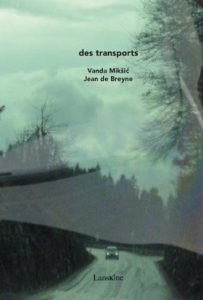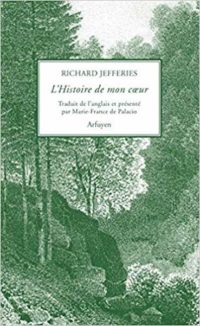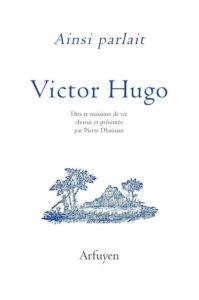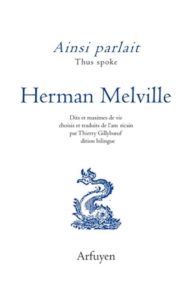Hölderlin : une voie vers les cieux
Le hasard des rencontres n’est jamais vraiment fortuit, et il obéit à une espèce d’impact intérieur qui trouve sa justification dans la proximité des textes. Ici, cette traduction métrée de C. Neuman des Élégies de Friedrich Hölderlin suit une autre de mes lectures récentes, celle d’un anglican du XVIIe, Thomas Traherne, qui lui aussi porte son regard vers le haut, vers une essence divine comprise comme céleste, comme une transcendance presque sublime.
Les deux auteurs prônent une patrie spirituelle, à la fois aérienne et cependant accessible, humaine, presque matérielle. Ainsi, le goût du vin et du pain compose, par exemple, pour le poète, l’eucharistie, comprise comme une élévation, laquelle suppose un ordre théologique inhérent. Ici, ce dieu a pour patrie les coteaux qui bordent le Rhin, un Rhin préromantique et qui masque peut-être une idée de la germanité.
Allégorie de l’Allemagne, sorte de Grèce antique revécue, comparable à l’Occitanie de Simone Weil qui voit dans la Toulouse et l’Albigeois du XIIIe le talent de faire revivre, d’actualiser une vraie renaissance de la Grèce hellénistique. Nonobstant, ces élégies portent un regard vers le sommet, vers le monde éthéré des cieux, des ciels augmentés d’une présence supérieure.
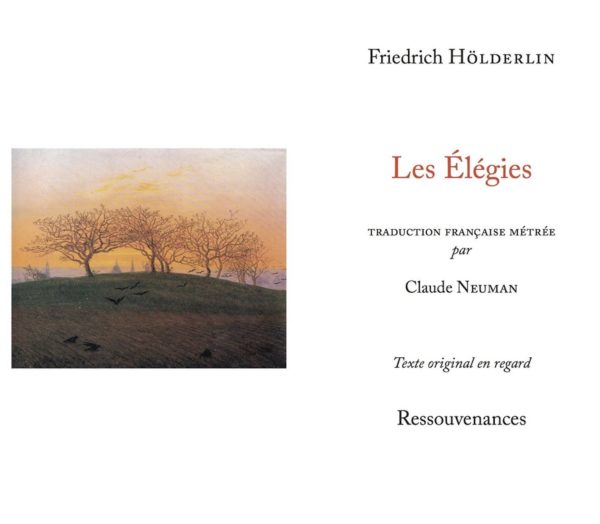
Friedrich Hölderlin, Les élégies, trad. métrée
Claude Neuman, éd. Ressouvenances, 2020, 20€
Cette poésie, ici traduite dans le mètre original, implique un univers qui s’agrandit à la présence, à la grandeur du poème et du poète voyant, qui déjà peut se prévaloir d’une hauteur de vue, d’un ton prophétique, celui qui sera propre aux romantiques qui viendront. Est-ce là habiter le monde en poète ? Très certainement car cet univers céleste se véhicule du poème vers le poète, de la vie du poème à la vie de l’homme, prophète en quelque sorte, prophétisant sa propre nature. Ce sont des poèmes de l’Ouvert, poèmes de l’air, du chant. Ces élégies portent en elles une promesse, prédisent ce qui doit advenir au poète, un poète habitant le monde dans l’agrandissement de son poème, augmenté d’une expression de l’air, de songes aériens. Certes, cette ivresse des sommets, la divagation au milieu des Ménades, dans la proximité des vignobles du Rhin, initie, en un sens, le vertige qui prendra le poète jusqu’à sa folie.
Et ce discours me poussa à chercher ailleurs encore,
Je montai en bateau au lointain pôle Nord. Là dormait
Silencieuse en sa coque de neige la vie enchaînée : ce sommeil
De fer attendait le jour depuis des années.
Et comme j’évoquais en préambule le hasard étrange où butent les lectures, il me revient à l’esprit, au sujet de la langue traduite, qui sonne particulièrement ici, un même effet de surprise de la traduction de Maurice de Gandillac travaillant à rendre en français l’énigmatique Zarathoustra de Nietzsche. Ce français métré sonne avec suavité, écriture capiteuse, presque entêtante. De plus, cette association avec Nietzsche pourrait se poursuivre au-delà des effets de la traduction. En effet, le poète du Neckar pourrait très bien se trouver parmi les hôtes de la grotte mythique de Zarathoustra. Car lui aussi cherche la vérité dans la profondeur, et lui aussi atteignant le sommet, tombe dans la folie, laquelle n’est autre qu’une fuite, une échappée vers où ce trop d’angoisse du fou se transforme en chant du cygne. Cette combustion de la raison est nécessaire, car elle consume l’équilibre trop humain de la parole dans le monde. Elle va vers le poétique. Elle est fruition de la parole, fructification matérielle des vignes du Rhin, et c’est là la seule chose qui importe, car cette poésie est devenue immortelle, aussi forte qu’un vin.
Encor fructifient mes pêchers, leur floraison m’émerveille,
Le buisson de roses se dresse superbe, presque arbre.
Lourd de fruits sombres, entre-temps, s’est fait mon cerisier,
Et aux mains du cueilleur ses rameaux se tendent d’eux-mêmes.
L’ascension du poète, comprise comme la progression du Voyageur contemplant une mer de nuages de C. D. Friedrich, pourrait se concevoir comme le deuil de la raison, car cet oxygène manquant aux sommets des montagnes provoque à la fois le vertige et la mort. D’être trop près des points culminants, renouvelle la figure d’un Icare brûlé par son vol mythique.
Et le trésor, l’Allemand, sous l’arche de la paix sainte
Qui repose, est l’épargne des jeunes et des anciens.
Je parle en fou. C’est la joie. Mais demain et à l’avenir,
Quand nous irons dehors voir ferme et champ
Sous les fleurs de l’arbre, aux jours de fête, au printemps, mes aimés,
Nous en parlerons et en attendrons beaucoup.
Beauté sans doute des images impossibles, des pays sans connaissance, où vivent des dieux apaisés, pays étrange où pourraient se rendre Bacchus et Ariane, figures du Titien, dans ce déséquilibre sublime et improbable de toute fiction poétique.