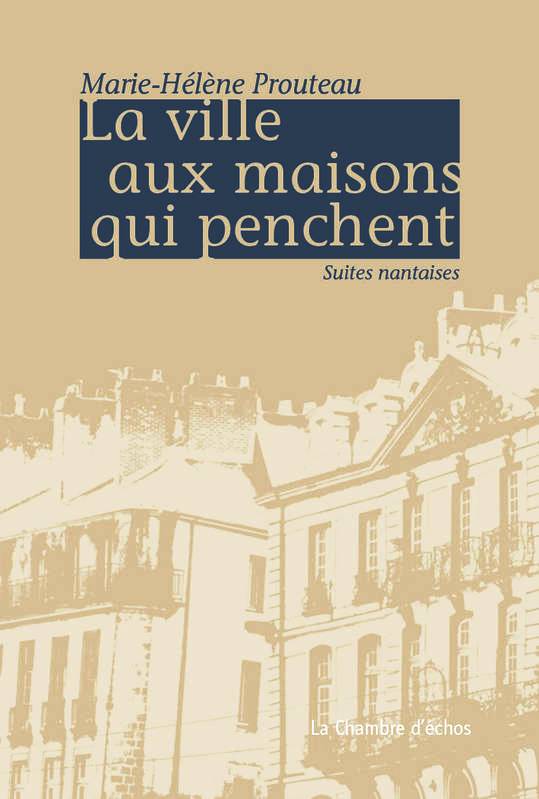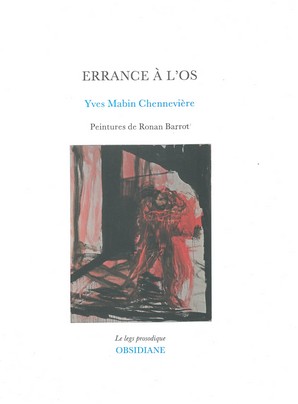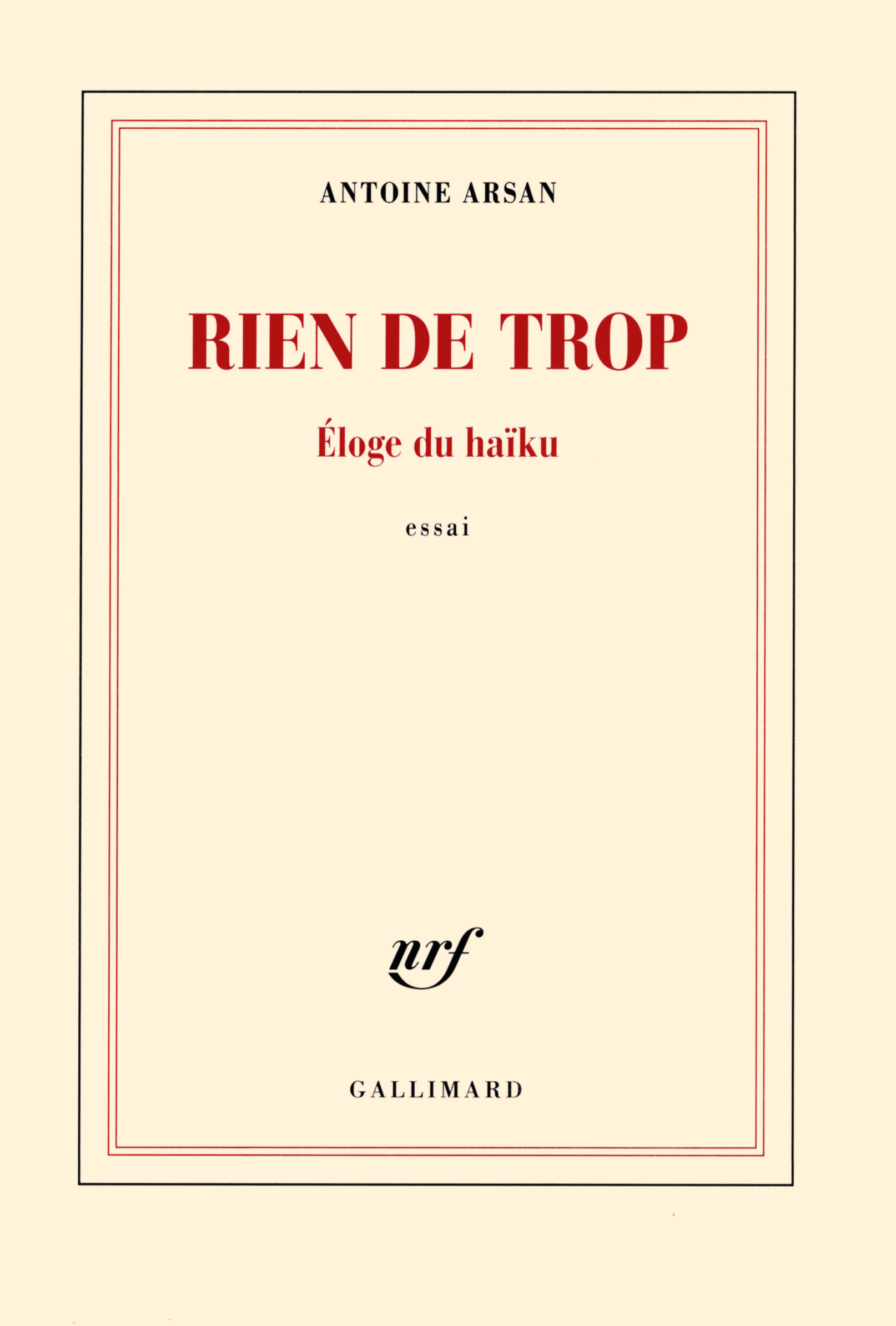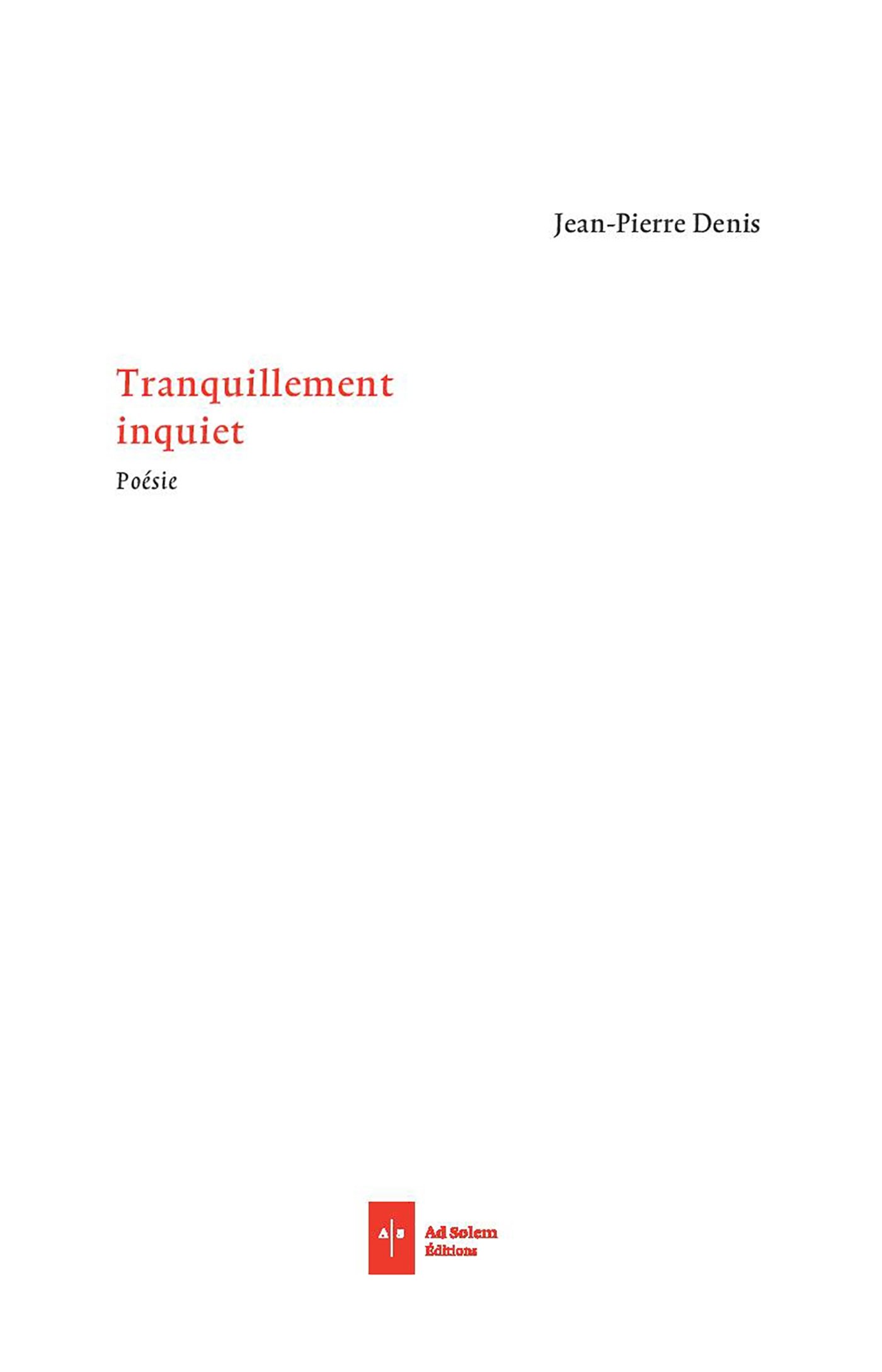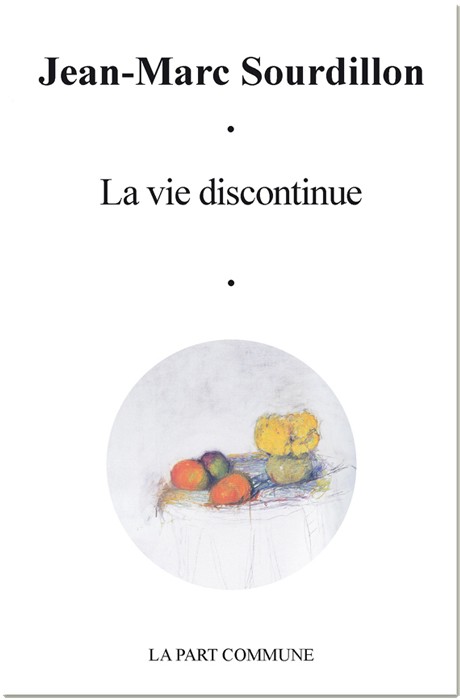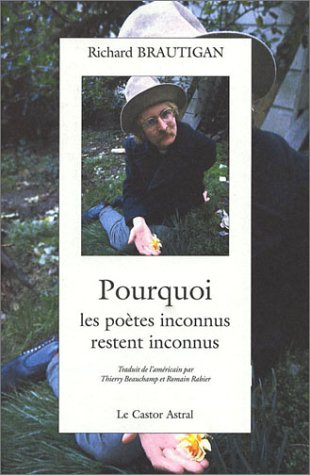Gérard Mottet, “La poésie, ce lent déchiffrement de l’absence…”
« Gérard Mottet, en ce recueil, nous suggère que la voix seule du poème accorde chair et souffle / de présence à l’inexistant… aux brumes de l’imaginaire… aux possibles dévoilements. » Chair et souffle : mots révélateurs de ce qui sous-tend les Murmures de l’absence.
Ce souffle est porteur d’une voix qui s’abandonne volontiers au flux des images, à une parole spontanée évoquant aussi bien des gouffres infinis que les presque riens de tous les jours. Revenant avec insistance sur le thème de l’amour (vécu comme une absence / au creux de moi), la voix se trouve plus ou moins doublée par une voix en écho – un répons lointain perçu tel un halo harmonique. Combien mieux je te vois rayonnante / dans la lumière de l’absence… Une lumière née de l’ombre, et que le poète sait rendre visible. » Michel Passelergue
Ensemencer le vent d’une graine incertaine apprivoiser la ténébreuse l’inévitable solitude et les yeux grands ouverts l’âme chargée de souvenirs apprendre à vivre dans l’absence.
Ce recueil de Gérard Mottet, édité chez Tensing, sera suivi de deux autres volumes qui lui sont associé. Nous saluons ici Eric Jacquet-Lagrèze, fondateur en 2010 de cette maison d’édition, décédé en mai 2017. Eric Jacquet-Lagrèze avait donné ce nom à sa maison d’édition « en l'honneur du sherpa népalais Tensing Norgay, vainqueur de l'Everest en 1953 avec Edmund Hillary, soulignant ainsi le choix initial de publier des livres de montagne et le souhait de faire découvrir par le récit ou la fiction des pays, les hommes et leur culture. » Il créa cependant une collection poésie, autre façon de partir à la rencontre des autres et de soi.