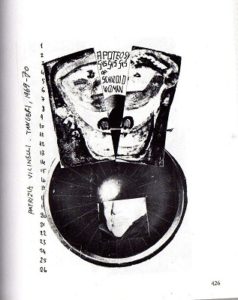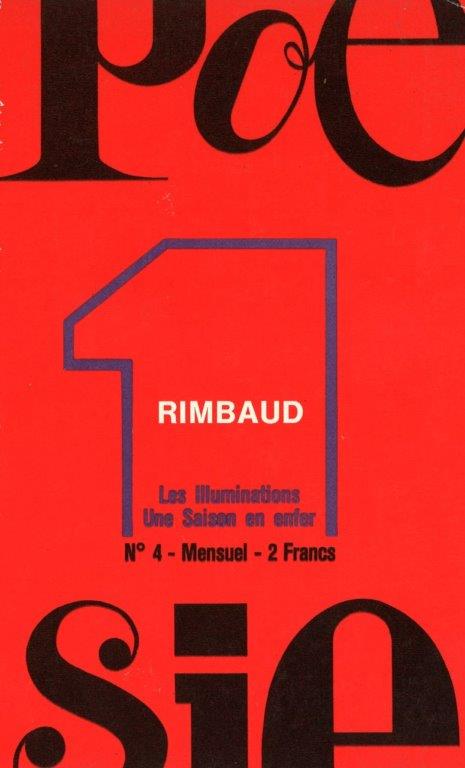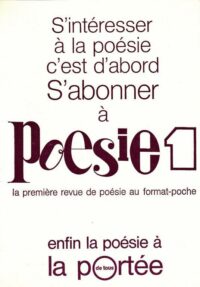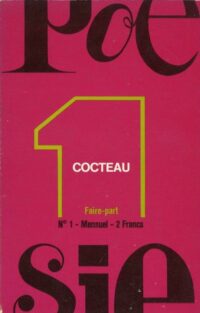Avec ‘Une autre poésie italienne’ : trois poètes italophones
José Carbonero, de son vrai nom Giuseppe Carbonara, qui a utilisé pour ses œuvres poétiques initiales le pseudonyme de Gregorio Carbonero, est né au Venezuela (Boconó 1953) de parents italiens émigrés dans les années 50. Après ses études de Physique et de Musique, il entreprend une carrière de hautboïste dans des orchestres symphoniques et de chambre, d’abord dans son pays natal, ensuite en Italie, où il s’installe dans les années 90. lI s’y consacre à l’enseignement musical, ainsi qu’à l’écriture en italien. Le premier pas vers la reconversion poétique de Carbonero a commencé donc par son propre nom, voire par ses noms, des pseudonymes rendant impossible l'instauration d'une correspondance officielle, “certifiée” avec la réalité, dépourvus de la force nécessaire pour convaincre de son existence. L’expérience familiale et personnelle de la migration est en effet pour Carbonero celle d’un “effondrement, une vidange soudaine, une interruption. La sortie d’une conscience séparée qui demande de s’expliquer-expliquer sa propre vie” (Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Florence, Le Lettere, 2009). Pour permettre cette “explication ”, le poète recourt aux vers en italien afin qu'ils fassent appel, plus qu'aux faits concrets, à la trame sensible du souvenir, qui émerge grâce à la résonance musicale de la nouvelle langue. Le voyage du migrant “de retour” représente, à bien des égards, une remontée de l'outre-tombe, vers une nouvelle hypothèse de temporalité. Le fait d’écrire dans sa langue maternelle devient ainsi pour le poète une manière de stipuler un accord, de s'enraciner dans un en deçà reconnaissable. C'est un processus délicat, en équilibre constant par rapport à la désagrégation du sens, entièrement confié au pouvoir des mots nouveaux. Carbonero avait entendu ces mots, presque clandestinement et sans les utiliser, chez lui, l'italien étant perçu comme une langue pour gueux, devant rester enfermé entre les murs domestiques comme le deuil qu'il revêtait . Arrivé en Italie, après avoir passé un an à Bari chez ses proches des Pouilles, le poète se déplace à Fano puis à Crémone, où il est resté pendant presque vingt ans, et enfin à Ghedi, en province de Brescia, où il vit toujours. L'Italie, du Sud au Nord, se dévoile à lui telle une exposition de réalités variées, et parfois contrastées, avec les mots qui les représentent. La fragilité, la perméabilité identitaire, amplifiée par un pays qui ne coïncide pas avec celui, certain et immobile, que la mémoire familiale a transmis, pousse la poésie de Carbonero à s'ancrer solidement dans un quotidien fait de petits choix incertains, de gestes douteux, pactisant chaque fois avec le vertige de la mémoire, avec le présent comme altérité et la nouvelle langue maternelle d’un “italiano straniero”. Les textes de Carbonero sont publiés, encore sous le nom de Gregorio, dans le recueil Nervature (Rome, Zone, 2006, préf. C. Bordini, dernier volume de la collection “Cittadini della poesia” dédiée à la poésie transnationale italophone, que j’ai dirigée à partir de 1998 ; et dans l’anthologie Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano (cit.), toujours sous ma direction et avec la postface de F. Sinopoli, qui réunit la production poétique d’une vingtaine de poètes transnationaux en italien. Récemment, sous le nom de José, Carbonero a auto-publié deux recueils électroniques : Dio gioca ai dadi (truccati) et Litania e Scarabocchi (Streetlib Selfpublish, 2015).
* * *
Si, en tournant à l’angle
Tu t’es trouvé quelquefois à la moitié du chemin de quelque chose
et tu risquais de perdre la voie droite ? Et par esprit de contradiction
ou pour te rassurer tu as tourné à l’angle ?
Mais tu l’avais, toi, la voie droite ? Ou tu es un qui, dans le tas
va par de faux raccourcis, ce n’est pas à tout le monde qu’est offerte (semble-t-il)
la voie droite,
ne viens pas me dire après, pas la rengaine habituelle
que tu le sentais, que c’est ainsi pour toi, que tu y es en plein
que tu le savais (non, au moins ça ne le dis pas).
Si tu démêles l’écheveau le fil disparaît ?
Tourner était prévu, qu’il y eût un dessein
ce n’est pas sûr, quoique, toutefois…
Si tu tournes la page tu peux te passer de tes souvenirs
là où de toi est un souffle, au moins ou à peu près ? Et en lui
un bord taché de rouille, et dans la rouille
un moulage et encore, encore une empreinte qui changeait
et qui ne fut jamais mienne ?
Pourquoi ai-je dû attendre ?
Je tournais autour de moi-même,
une main pleine, l’autre vide,
ma main pleine cherchait la vide,
elle la savait plus sûre, inévitable,
c’est pourquoi j’ai dû attendre
pour comprendre ensuite que ni l’une ni l’autre n’étaient miennes.
La personne que je ne suis pas
mais un peu plus maigre, des gestes moins mesurés
se vit marqué par un geste
ou deux, un trait soulignant un mot
répété, un cercle
où la phrase était trop évidente et ce n’était pas
chose à supporter,
presque futile presque inutile, survivre sembla
un miracle.
(de Nervature)
***
Paysage
Aujourd’hui je n’ai que fuyantes ébauches de réalité
aujourd’hui tout paysage semble m’échapper
aujourd’hui m’échappent les lieux qui devraient
être miens et rester près de moi.
De la grille descend sur la plage un dégradé de gris
vers un ourlet d’écume et de sable mouillé
s’immerge le ressac en une lumière faible sans limites.
Une respiration légère,
à peine quelque chose qui se sépare.
Le rivage se dépouille, effleure le reflet
qui encore subsiste.
Aujourd’hui le couchant est un azur coulé à pic
une couleur déliée effacée,
il utilise peu de signes de vie.
À la fin pliée et éteinte,
la plage récupère, se renouvelle,
écorces humides, restes gonflés d’eau salée, ce détrempé
ramené à la surface par une autre marée, d’autres plantes,
autres, sur un autre rivage.
(de Nervature)
***
Persistances
Tu sais que si tu effleures cet air de fil
chaque chose va se défaire en mots.
C’est ainsi tout s’embrouille et perd
la forme qui nous accueille, qui nous permet.
Ainsi va l’oubli cultivant ses obscures fourmilières
et tu ne le comprends pas, tu ris et ignores sa compassion.
Lui enfile le fil dans le chas quand tu t’endors
cuit miel et parcimonie et toi, toi tu ne le sais pas.
(de Litanie e scarabocchi)
(Trad. J.-Ch. Vegliante)
* * *
Médecin et chirurgien en Albanie, et à partir de 1999 chercheur à l'Université de Padoue, Arben Dedja (Tirana 1964) est traducteur de l’anglais et de l’italien, et poète. Dans son premier recueil publié en Italie, La manutenzione delle maschere (“L’entretien des masques”, Bologne, Kolibris, 2010, sous ma direction), l’histoire politique albanaise s'avère être la protagoniste, mais d'une certaine manière déconstruite, comme le soulignent les masques du titre, réinterprétée par le filtre de la démocratie des destins, grâce auquel la polémique sociale sert plutôt à présenter une humanité où les “derniers” incarnent les victimes d'une congénitale stupidité d'espèce. “L’entretien” entrepris par Dedja, est un exercice démystifiant implacable, opéré avec scientificité à travers la procédure de l'autopsie, c’est-à-dire par l’intermédiaire de la décomposition anatomique, impartiale de la matière – et on fait référence à ce propos au titre de son volume de récits Amputazioni prolungate (“Amputations prolongées”, Lecce, Besa, 2014) – au moment où la réalité de la mort confère à chaque chose la place qui lui est due. La poésie colloquiale et anti-lyrique de Dedja refuse un engagement affecté pour atteindre avec un réalisme caustique les “bas-fonds” de la condition humaine. Une poésie bilingue – et l'italien, né au début comme auto-traduction en regard de l'albanais, devient de plus en plus prioritaire – qui a en réalité des racines profondes dans l'italophonie, et qui y joue avec une simplicité exhibée, apparente. Dedja aime raconter, en effet, que dans son enfance albanaise, avec la chute des certitudes à propos de l'instruction imposée par le parti, s'était répandue l'habitude de confier ses enfants à un enseignant libre, un instituteur qui appartenait souvent aux classes sociales renversées, ou un ancien communiste tombé en disgrâce, qui leur dispensait l'enseignement des langues occidentales. Avec son Maître, le poète s’était trouvé impliqué dans des très longues leçons où l'étude de l'italien était abordée en comparaison de l'anglais, du français, du turc, et des règles élémentaires de grammaire ouvraient des passages dans toutes les directions du savoir, des arts. Un apprentissage omnivore et plurilingue, sur lequel, au fil des ans, Dedja reconstruira une stratification de mondes poétiques destinés à donner, avec une compassion ironique et une simplicité méprisante, sur les vers italophones. Et ce n'est pas un hasard si son dernier recueil poétique s’intitule The vanishing twin (Lecce, Besa, 2015, sous ma direction), en référence au syndrome du “jumeau perdu”, celui des deux fœtus qui meurt et est absorbé par la croissance de l'autre. Dans ce livre, l'anglais, fréquenté à travers son activité de traducteur, est marqué dès le début comme une composante importante de l'humorisme et des dramatisations grotesques des textes ; alors que l'allusion au syndrome est un puissant renvoi au simulacre fragile de tout ce qui a été dans le passé de sa langue maternelle, corps éthéré d'une identité mobile, reversé dans la voix poétique jumelle survivante, laquelle saura s'en charger, et qui, en l'absorbant, le transformera pour pouvoir grandir dans la langue nouvelle.
***
Élégie cruelle pour mon père
1.
J’ai lavé mon père mort
un matin de mars, les engelures
de l’hiver encore aux pieds
et justement je commençai par les pieds
– eau et savon – jusqu’à ce qu’il sente
l’odeur du détergent, puis entre les cuisses
j’ai effleuré à peine les testicules en cette
occasion pour la première fois dévoilés
je l’habillai en chemise et costume
le meilleur, en lui tenant droite
la tête, qu’elle ne retombe pas sur la poitrine
je l’étendis sans-montre-et-sans-bague
je coiffai ses cheveux blancs je le rasai
à sec je haletai sur ses souliers
neufs trois-manches-de-cuillers-cassés et
à la fin lui mis une cravate après
avoir fait d’abord le nœud sur
mon cou.
2.
Père mien quand tu mourus
nous t’avons gardé vingt-quatre heures
chez nous pour te rendre les derniers
honneurs, une longue veille
mais dehors l’hiver abandonnait
la terre si bien qu’à minuit
nous éteignîmes le chauffage, entre nous
recroquevillés pendant que quelqu’un
répandait des parfums dans la pièce
le couloir la cuisine l’autre pièce
le monde entier.
3.
Mon père pleuré quand tu mourus
ce ne fut pas une mince affaire
de te descendre par les escaliers étroits de l’immeuble
construit avec les travaux forcés de l’époque
hodjienne, un cousin au septième
degré juché sur les barres
de la fenêtre du voisin se chargea
de diriger les opérations, le menuisier
du cinquième étage démesura
avec un mètre les angles du calvaire
un martyr mit son dos
sous le cercueil mais de toute façon
la lampe fut quand même cassée
dans l’escalier et le crépi
rayé pendant que toi là-dedans tu bougeais
un sac de noix posé sur la tête
qui selon l’usage
devait sortir la première.
(de La manutenzione delle maschere)
* * *
Emilio Salgari
On l’a trouvé dans son bain tout moisissure
ce lointain 25 avril 1911
suicidé en une espèce de hara-kiri avec son rasoir à barbe
comme dit-on faisaient les héros
de l’Orient Extrême que, sans jamais y aller, il décrivit,
parce que presque ainsi Sandokan tua le Tigre,
parce qu’ainsi l’imagination s’est noyée dans la prose,
parce qu’ainsi les usuriers sont plus réels que les trésors,
parce qu’ainsi les éditeurs accouchent de charognes,
parce qu’ainsi les chiffons deviennent célèbres en essuyant du sang
[d’écrivain,
parce qu’ainsi vraiment triomphe la quotidienne banalité du rasage.
(de La manutenzione delle maschere)
* * *
Le discours du leader
On mangeait de la pastèque dans les derniers rangs.
L’atmosphère était celle des
moments historiques :
la salle dans la pénombre
prête à être illuminée
par la marée des applaudissements.
Au premier rang
on remarquait une fatigue
de fesses pendantes
parmi les vétérans.
Quand au milieu
d’une longue phrase il fit une pause
et respira profondément on entendit
le tic tac
des coupe-ongles (invention chinoise).
(de La manutenzione delle maschere)
(Trad. J.-Ch. Vegliante)
* * *
Pour Eva Taylor (Heiligenstadt 1956) – installée, depuis les années 1980, à Florence, où elle vit actuellement, professeur de langue allemande à l'Université de Bologne – on peut dire que l'usage littéraire de l'italien précède chronologiquement, hormis l’exception de quelques rares textes, celui de l'allemand, en inaugurant d’ailleurs sa production poétique. L'italien est, de ce fait, l'instrument qui permet à Taylor de revenir sur ses pas pour affronter l'histoire privée et collective de sa langue maternelle tout en se réconciliant pleinement avec son poids historique. C’est à cause de son propre parcours biographique que la relation de Taylor à l’allemand se caractérise par une attention portée aux superstructures conceptuelles liées au rôle de cette langue dans l'histoire du XXème siècle. Le premier accroc existentiel de cette poétesse remonte, en fait, à son enfance, lorsqu'elle est contrainte de fuir l’Est avant la construction du mur. Toute son histoire familiale, qui forge la matière du roman autobiographique Carta da zucchero (Ravenne, Fernandel, 2015), est vécue à partir de ce moment “à rebours”. La migration en devient l’expérience fondatrice, et le fait qu'elle se produise à l'intérieur d’un seul pays, dans un contexte linguistique également germanophone, fait en sorte que le rapport avec la langue est compromis : bien que langue maternelle, l’allemand devient ainsi une langue d'acceptation contrastée, que Taylor définit comme “langue-marâtre” pour le manque d'une relation “de sang”, naturelle, et l'impossibilité de s’y réfugier afin de trouver le repos dans le berceau des sons rassurants de l'enfance. Ce sera en revanche la rencontre avec l'italien, amenée par la seconde expérience migratoire, qui renouera les liens les plus profonds, grâce justement à ce qu’il représente au niveau rythmique et musical. Les dynamiques et les raisons de l’expression plurilingue sont abordées par Taylor dans son premier recueil italien L’igiene della bocca (“L’hygiène orale”, Brescia, Ed. l’Obliquo, 2006), qui naît de la comparaison intertextuelle avec un livre spécialisé dans les pathologies odontologiques trouvé dans la salle d'attente d'un cabinet dentaire. Les poèmes de Igiene della bocca se concentrent, au sens figuré, sur l'aspect médico-stomatologique de la communication grâce auquel Taylor peut se permettre de “creuser” dans l'instrument de l'articulation linguistique, la bouche, pour remonter des mécanismes du dire jusqu'à ses raisons, et à ses résultats. Le recueil suivant, Volti di parole (“Visages de mots”, Brescia, Ed. l’Obliquo, 2010), intègre tous les aspects de la distanciation existentielle résultant de la migration ; la section “Ricettario minuto” (“Petit livre de recettes”) de ce dernier, en particulier, est construite sur le modèle du déroulement de composition de L’igiene della bocca : l'idée vient d'un autre genre textuel particulier, celui des recettes culinaires, en s’inspirant duquel Taylor produit des précis inutilisables de différents aspects de l'aliénation quotidienne. La question linguistique reste donc la matière fondatrice de toute la poésie de Taylor, qui, au delà de la rhétorique facile de la beauté et de la nécessité du cosmopolitisme plurilingue, se concentre au contraire sur son aspect de douleur, sur toutes les tensions, les vertiges que celle-ci comporte. Un choix de poèmes d’Eva Taylor a paru en France dans le recueil Arguments pointus (Paris, Le hasard d’être, 2014, trad. J. Spaccini & A. Panek). Elle fait également partie du groupe “Compagnia delle poete” (www.compagniadellepoete.com).
* * *
J’ai deux bouches
par l’une je parle
par l’autre je saigne.
Ce matin j’ai choisi le rouge à lèvres le plus rouge
pour couvrir les traces de sang.
Tu m’as regardée et tu as dit :
tu es bien.
(de L’igiene della bocca)
***
Dans le noir
j’essaie de vous prendre,
paroles
liquides nagées
évaporées
vous vous posez
sur le bord de ma bouche,
amours toujours lointains
filles désobéissantes.
Vous affleurez cachées
en bonbons colorés
suçotés un à un.
La langue
ne distingue pas bien
votre goût
elle vous tourne et retourne jusqu’à la nausée.
Et quand la main ne vous trouve pas
vous redevenez ce que vous êtes :
couronnes dans une bouche édentée,
prothèses pour broyer la vie.
(de L’igiene della bocca)
***
Loin de chez soi
Tu as vu, disait la mère,
tu as entendu, disait le père :
ils cherchaient un pays derrière les pierres.
Loin du lieu destiné
en mouvement nocturne vers ailleurs.
Fuir, disaient-ils, et :
si nous étions restés.
Entre ces deux phrases
j’erre sans but.
(de Volti di parole)
***
Recette pour poisson hors de l’eau
La plupart des poissons est muette.
Laissez-le bouillir quelques instants
faites-le refroidir dans l’eau de cuisson
enfin versez-le dans l’alphabet.
Il apprendra à nager, à respirer et à parler
mais il aura toujours l’impression
d’être quelque chose d’autre.
Son léger goût d’amertume
que certains apprécient
et d’autres trouvent écœurant
vous fera penser à un accent.
On peut le supprimer avec un filet d’huile d’olive.
Extra-vierge, pression à froid.
Mieux encore très froid. Presque comme d’eau.
(de Volti di parole)
(trad. J.-Ch. Vegliante)