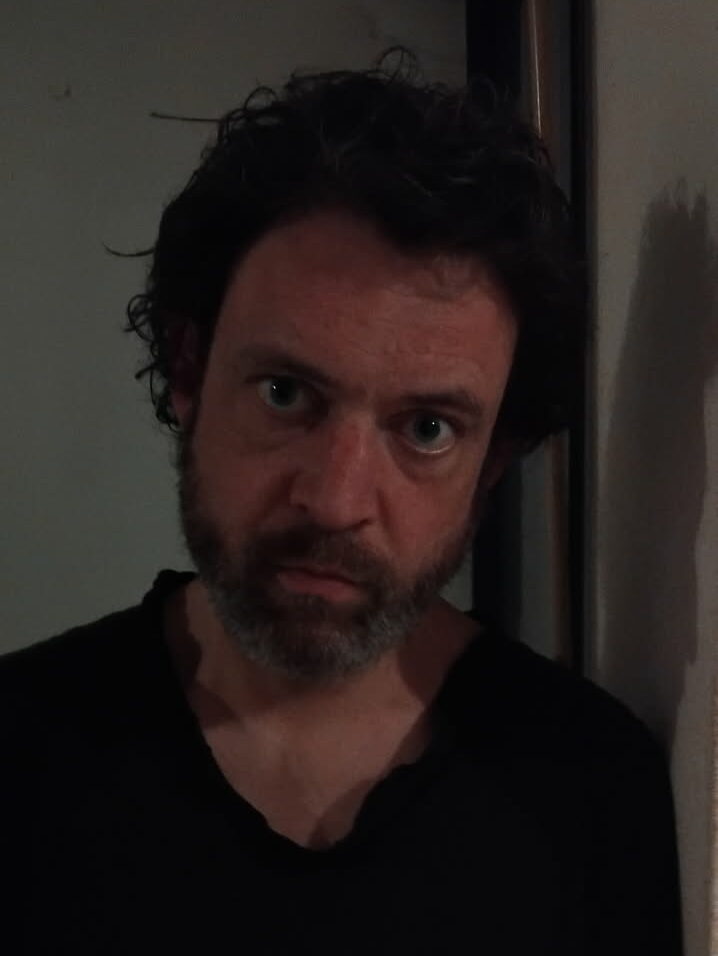Et la tourneuse langue des saints tombés avec les
allumettes ont failli incendier le vrai ciel tellement
déchiré de sermons bien administrés à la meilleure
jeunesse. Non que l’obstructionnée jeunesse sache
dire qui sera son père, qu’elle hait, mais elle sait
reconnaître sa mère, qui l’allaite. Je vivrai avec
une multitude tout en restant bien clair, dit alors
ce requin qui n’est plus en vie. Dans le caractère
c’est, de survoler les étoiles, que ma volonté soit
la reine des étoiles et des nuits. Je n’ai aucune espèce
d’appel et aucun credo par où commencer mon long
appel, aussi, silencieux soyez royales nuits comme la
fleur qui défleurit.
Il parle de lui-même en un lugubre monotonage,
je fleuris les vers d’autres altitudes, les externes
ennuis, élucubrations, automobiles ; qu’est-ce qui
m’a pris ce jour dans la fine poussière d’un après-midi
pluvieux ? Sous le rideau le poisson chante, sous le cœur
le plus pur chante la libre mélodie de la haine. La vengeance
salée, l’intellect assoupi, les rimes dénonciatoires seront mes
plus fidèles lecteurs assidus, créateurs dessous l’espoir rebelle ;
d’inégaux enchantements se fera ta plainte, à moi, qui prête serai –
te recevoir avec toutes les dues intelligences avec l’ennemi, comme
l’est la voiture trop légère pour toutes les vïolences. Alors il sera
temps toi et moi nous retirions dans nos tentes, et rythmiquement
alors tu opposeras ton pied contre mon avant-bras, et ténuement
peut-être moi, je t’enduirai de mon sourire à peine intelligible,
si tu sais le saisir, mais si tu ne sais que banqueter, siffler au
bec du vin e de l’ambitieuse plus sévère même que cette aspiration
que j’ai vers ta partie la plus sévère, alors détends-toi seulement
parmi tes planètes. Je ne sais si moi oui ou non je me mourrai
de faim, peur, les yeux trop ouverts pour miraculeusement
manger, la terre qui enveloppe et soutient toute l’eau bien
trop noire pour la légèreté du ciel. Combien est étrange
ce rire de chauve-souris que j’ai, combien étrange est cet
extravagant délire mien sans oreilles, combien extravagant
cet étrange délire mien sans oiselles. Combien étrange est cet
aimer les amères oisivetés de la vie.
Et si les soldats qui firent irruption dans la tente de
Dieu furent cette désespérée dispute qu’est la haine ;
alors j’avance le poignard dans un poing bien serré,
et je te tue. Mais l’univers c’est tout pareil et tu le
sais ! L’air, l’air pur, la maladie, et le somniolent
adieu. L’air, l’air pur, le bon bifteck pourri,
et l’ultime vert de l’été. Et la graine de l’ultime
violence de l’été.
La veste de tous les tours d’adresse me prenait
fort sur mon côté faible : oh moi j’aime plus peut-être
les collines et les fraîches brises et les vert sombre
pinèdes, que les géants pas de l’homme : je rêve
le soleil d’hiver et voici que les fraîches brises
m’éveillent l’été ! C’est pas pour toi ! que je crie
hors de toute limite, mon souffle court contre
le léger et secret souffle des étoiles ; ce n’est
pour aucune main terrestre. Mais qui me fit donc
si aveugle ? Si ce n’est pas pour moi, que ce soit
pour toi ! N’ai pas le temps entre les mains : lumières
et terrains, visages et foules impitoyables, visages agonisants,
vous vous poussez en direction du clair avec un regard de la
lune.
Je ne sais pas si ta figure sait répéter une
fissure en toi ou si mes sentiments savent mieux
que cette tête virile mienne que c’est vrai, ou si est
faux celui qui est beau, beau parce que semblable à.
Ou beau parce que bon ? Je cherche et cherche, tu cours
et cours. Et je cours ! et tu ris aux foules épouvantées !
Ne sais quelle grandeur nous fut préparée : Dieu
ne pardonne pas à qui porte du bout des lèvres seulement
son difficile nom, son don de sang en héritage, sa
jaune forêt. J’aplanis un terrain pour le recevoir,
mais je m’enfuis avant que les tambours ne résonnent.
Comme ça tu sauras qui je suis ; la sotte abeille qui bourdonne
pour un point fixe, en le cherchant Lui, cette jungle aux
arbres de fer forgé.
Et la voix rhétorique du bellâtre que je
vois sans amertume m’implique magiquement
et par luxure dans ses braves bras grands ouverts.
De blancs et bruns Anges survoleront, et le temps
et le chantage des vieux et le chantage de la musique
et le lieu de toute la beauté. Si je te vends le joug
léger de mon esprit malade cependant qu’entre
les deux rideaux des impossibles cercles qui
se sont tendus entre nos âmes, dans l’air, lequel
palpite entre ta révolte et la mienne, et qui pousse
et gémit devant la grand’porte, dans le grenier ouvert
à la plus profonde tristesse qui m’unissait à tes rêves
rappelle les mots écrits sur les murs des plus grandes
forteresses des Égyptiens. Je suis une femme qui fait
des expériences avec la vie et ne peut laisser aucun
rival lui toucher le cœur, les membres insatiables.
Je suis une femme qui laisse volontiers la gloire
aux autres mais se désole d’être retenue par les
malheureux nœuds de sa gorge. Je suis une parmi
tant de voraces comme moi mais par Dieu je forgerai
si je peux un autre canal pour mon besoin et mes
envies seront d’une autre trempe ! Et si assurée
je triomphe sur de ces peines, triomphante et pénitente
je poursuis le pardon total, et que Dieu permette
ma présomptueuse discordance d’avec les guides
du ciel perlé. Souviens-toi que je fus parmi les plus
fatigués des cavaliers de nos imperfections. Souviens-toi
que nous tous fûmes mis au monde pour présenter toutes
les fatigues. Rappelle-toi cette vie par moi-même attachée
à l’inconnu déguster goutte à goutte de tes pupilles. Repose
durement jusqu’à la fin – et qu’éclatants soient tes clairs
jours sans repos.
Je ne sais pas si entre le sourire du vert été
et ta verte différence il existe une différence
je ne sais pas si je rime par charme ou tourmenteuse
peine. Je ne sais si je rime par charme ou par raison
et je ne sais si tu le sais que je rime entièrement
pour toi. Trop de soleil a imbibé la mer dans son
tranquille emprisonnement, où le fleurage de la
mer ne veut pas mettre la main aux bâtiments coulés.
L’aube lointaine se meut à des grisailles. Je ne sais
si parmi les pâles roches je rencontrais le regard,
je ne sais si parmi les monotones cris je rencontrais
ton regard, je ne sais si entre la montagne et la
mer, il existe quand même un fleuve. Je ne sais
si entre côte et désert revient à soi un fleuve accosté,
je ne sais si parmi la brume tu accostes. Je ne
sais si tu tombes ou trembles, tu ne sais si je pleure
ou désespère. Désespérer, désespérer, désespérer,
c’est toujours un fabriquer. Tu ne sais si je pleure
ou désespère, tu ne sais si je ris ou désespère. Je
ne sais si parmi les pâles roches ton sourire.
Trad. J.Ch. Vegliante
[La première partie a été publiée
par CIRCE, Univ. Paris 3 — S.N.]