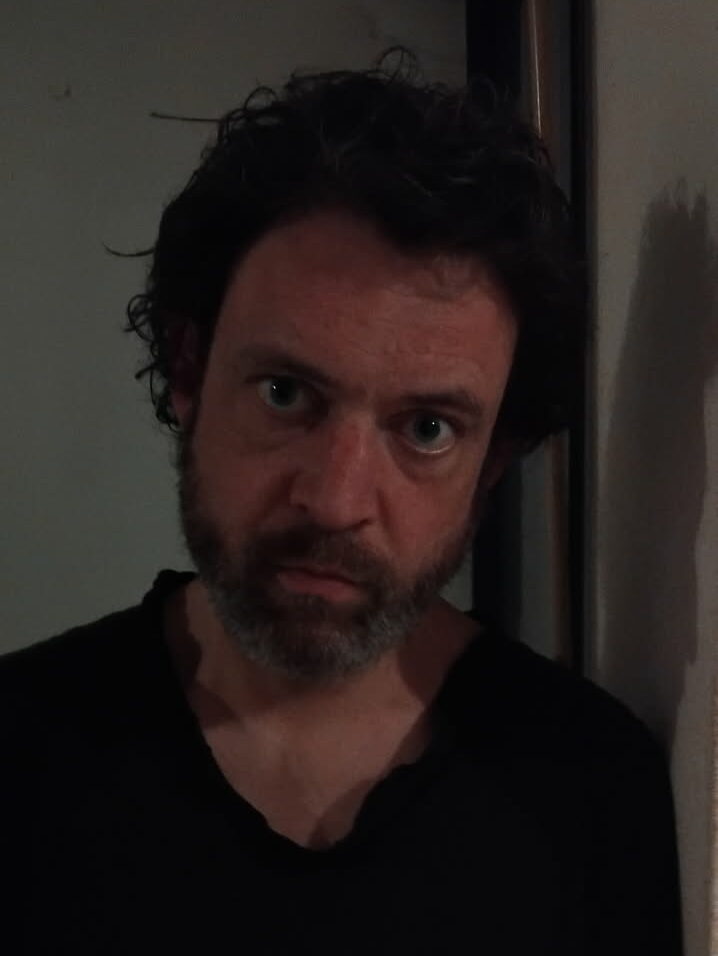Dans la double volée du chant
à Paul Celan
Soleil de nuit
pointant le visage du feu,
l’histoire a brûlé dans nos mains
l’ombre passante de l’éclair,
sa lame étincelante déjoué
la mélancolie muette des choses.
Sur la margelle des orages, une étoile a sombré.
//
Parmi les sables au jardin de l’oubli,
de ta seule raison pour qu’un chant devienne
promis à l’errance –
tu as jeté l’ancre et le pas,
de ta fuite entre les eaux, ta langue à venir
nourrissant l’impatience du voyage.
//
Tu as perpétué
l’ample déchirure de l’instant
où s’éveillent les sources, la cendre inachevée.
L’espace saisi au vol d’une plus grande soif,
le rêve défunt s’est affranchi
du nombre qui l’habite.
//
La musique des mots soumise à tes lèvres
a confondu l’attente du poème
multiplié dans le lit du fleuve.
O nuit qui te dénombre exilé dans nos veines,
les grains du silence un à un affleurent
dans le sablier de la mer.
//
À hauteur de mémoire
QUI PARLE EN TON NOM?
La rose des tempêtes
a retenu le souffle des fontaines agonisantes
ô paroles drapées de feu,
sommeil échoué sur le récif des heures.
Quand les nuits sans rivage ne se ressemblent plus,
j’écris le goût secret de ton sang
sur un dernier carré de ciel.
//
Murmure insaisissable,
ton ombre muselée sous le chiffre des pierres
bercera la rumeur naufragée des jours.
//
Plus changeant que l’énigme,
l’oiseau des nuits amères aiguise
les couperets du vent.
Ton rire a poignardé les rives du fleuve,
muettes maisons où brûle le crime.
Sous la morsure de l’eau,
nage à contre-courant l’histoire déracinée –
l’échafaud pousse à tes pieds
son front contre l’oubli.
//
Tu vas nageant
au plus étroit passage de l’exil.
Ton visage horizon ne cesse de grandir
où les collines penchent, le front contre le ciel
de ta langue – spräche aux racines d’est,
bruyante mémoire ourlée de sable.
//
Au plus noir de l’avril
à Primo Levi
L’AVRIL EST SANS RAISON
au toit du ciel bitumé
Là-bas
une étoile brûle au cœur
où même le vent trépasse
les chambres de l’oubli
gardent l’empreinte des derniers cris
//
Mille feuilles envolées
aux branches des bouleaux
mille et mille fumées déclinent leurs prénoms
mille est un qui ne sait son destin
mille est une qui ne dit mot du destin
sans âge sera leur vie
sans nom sera leur nuit
au bout du temps le temps ne s’interrompt
présent sans retour ni détour
sous la saillie du toit
plus que la mort dans la ramure des arbres
//
Nulle autre ponctuation pour le dire
que le silence des ruines noires
Nul autre regard pour l’écrire
au bord même d’une seule image
qu’un cliché pris au vol de l’oubli
//
Le vertige des pas
D’un geste
le lieu détenu au juger
dans la mouvante lumière de l’instant
s’énonce le schibboleth de la mémoire
sur la plaque sensible tel Minox
fixant l’indéchiffrable signe
“l’homme pénétra dans le maquis du bois
qui commençait là devant le crématoire,
le bras droit le long du corps,
avec dans sa main,
d’assez loin pour que nul ne s’en aperçoive,
l’appareil transporté dans un double fond”
unique témoin du commando volant
sans visage ni paroles
//
Il vit
pour que survive un premier cliché
à nul autre regard dévolu
ombres se mêlant contre le ciel
aux ombres des femmes
destinées à n’être rien
que morceaux dénombrés
stück déjà nues dans l’oblique photo
visages d’ombres et de chair penchés
s’avançant jusqu’au bout de la ligne
où se forme l’ultime convoi
nuit de cendres à jamais sans repos
//
Debout
dans le noir silence qui dérobe l’attente
certaines à l’écart de l’humaine figure
se livrent au vertige des pas
sur la terre nue foulée dans le jour sans trêve
où chemine le désastre
jusqu’aux profondes ramures du ciel
Alain Fabre-Catalan est photographié par Roswitha Strüber.