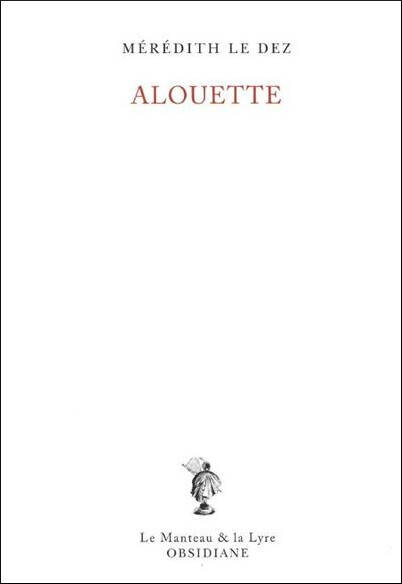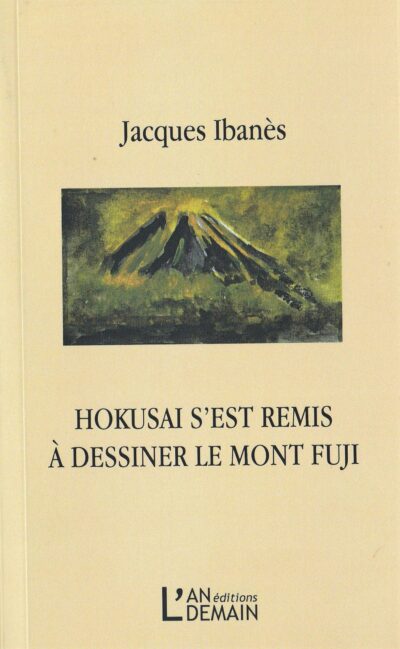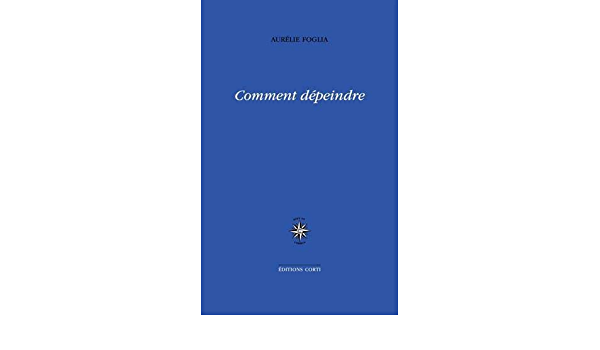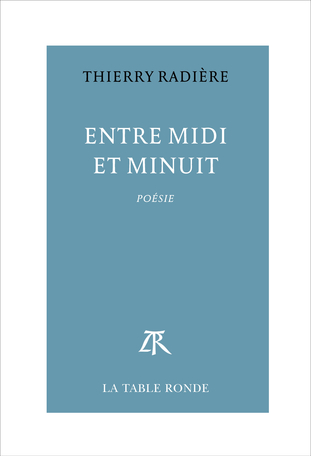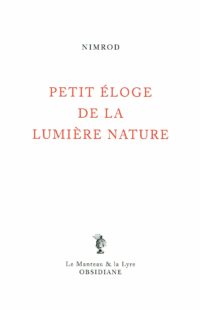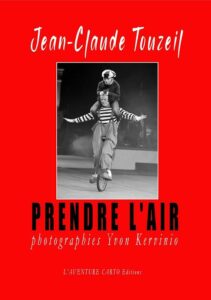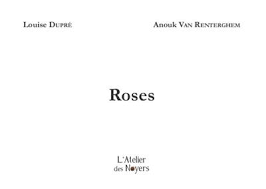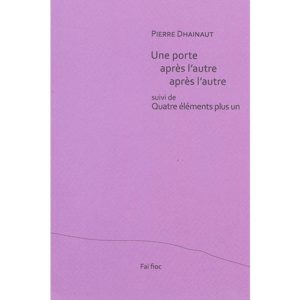Marc Alyn, Forêts domaniales de la mémoire
Marc Alyn rêvait jeune « d’une poésie verticale, toujours en marche ». Son vœu est exaucé. Qui mieux que les forêts peut rendre compte des « ressources infinies du Temps » ? Surtout lorsque, « domaniales », leur titre de propriété appartient à tout le monde ?
Comme le suggèrent le titre du livre et ses trois mouvements : « Forêts voyageuses », « Avant-postes de la mémoire » et « Marcheur des aubes violettes », il s’agit pour le poète de vivre le temps sous toutes ses dimensions, dont celle de l’espace, la mémoire étant perçue conjointement comme une marche dans le Temps et comme une vastitude à explorer, verticales et horizontales d’un même arbre.
Les forêts nous ressemblent, aussi voyageuses que nous. Les arbres « marchent » « en route vers les confins ». Ce compagnonnage dynamique a valeur d’interrogation sur ce que nous faisons au temps et sur ce qu’il fait de nous. Le traverse-t-on comme une forêt ou se laisse-t-on traverser par lui ? Que nous laisse-t-il et que lui laissons-nous ?
L’arbre, décrit comme un « inlassable pérégrin » porteur de « l’écriture initiale », est l’intercesseur qui conduit le « rêveur des sous-bois » à « la porte du temps ». Grâce à lui, le poète partage l’expérience physique et métaphysique de la « Durée » tout en vivant la forêt comme une géographie mentale, une « demeure onirique ». Les forêts, l’arbre, « orphique labyrinthe », assurent le passage vers d’autres espaces, ceux de « l’Image », de la pleine vision qui ramène à la vie, tel un phénix « monarque des braises ». Cette métaphore revient à plusieurs reprises dans le recueil, symbole du désir ardent. L’oiseau de feu, pour peu que sa flamme soit pure et non incendiaire à l’instar du vaniteux Érostrate destructeur du temple d’Artémis, offre une « seconde enfance », dans une sorte de résurrection permanente où se retrouvent paysages et êtres familiers.
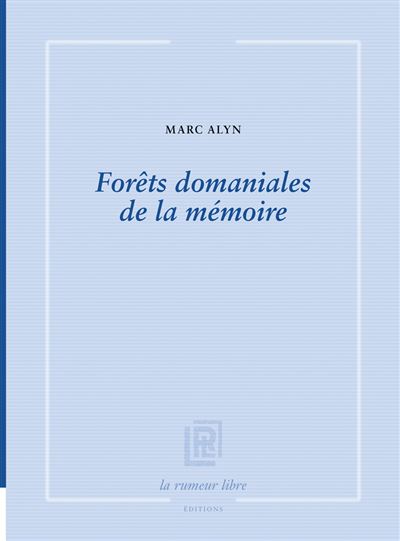
Marc Alyn, Forêts domaniales de la mémoire, La rumeur libre, mai 2023, 136 pages, 17 euros.
Le poète, au contact des forêts, redevient l’enfant qu’il était, avide de mystère, émerveillé par le « cœur fertile de la rose ». « Je suis arbre », écrit-il. C’est donc un retour aux origines, les siennes, mais aussi à celles, immémoriales, du monde qu’il nous donne à vivre. Les « siècles effarés » se mêlent aux paysages aimés, vignes et oliviers, ceux des Crémats, non loin d’Uzès où vécut longtemps Marc Alyn. (Le lecteur averti de sa vie et de son œuvre reconnaîtra aisément les lieux et événements évoqués.) Et c’est au tour du poète de s’interroger sur son propre temps sous l’écorce.
Le poète est un être toujours « entre deux éveils ». « Entaille irrécusable », il est biface sur son « entre-seuil », tel le dieu Janus, appartenant à deux temps, deux lieux, cet « outre-ciel » commun à tous. Canopées entrelacées, le présent peut se conjuguer au passé et la mémoire aux « battements ressuscités du cœur cosmique ». Car, au fil de la marche, le temps, présent, passé, nomadise au cœur des « branches inextricables des réminiscences » : âges, pays, paysages, expériences fondatrices, mirages, incandescences, illuminations, quête d’absolu, alphabets, signes, écriture… associés dans une sorte d’« incipit de l’éternité ». Le futur est convoqué lui aussi, comme interrogé à rebours par le « passeur des songes à venir », car tout s’inverse sur les chemins de la Mémoire, dans une remontée à la source. Le temps et l’espace se tricotent dans tous les sens : avant/après, haut/bas, dessus/dessous, ici/ailleurs, visible/invisible, la conscience poétique voyage à sa guise « par la fenêtre du rapide ».
On retrouve dans ces 96 poèmes ce qui fait la singularité de l’écriture de Marc Alyn. Déjà on dénombre dans les trois sections 30, 36 et 30 poèmes. Le lecteur pourra s’amuser à interpréter ces nombres selon la symbolique qui lui convient, la lecture étant magie elle aussi. La pensée ésotérique, chère à l’auteur, « bête et ange à la fois », est très présente car le « soleil alchimiste » garde ses entrées dans la « Chambre verte des voyances ». Le mot « prophéties », si on y songe, ne contient-il pas le mot « poésie » ?
Si les poèmes s’offrent sur la page de façon verticale et aérée, chacun, à l’image d’un arbre, brille avec densité et éclat. L’écriture, précieuse et diamantée, est sculptée avec précision. « Affranchi(e) du carcan des lexiques », elle possède ses luxuriances et ses ruptures de ton, ses écarts d’humour : « les morts bruts/de décoffrage/ne savaient sur quel pied danser ». Elle s’amuse à détourner les mots : « pèlerin aux pieds nus/s’acheminant vers le temple d’Encore», à associer le dissemblable : « Le Temps casseur d’assiettes / et de tours de Babel ». La liberté est grande entre la flamboyance des « vocables irradiés » à même la forge et les espiègleries de l’autodérision. L’enfantine fantaisie miroite, soleilleuse, entre les feuilles.
Le poète, qui est un érudit, allie dans ses vers les mythologies égyptienne, celtique, gréco-romaine, judaïque, chrétienne jusqu’au tarot divinatoire, tant tout fait sens dans la « chambre de l’imaginaire », du signe cabalistique dûment codifié au bec de l’oiseau frappant au carreau. Renaissant chaque fois à lui-même, ce « Veilleur / du Temps circulaire » voyage dans toutes les cosmogonies, depuis la Terre jusqu’aux lointaines galaxies, accordé à la grande roue de l’Univers. On s’avance avec lui dans la forêt des symboles, des légendes, des époques, le regard à hauteur de ramures, d’horizons et d’astres. Nombreux sont ses « mots de passe ». Nombreux ses entrelacs de sens, tours et détours, qui se donnent ou se dérobent au fur et à mesure qu’on pérégrine avec lui.
« À pas de racines et d’aubiers », c’est toute l’histoire humaine qui se met en marche en cercles concentriques sous les semelles du poète, le cœur des arbres rejoignant à des années-lumière, comme dans une sorte de dendrochronologie cosmique, les « vents stellaires », et les « collisions astrales ».
La poésie de Marc Alyn est une poésie de haut lignage à souffle d’épopée (on remarquera l’emploi fréquent de majuscules). Elle s’efforce depuis ses débuts « de soigner le temps par l’espace » afin de « se rencontrer ailleurs sous d’autres traits, faute de réussir à se perdre » (Revue Phœnix n° 1, janvier 2011).
Et c’est assez, pour le poète, d’entrer dans la Mémoire des forêts.
∗∗∗
Extrait
Ai-je vraiment vécu
ou fus-je une fumée
entre les doigts du scribe,
cendre et semence
dans le vent ?
Sans cesse
obstinément
j’ai fait choix du non-être
pour m’approprier
le chant d’un merle de passage
ou d’un rai de soleil.
Aussi préférais-je me tenir immobile
dans la Mansarde natale de la Mémoire
où un poste à galène
m’informait du changement d’adresse
de Dieu.
(Page 84, in Avant-postes de la mémoire)