La poète et artiste peintre Aurélie Foglia rend compte dans son dernier livre d’une triple expérience : celle d’une poète qui écrit sur l’acte d’écrire, d’une peintre sur celui de peindre (quels liens entre les deux ?), enfin d’une femme victime d’articide de la part de son compagnon violent.
Comment commencer un tel livre ? Dans son ordre chronologique des quatre saisons (À la manière de ma main / Avoir à voir / Peindre avec la langue / Vous désarticulées) ou bien à rebrousse-temps ? Pour moi qui ai tendance à lire d’abord dans le désordre, je débuterai cette note par la dernière saison (pages 109 à 203) qui occupe la plus grande partie de l’ouvrage. On remarque d’ailleurs que la pagination s’arrête à la page 199, les derniers poèmes n’étant pas foliotés. Est-ce une erreur de maquette ou un choix signifiant comme si les feuilles restaient désormais sans repères ?
Dans cette quatrième partie intitulée « Vous désarticulées », avec son accord au féminin, l’auteur s’adresse à ses toiles comme à ses enfants.
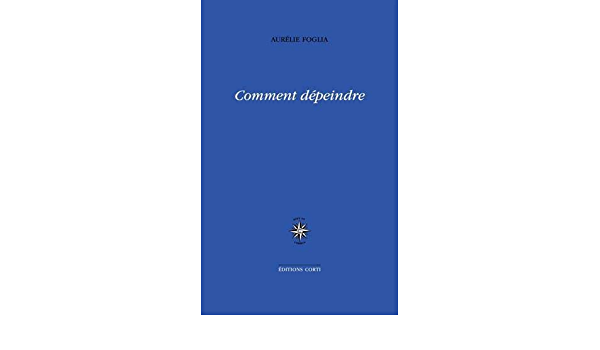
Aurélie Foglia, Comment dépeindre, Éditions Corti, novembre 2020, 208 pages, 19 euros.
Que s’est-il passé dans la vie de l’artiste ? Une note explicative nous le précise en toute fin : son compagnon, prédateur violent, a en son absence détruit toute son œuvre, soit 150 toiles. Un articide-féminicide car la peintre et ses créations sont charnellement liées, indissociables l’une de l’autre. Un prédateur sait toujours où porter ses coups, son but étant la mort de sa proie.
Ne reste au bout du compte du « massacre » que la seule œuvre qu’il connaisse : « l’œuvre de la violence ». Qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit d’un crime, par démantèlement et dépossession. Faut-il être un artiste, un poète, pour le comprendre ? La police, la justice ont minimisé l’impact de l’articide sur sa victime, comme certaines personnes de son entourage : « heureusement tu / es saine et sauve / ce sont tes toiles / qui ont trinqué / ce ne sont que des toiles / après tout… » Les œuvres sont de la chair, du sang, du temps, de l’amour, elles vivent comme des « enfants du bout des doigts », comment l’ignorer ? Quelle est cette société où l’on tolère autant de violences à l’égard des femmes ? Où ce n’est pas si important « après tout » ? Faut-il attendre que la femme perde la vie pour que l’on intervienne ?
un pan d’œuvre est mort
de mon vivantle corps atteint
se replie et se taitun arbre à qui on a
arraché ses bourgeonsquand on touche à l’œuvre
l’œuvre criec’est plus fort que moi
Cette métaphore de l’arbre n’en est pas une, on le comprend en reprenant le livre à son début. Le lien de la peintre-poète avec l’arbre est organique, consubstantiel. Son nom même Foglia ne signifie-t-il pas qu’elle est feuille ? Le rapport est intime, ontologique. L’arbre, pérenne, silencieux, profus dans ses formes et couleurs, est source, lumière, vie, ressource inépuisable. Il est là depuis la nuit des temps, présence tutélaire que la main heureuse ne peut asservir.
les arbres sont mes aiguilles
pinceaux mètres étalons
échelles béquilles
/…/
Aurélie Foglia peint les arbres avec son corps, à mains nues, au plus près de la matière et des éléments, comme dans un retour aux origines de l’humanité. Seule la toile-paroi est l’interface. Il lui faut dépeindre, désapprendre à peindre comme on désapprend à écrire pour retrouver la source vive du surgissement, son point d’émergence. Elle recherche l’instant premier qui permet la libre création, désentravée de tout.
ma pratique remonte
à l’époque où l’homme avait plus
de mainss’en remettait aux rites avant de
ses corpstapis dans ses viscères à l’image de
la touffeur dehorspour conserver l’animation ma-
gique des ombres sur les parois à
nud’une caverne
Cette expérience directe et intense de la peinture est particulièrement émouvante car elle dit la réappartenance à soi-même, au monde, à ses éléments, à son histoire. Plus rien n’est séparé. La main caresse, devient musique, main d’harmonie, de don et non de prédation.
La bouche aussi est une « cave ». C’est elle le lieu premier de la poète, qui précise : « je ne suis pas / peintre à l’origine ». Sa peinture, toute instinctive, relève du geste. Elle avance sans intellect, sans mots, − pour leur échapper peut-être − dans un jaillissement libre comme l’est celui du poème. Ce dernier est un arbre sur la page, filiforme et aéré dans ses ramures, filtrant sa lumière goutte à goutte. Il se cherche, se sculpte à son rythme, crée son espace, voudrait se « peindre avec la langue ». On le voit, arbres, poèmes, peintures sont étroitement liées dans une même énergie vitale. Ils procèdent du même rituel sauvage, dépourvu de nom car il ne sait ce qu’il cherche, toute trace créant son chemin, son inconnu jubilatoire libre de toute attache.
Les mots, eux aussi, sont libérés de leurs attaches. Ils frayent sur la page directement, sans l’aide des liens grammaticaux traditionnels, comme les couleurs qui, juxtaposées en touches sur la toile, changent de valeur au contact l’une de l’autre. Dans la création, tout s’interpénètre, mots, couleurs, matière, corps en un même acte d’amour, une même quête d’absolu : « le jaune est la couleur du jouir. »
L’auteur use dans ses vers de coupes signifiantes, un mot en contenant un autre que la césure inattendue éclaire tout à coup. Le mot n’est pas seul mais pris dans un réseau de sens qu’il fait entendre par divers procédés lexicaux, une façon de rappeler que tout sur cette terre a partie liée, les arbres comme les humains, comme leur langage. Alors on lit, on relit, on revient en arrière sur la fine « marquèterie » pour capter un autre reflet, une autre vibration. « Où êtes-vous / mes arbres ar- / rasés ». Un mot dit toujours plus qu’il « n’en a l’art ». Et s’il est impuissant à dire, il se renouvelle : « langue coupée / d’avoir vu l’invoyable » ou se réinvente : « je doigts / faire de la toile une page ».
Mots mobiles comme les couleurs qui jouent ensemble, s’appellent en miroir, mots qui excèdent leur rôle commun pour se mêler à leur guise dans la fluidité de la langue, la spontanéité originelle. Et sur la page l’œil aussi se fait mobile comme la main sur la toile. Le titre lui-même « comment dépeindre », question ou assertion, joue sur différentes épaisseurs sémantiques : comment décrire l’acte de peindre, celui d’écrire, comment faire abstraction de tout ce que l’on sait pour atteindre la nudité du surgissement, comment raconter le crime et le deuil, comment vivre sans peinture, amputé de soi ?
Souhaitons à Aurélie Foglia de retrouver l’énergie pure de ses mains, pour l’amour des arbres, des mots et des couleurs. Et que justice lui soit rendue.
Pour connaître les œuvres d’Aurélie Foglia : http://www.a‑foglia.com/
Pour participer au collectif contre l’articide créé par Aurélie Foglia et Maud Thiria :
https://www.fabula.org/actualites/collectif-contre-l-articide_100014.php
Présentation de l’auteur
- Marc Alyn, Forêts domaniales de la mémoire - 22 septembre 2023
- Mérédith Le Dez, Alouette - 6 septembre 2023
- Jacques Ibanès, Hokusai s’est remis à dessiner le Mont Fuji - 20 décembre 2021
- Aurélie Foglia, Comment dépeindre - 21 juin 2021
- Thierry Radière, Entre midi et minuit, - 6 juin 2021
- Aline Recoura, Scènes d’école - 20 mai 2021
- Nimrod, Petit éloge de la lumière nature - 6 mai 2021
- Jean-Claude Touzeil, Yvon Kervinio, Prendre l’air - 19 mars 2021
- Louise Dupré, Anouk Van Renterghem, Roses - 21 décembre 2020
- Pierre Dhainaut, Une porte après l’autre après l’autre, suivi de Quatre éléments plus un - 26 novembre 2020
- Marilyne Bertoncini, La noyée d’Onagawa - 6 septembre 2020
- Haikulinaires et autres fantaisies - 29 août 2020
- Estelle Fenzy, Coda (Ostinato) - 21 juin 2020
- Véronique Maupas,Passagère - 21 mai 2020
- Fabienne Juhel, La Mâle-mort entre les dents - 6 mai 2020
- Fabienne Swiatly, Elles sont au service - 21 mars 2020
- Gérard Bocholier, Depuis toujours le chant - 6 mars 2020
- Christian Degoutte, Le tour du lac - 20 décembre 2019
- Sylvie Durbec, Autobiographies de la faim - 6 décembre 2019


